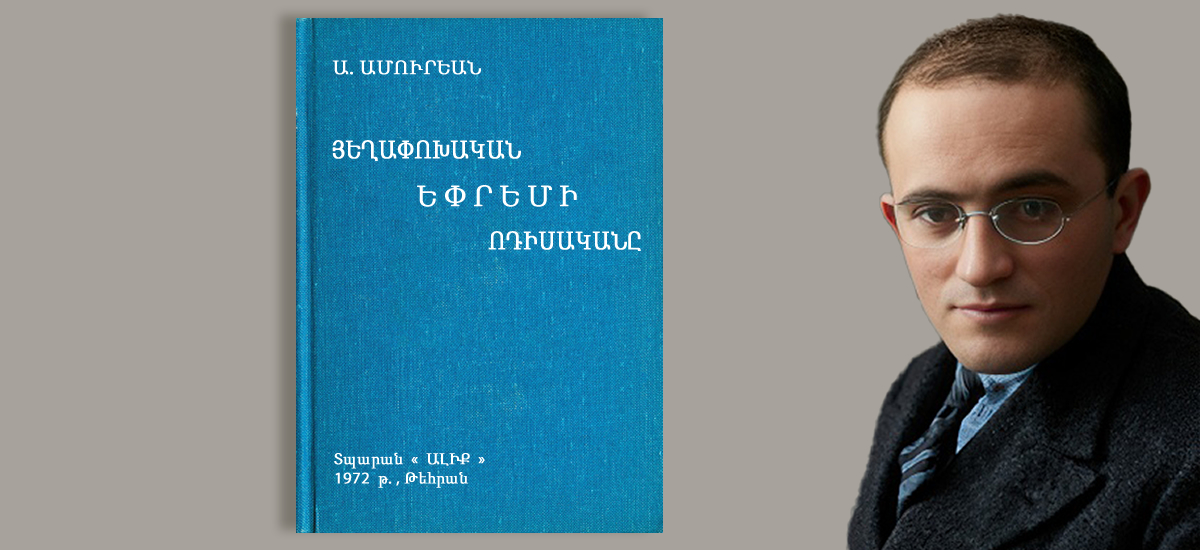Sous ce numéro et sous cette rubrique, nous commençons la publication des mémoires du vétéran bien connu de la Fédération Révolutionnaire Arménienne (FRA), André Ter Ohanian (A. Amourian). Ce volume de mémoires, intitulé « Pages de Vie » et portant l'inscription « De l'enfance jusqu'en 1936 », nous a été fourni par le Bureau de la FRA. Pour des raisons compréhensibles de publication, nous publions le manuscrit en en sélectionnant des extraits. La période de ce premier extrait est l'hiver 1917-1918.
Cette rubrique, qui vise à publier des inédits ou à revaloriser de « Vieux Pages », sera une présence permanente dans « DROCHAK ».
1. ANDRÉ AMOURIAN - VOLONTAIRE D'ANTAN
DROCHAK, 11e année, N° 2, 14 Mai, 1986, pages 72-73.
Je suis resté couché trois jours chez ma tante à Tiflis, puis je me suis levé. Deux délégués étaient demandés pour le Congrès des Élèves Arméniens qui devait avoir lieu à Bakou : un de deux classes du séminaire. Les garçons de notre classe m'avaient élu, et de la classe supérieure, Vartan Hovhannissian (V. Astghouni) ; nous étions tous deux de Tabriz.
Je devais rencontrer le fils du camarade Hamo Ohanjanian, Monia Ohanjanian, à propos du départ pour Bakou. Je suis allé chez Monia. Il m'a accueilli chaleureusement. Monia, dix-sept ans, était un garçon de mon âge, beau, avec un profil grec, les cheveux peignés sur le côté. Il parlait russe (de la première femme de Hamo, qui était russe). Il portait l'uniforme spécifique au gymnase Lissitzian. La chambre de Monia était très simple : sur la table, quelques livres et cahiers, dans un coin, un ou deux instruments de sport.
Nous avons parlé russe. Monia dit que Vartan et moi devions partir pour Bakou, et qu'il viendrait lui aussi avec ses amis.
Le congrès commença. La figure centrale était Monia. Se distinguaient également Elia Tchoubar et Amatouni* (en 1926-27, il avait été envoyé à Paris par les bolcheviks. Il dirigeait le journal « Erevan » et attaquait la FRA. Amatouni était également devenu une figure importante en Arménie Soviétique. Finalement, les bolcheviks ont « liquidé » les deux... A. A.). Tchoubar, dans son discours, cita même ces vers du poème d'A. Hsahagian qui dit : « Pendant mille ans, et même plus, le Tatar s'est agenouillé sur notre poitrine ». Ainsi parlèrent-ils, et à la fin, ils devinrent bolcheviks.
Dans la partie des propositions, je pris la parole et dictai que les élèves arméniens devaient bien étudier notre histoire, lire nos historiens : Movsès Khorénatsi, Eghiché, Ghazar Parpetsi, etc., prendre conscience de nos revendications nationales, être fiers de notre passé.
L'assistance applaudit, mais les organisateurs accueillirent cela avec dédain. Ils eurent la même attitude quand il fallut envoyer des télégrammes de salutation ; je proposai d'envoyer un télégramme aussi à Etchmiadzin, au Catholicos de Tous les Arméniens. La majorité fut favorable.
Le mot de salutation fut prononcé par Simon Hakobian, rédacteur du journal « Arev », organe de la FRA de Bakou.
Pendant les pauses, les jeunes filles arméniennes nous offraient l'hospitalité avec des pâtisseries, du thé et de la limonade. Elles parlaient arménien avec le dialecte de leurs parents, en y mêlant du russe.
Pendant les heures libres, nous allions au port de Bakou. Pour la première fois, nous vîmes des hydravions ; ils volaient sans cesse.
Nous retournâmes de la colonie arménienne de Bakou à Tiflis. La situation sur le front caucasien était chaotique : l'armée russe battait en retraite comme un troupeau sans tête, elle « rentrait à la maison ». Le Conseil National et la FRA se mobilisaient pour former des unités nationales et les envoyer au front.
En ces jours-là, Monia Ohanjanian convoqua une réunion estudiantine dans la salle de l'Administration Municipale de Tiflis. La salle était comble. Monia était assis derrière la table ; à côté de lui, l'étudiant Hrant. Tous deux étaient de fervents patriotes.
Monia expliqua la situation politique, puis lança un appel pour que les élèves-étudiants s'inscrivent comme volontaires pour partir au front. Nous approuvâmes tous, appréciant la proposition de Monia.
Retentit l'appel du Dr. Jakob Zavriev, adressé aux étudiants, pour s'enrôler comme volontaires et partir au front.
Mon camarade de classe intime, Stépan Shahgueldian (de Kichinev), était parti brièvement à Erzurum, puis était revenu. Je le laissai me raconter le front et l'Arménie turque. Je ne me lassais pas de l'écouter. Je dis à Stépan que je m'enrôlais comme volontaire. Il dit : « Moi aussi, j'irai avec toi de nouveau sur le front d'Erzurum ». J'étais content.
C'était le Dr. Artaches Babalian qui enregistrait les volontaires ; alors que je devais monter à son bureau, je rencontrai Mouchégh Santrosian, diplômé de notre séminaire. Il se plaignit : « Frère, quel genre d'homme est ce Babalian ? ». Ils avaient eu une dispute et Santrosian était parti.
Quand j'entrai, Babalian était sur le balcon et regardait l'animation de la rue. Il vint et demanda ce que je voulais. Je dis : Je suis venu m'inscrire comme volontaire, je suis du séminaire.
- On t'enverra à Khnous, à l'état-major du colonel Samartsev, comme scribe. Tu recevras cent vingt roubles par mois...
Je coupai sa parole, disant : Je m'enrôle comme volontaire, pas comme fonctionnaire, recevant de l'argent...
- Pourquoi, l'argent te percera-t-il la poche ?...
- Oui, dis-je, le fonctionnaire c'est une chose, le volontaire c'en est une autre...
Babalian céda, écrivit deux papiers, l'un pour l'entêtement, l'autre pour recevoir des vêtements et des chaussures du dépôt militaire.
La ville de Sarikamich était à un kilomètre de la gare. Il n'y avait aucun moyen de s'y rendre ; il fallait marcher ; mais c'était une nuit noire et dangereuse ; des soldats russes (déserteurs) pouvaient nous attaquer. À ce moment, comme tombé du ciel, l'étudiant Hrant apparut près de nous. « Les gars, dit-il, formez deux rangées, je marcherai derrière vous. J'ai un pistolet Browning, je vous protégerai. »
C'est ce que nous fîmes et, trébuchant, tâtonnant dans l'obscurité, nous marchâmes jusqu'à l'état-major de Sarikamich, où nous fut reçu par le chef de bande Hntchag Pandukht, qui était le chef d'état-major.
L'état-major en question était deux vastes boutiques, avec des caisses alignées le long des murs, contenant de la dynamite et des bombes. Aussi quelques fusils, appuyés contre les murs. Derrière les boutiques, il y avait une grande cour, comme un caravansérail.
(...) Nous devions partir pour Erzurum avec un camion militaire. Nous rejoignit Achkhen Tcholakhian, la femme du célèbre jeune dirigeant de la FRA dans le Caucase, Hipirik Tcholakhian, qui avait revêtu une demi-pelisse militaire en fourrure, et aux pieds, des sapogues (bottes à longues tiges). Les cheveux de sa tête étaient coupés court. Son visage n'était pas beau.
Elle se lia immédiatement d'amitié avec Stépan et moi. On fit tirer la bâche du camion pour que le froid ne pénètre pas trop à l'intérieur.
Celui qui n'a pas été en Arménie Occidentale ne peut pas se faire une idée de ses hivers glacials, 35-40 degrés au-dessous de zéro, parfois même plus. Les montagnes et les plaines se couvrent d'une épaisse couche de neige et de glace. La surface des rivières se couvre de glace, les gens traversent la rivière à pied et à cheval. Pendant les mois que je passai sur ces fronts, je ne vis pas le soleil. De Köprü-Köy jusqu'à Erzurum, nous ne vîmes pas un seul arbre. Seul Sarikamich est boisé, beau....
Le froid pénétrait à l'intérieur ; il faisait déjà froid à l'intérieur ; le coton cousu dans notre demi-pelisse et dans notre pantalon et veste militaire n'aidait pas, pas plus que les chaussettes en laine.
Avant d'arriver à Erzurum, nous devions passer le col de Deveboynu. « Pourvu que Dieu ne nous prenne pas dans une tempête de neige, sinon nous serons enterrés sous la neige », disaient les compagnons de route. Heureusement, cela se passa bien et nous, gelés et fatigués, arrivâmes à Erzurum, où nous entrâmes par la porte d'une épaisse muraille, dont le chemin montait sur une courte distance.
Nous descendîmes à la porte de l'état-major militaire d'Erzurum. À peine entrés, nous rencontrâmes notre surveillant du séminaire, Erouand Hairapetian, qui s'occupait de recueillir les orphelins pour l'Union des Villes. Il nous accueillit avec affection, il était fier que les élèves du séminaire s'enrôlent en grand nombre comme volontaires. Il dit que pour l'instant nous devions dormir au dortoir militaire, et manger à l'état-major.
Nous sortîmes nous promener en ville. Neige-hiver, on faisait aller des traîneaux, tirés par un cheval. Tout avait un aspect militaire. Nous rencontrâmes nos camarades de classe Eghiché Zaroutine, Erouand Dzakarian, les Arméniens occidentaux Hovakim Gouloyan, Armenak Srapian, Haykaz Ghazarian de Vagharchapat, Hovhannès Manukian d'Akhaltsikhé, Nahapet Kourghinian d'Achtarak, tous de notre classe.
Le lendemain, nos camarades nous emmenèrent voir l'église arménienne et l'école Sanasarian. Dans la cour de l'école Sanasarian, nous vîmes le buste du bienfaiteur Sanasarian. Les Arméniens d'Erzurum étaient absents, pillés, exilés, massacrés ; les institutions et les maisons détruites étaient devenues le repaire des hiboux. Notre cœur saignait...
Nous avions beaucoup de temps libre ; nous demandâmes aux garçons à quoi ils s'occupaient ; ils dirent qu'ils s'occupaient surtout de tir. Nous les rejoignîmes avec joie ; nous n'avions pas encore tiré un seul coup de fusil.
Notre entraînement fut rapide, nous nous sommes bien entraînés à la visée.
2. DE L'EFFONDREMENT DU FRONT TURC JUSQU'AU 28 MAI
DROCHAK, 11e année, N° 3, 28 Mai, 1986, pages 14-15 (122-123).
Ma préoccupation était le front. Le front s'étendait sur mille kilomètres, de Trébizonde jusqu'à la frontière persane ; la profondeur était de 300-400 km. Face aux 300 000 soldats russes en retraite, nous avions à peine 20-25 000 soldats, fedayis et volontaires arméniens ; c'était une force très faible face à l'armée turque d'au moins 200 000 hommes.
Donc, notre retraite était inévitable.
Avec cette pensée, j'écrivis une lettre au Conseil National Arménien de Tiflis, proposant qu'une partie des dépôts d'armes soit transférée à l'arrière, pour ne pas tomber entre les mains de notre ennemi. Je ne reçus pas de réponse. (Des années plus tard, à Tabriz, quand je racontai cela à Nikol Aghbalian, il dit : « Imagine, j'ai proposé la même chose à Erevan, qu'une partie des dépôts soit transférée dans la région de Nor Bayazet, à l'arrière, mais personne ne m'écouta »).
(...) Du village de Köprü-Köy vers l'est, à peine à un kilomètre, se trouve le pont historique, sous lequel coulait l'Araxe, en ces jours recouvert de glace.
(...) J'allais souvent seul, je m'arrêtais sur le pont, livré à de tristes pensées, parce que je sentais qu'un jour nous devrions abandonner ces terres de nos pères, faute de force, et mes larmes coulaient...
De l'autre côté du pont se trouvait l'ancien village arménien appelé Yaghan, dont tous les habitants avaient été massacrés par les Turcs. Les Arméniens du village de Köprü-Köy avaient également été massacrés, les maisons détruites, jusqu'aux poutres enlevées, emportées...
(...) Les soirs, souvent, Tsaghikian, le Maître (Vartabed) et l'adolescent de Nersessian, Georges, étaient absents. Un jour, je demandai à Georges où ils allaient. Il ne le cacha pas ; il dit qu'ils traquaient les espions turcs à l'arrière ; puis il raconta ce qui suit : « Nous avons attrapé un espion turc de forte carrure, il niait. Nous le fouillâmes, nous trouvâmes sur lui des lettres et des papiers ; c'était un espion. Nous exigeâmes qu'il avoue, il refusa. Les camarades tirèrent et le blessèrent à deux endroits ; il était à genoux, ne tombait pas ; il dit : "Finissez, que je me repose", je m'approchai de lui et vidai mon pistolet sur sa tempe, il tomba, creva.... ».
Une autre fois, quand on parla de cela, je dis que dans de tels cas, il fallait remettre l'espion à un tribunal militaire, puis le juger. « André, dit le Maître (Vartabed) ému, de ma famille, cinquante personnes ont été massacrées par les Turcs, ce n'étaient pas des espions. Toi, tu voudrais que nous jugions un espion turc par un tribunal... ».
Un soir, une automobile s'arrêta devant notre état-major. « C'est Andranik », dirent-ils, nous fûmes tous bouleversés. Les arrivants étaient Andranik, le Dr. Jakob Zavriev, un général russe et Hamlik Toumanian (le fils de Hovhannès Toumanian). J'avais vu Andranik passant par la place Erevanian à Tiflis, j'avais vu Hamlik au séminaire Guévorguian, où il était venu dans la classe supérieure à la nôtre, il resta un an, puis ne revint plus.
Tous se rassemblèrent autour d'Andranik, pour voir ce que disait le Pacha. Andranik avait des rhumatismes, on alluma bien le poêle, on lui mit aussi une bassine chaude aux pieds. Ils commencèrent à discuter. Chaque parole d'Andranik était reçue comme un décret. Andranik parlait de la défense du front, de la retraite de l'armée russe, de la situation difficile créée pour les Arméniens....
(La chute d'Erzurum donnera le signal de la retraite générale. Avec le flot de l'armée et de la population en retraite, les jeunes volontaires s'approcheront de la ligne de front pré-guerre russo-turque et de Sarikamich).
Nous marchâmes à travers les neiges, en montant, en descendant, au milieu de la tourmente et de la tempête ; finalement nous arrivâmes près de Karaourgan. Il restait environ 200-300 pas jusqu'au cantonnement, quand nous tombâmes, épuisés, sur la neige, et nous nous endormîmes...
Quelqu'un nous secoue en disant : « Les gars, vous allez geler ici, levez-vous, allons-y... ». C'était un jeune soldat arménien qui interrompit notre sommeil très doux. Il nous prit par le bras et nous traîna pour ainsi dire vers le cantonnement.
Le cantonnement était chaud ; les soldats arméniens nous nourrirent. À Sarikamich, nous ne savions pas où descendre, quand se présenta à nous Hovhannès Guilnazarian, étudiant de la classe supérieure du séminaire, qui nous conduisit au cantonnement où il logeait. (...) Juste aux deux côtés de l'entrée de l'état-major, deux chevaux gelés s'étaient figés en statue, dans une position dressée... Le sculpteur n'aurait pu faire un travail plus réussi que ne l'avait fait la nature. En ces jours, les pauvres chevaux, privés de soins et de nourriture, amaigris, erraient en dérivant dans les rues et tombaient quelque part, crevaient....
Nous étions près de l'état-major et regardions avec admiration les chevaux gelés, dressés, quand apparurent Monia Ohanjanian et l'étudiant Hrant. Nous parlâmes de la situation ; j'exprimai mon mécontentement concernant la retraite et l'incapacité du commandement à organiser une résistance. Monia dit qu'à Erzincan il y avait eu une résistance et que Hrant aussi avait été blessé. Plus tard, j'appris que Monia avait été décoré pour le combat d'Erzincan, mais il ne me le dit pas lui-même.
Je m'adoucis immédiatement. « Gravement ? » dis-je, et je fus rempli de respect envers Hrant. « Où a-t-il été blessé ? » demandai-je. Hrant montra la partie de la hanche de sa jambe droite ; le trou de la balle était encore sur son pantalon.
- Monia, puis-je aussi être avec vous ? - demandai-je.
- Cela dépend de la décision de l'état-major, - dit Monia.
J'entrai à l'état-major. Eghiché Zaroutine était là. Il s'approcha de moi et dit : « On nous confie, toi et moi, de transférer les armes du parti de Sarikamich à Kars. »
Un ou deux jours plus tard, nous arrangeâmes les armes au fond d'une charrette, nous y versâmes abondamment du foin sec, et à quatre, nous partîmes pour Kars.
(...) À Kars, avec Eghiché, nous allâmes remettre les armes du parti au représentant Valad Valadian. Des soldats, des réfugiés, la situation alarmante des locaux ; nous ne savions pas si Kars résisterait aux assauts turcs...
Nous nous présentâmes à l'état-major ; on nous dit d'aller à Alexandropol, l'état-major y décidera.
À Alexandropol, nous apprîmes que les Turcs étaient arrivés à Sarikamich. Notre âme était sombre. Est-ce que Kars résisterait ? S'il ne résistait pas, alors le tour d'Alexandropol viendrait. Et ensuite ? Alexandropol était un carrefour : vers le sud Kars, vers le nord Karakilisa et Tiflis, vers l'est menant à Erevan... Le Turc aspirait à briser, anéantir aussi les Arméniens orientaux, aplanir la route vers Bakou, s'emparer des puits de pétrole, pour réaliser l'empire pantouranien.
À la gare de Chamkhor, les Tatars locaux avaient attaqué l'armée russe en retraite et l'avaient massacrée ; ensuite, l'armée russe en retraite se frayait un chemin vers Bakou, puis la Russie, à l'aide de mitrailleuses alignées sur les wagons.
La désertion des soldats arméniens nous causait de la colère. Le soldat russe s'en moquait, il avait quitté le front et était parti chez lui. Mais l'Arménien ? « Hannibal n'était-il pas à notre porte ? ». Mais il y avait des fedayis et des soldats qui étaient prêts à sacrifier leur vie, et c'était notre consolation.
Nous nous présentâmes à l'état-major d'Alexandropol ; ici aussi, on nous dit d'attendre, jusqu'à leur décision.
Nous apprîmes qu'Andranik était venu à Alexandropol avec ses soldats et un groupe de réfugiés arméniens occidentaux. Puis nous apprîmes qu'il avait demandé des armes et des munitions à l'état-major, on ne les lui avait pas données, il avait fait ouvrir un dépôt d'armes et avait pris des armes. Plus tard, nous apprîmes aussi qu'Andranik était parti avec son groupe pour Karakilisa.
Nous apprîmes que Kars était tombé ET que les Turcs avançaient vers Alexandropol.
Quand nous nous présentâmes à l'état-major, on nous ordonna de partir pour Karakilisa. « Pourquoi ne pas rester ici, les Turcs avancent, nous nous battrons », dis-je. « On a plus besoin de vous à Karakilisa », dirent-ils. « Stépan, dis-je à mon camarade, ils nous épargnent, à cause de notre âge. » « Faisons ce qu'ils ordonnent », dit Stépan.
Jeétais passé auparavant par Karakilisa en train, chaque fois, l'air était humide, souvent pluvieux.
Nous nous présentâmes aussi à l'état-major de là-bas. « On vous place aux téléphones », dirent-ils. « Nous sommes prêts à combattre dans les rangs, nous avons de l'entraînement au fusil », dis-je. « Vous savez, les jeunes, les fedayis et les soldats ne connaissent ni l'arménien régulier, ni même un peu de russe. Mais vous, vous maîtrisez ces deux-là, donc vous êtes aptes au téléphone. Le téléphone sur le champ de bataille est tout aussi important, peut-être même plus, que le rôle d'un simple soldat », dit le fonctionnaire, nous désarmant par son raisonnement.
Les événements se déroulaient à une vitesse vertigineuse. Nous apprîmes qu'Andranik était monté au village de Dsegh, que les Turcs s'étaient approchés d'Alexandropol ; des fuyards, des réfugiés. Karakilisa grouillait de soldats déserteurs, de foules de paysans ; tous étaient sombres, inquiets. Nous apprîmes que le général Nazarbekov était nommé commandant de ce front, russophone, mais ardent patriote et doté de l'expérience des combats, des batailles. Et que le général Nazarbekov avait proposé à Andranik de participer au combat, mais Andranik avait prétexté ne pas avoir suffisamment de munitions. On disait qu'Andranik avait près de deux mille combattants.
Et voici que le 24 Mai, les montagnes et les forêts de Karakilisa résonnèrent du tonnerre des fusils, des mitrailleuses et des canons. Nous, au téléphone, nous nous trouvions à l'arrière des combattants et transmettions les ordres existants vers les hauteurs indiquées par des numéros. Nous étions extrêmement prudents pour transmettre les ordres avec précision.
Le but des Turcs était d'abord de s'emparer de la voie ferrée. Nos positions se trouvaient à gauche ET, surtout, à droite de la voie ferrée. La nuit, les combats cessaient un peu, mais le sommeil ne nous venait pas aux yeux ; nous nous assoupissions, nous nous réveillions soudain, saisissant le fusil.
Nous apprîmes que les Turcs avaient fait passer des troupes par la voie ferrée vers la route Chamkhor-Bakou ; mais les nôtres tenaient fermement les positions du côté droit de la voie ferrée. Cette angoisse dura trois jours, la terre et le ciel tonnaient. Les fedayis et soldats arméniens combattaient vaillamment ; c'était un combat de vie ou de mort.
Des rumeurs circulèrent selon lesquelles les nôtres avaient eu des succès sur les fronts de Bash Abaran et de Sardarapat, que les Turcs n'avaient pas réussi dans leur objectif principal... Les rumeurs devinrent de plus en plus précises, l'enthousiasme grandit.
Mais pour autant que je sache, la bataille de Karakilisa ne peut pas être considérée comme une victoire complète, parce que les Turcs avaient réussi à faire passer des troupes en direction de Bakou.
Après la bataille de Karakilisa, nous apprîmes avec une grande douleur que notre incomparable Monia Ohanjanian était tombé sur les premières lignes... Toute la nuit, je ne pus fermer l'œil. Je me souvins de ma première rencontre avec lui à Tiflis, puis au congrès estudiantin, à Bakou. Puis de nouveau à Tiflis, dans la salle de l'Administration Municipale, quand Monia lança l'appel à s'enrôler comme volontaires. Puis à Sarikamich, devant l'état-major, notre dernière rencontre....
COMMÉMORATIF
3. ACTIVITÉ DANS LA DIASPORA ARMÉNIENNE DE FRANCE - 2ÈME PARTIE DES ANNÉES 1920 [A.]
DROCHAK, 11e année, N° 11, 17 Septembre, 1986, pages 16-18 (384-386).
J'ai présenté mes diplômes du Séminaire « Guéorguian » et de l'Université de Prague à l'Université de la Sorbonne avec une demande. Une semaine plus tard, ma candidature fut acceptée.
Le diplôme du Séminaire était très estimé dans toutes les universités européennes et de nombreux Arméniens en Europe recevaient leur formation universitaire, comme par exemple les diplômés du séminaire : Vahan Issorènine (diplômé de l'Université de Berlin), Archag Jamalian également, Avédis Aharonian de Suisse ; Roubèn Ter Minassian de Suisse et beaucoup d'autres.
J'ai commencé à étudier la langue française avec un amour particulier et je ne manquais pas spécialement les conférences du célèbre économiste-coopératiste Charles Gide.
Avédis Aharonian avait réussi à obtenir une bourse pour moi auprès d'un particulier arménien nommé Dikran Khan Kélékian.
En effet, Aharonian avait une affection particulière pour les Arméniens de Perse.
- André, - me dit un jour Aharonian, tu seras mon secrétaire personnel, tu sais que mon écriture est quasi illisible, j'ai besoin de quelqu'un qui écrive clairement, je dicterai, tu écriras.
Ainsi fut-il. Il racontait lui-même à propos d'Andranik, et je prenais des notes. Plus tard, j'ai corrigé les épreuves de son volume « Mon Livre ».
La femme d'Aharonian, Nouart, était la sœur du camarade Mikayël Varandian. Son premier mari, Jhamharian, était tombé à Chouchi, lors des affrontements arméno-turcs. Aharonian avait trois fils de sa première femme : Vartkès (il était rédacteur-activiste en Amérique), Vourik et Babik. Ces deux derniers étaient des garçons doués, mais indisciplinés. Ils connaissaient l'arménien, le russe, le français, et Babik aussi l'anglais. Un temps, Aharonian commença à étudier l'anglais, il disait : –
- Mon petit gamin, ce Babik, il n'y a pas un mot qu'il ne connaisse. C'est à lui que je demande les mots.
Aharonian avait un appartement de deux pièces, l'une était la chambre à coucher, l'autre le salon-salle à manger. C'étaient de petites pièces, donc les deux garçons vivaient dans des chambres louées. C'est moi qui portais le loyer de leurs chambres, qui payais ; Aharonian disait : –
- Si je le leur donne en main propre, ils le dépenseront aussitôt...
La femme de Vartkès Aharonian était la poétesse Armenouhi Dignanian– Aharonian.
J'étais fasciné par la littérature d'Aharonian dès mon temps d'élève. Son arménien beau et parfait, riche, a influencé mon propre arménien. J'avais lu plusieurs fois son livre « En Italie » qui est une description riche et captivante des lieux et monuments historiques d'Italie. Quand je lui en parlai, il dit :
- Imagine que j'ai écrit ce livre en deux semaines.
֍
Aharonian raconta que l'Ishkhan (le Prince, surnom de Nikol Douman) était gravement malade et très affaibli ; c'était son cœur qui était malade. Nous décidâmes de lui rendre visite ; il vivait dans le quartier de Chaville.
Quand nous montâmes dans le tramway électrique, le regard de tous les Français se tourna vers Aharonian, tant son apparence était impressionnante ; en parlant aussi, il avait une voix grave et de belles phrases. Il avait une apparence typiquement arménienne. En le regardant, j'imaginais Vartan Mamigonian ; celui-ci était un homme d'épée, Aharonian un homme de plume, tous deux de fervents patriotes, des Arméniens éminents, avec des traits de lignée.
En allant chez l'Ishkhan, Aharonian me prépara, disant :
- Autant que tu peux, imagine le pire, pour ne pas être pris au dépourvu.
Quand nous entrâmes dans la pièce, je fus simplement choqué....
Il ne restait rien du majestueux Ishkhan : un tas d'os. Assis comme un poussin dans son lit. Aharonian me regarda, vit que j'étais très ému, commença à occuper l'Ishkhan, pour que je me repose un peu. Était-ce là l'Ishkhan de Khanasor... vie injuste.
- Ishkhan, - dit Aharonian, - notre jeune camarade André a voulu te rendre visite, il est maintenant installé à Paris.
L'Ishkhan sourit, satisfait, - merci - dit-il. Puis il s'enquit de mon oncle, Smbat Melik Vardanian, qui avait été dans le corps diplomatique, à Téhéran. Je dis qu'il était à Téhéran, qu'il avait maintenant ouvert une boulangerie.
Jusqu'à maintenant, l'Ishkhan est devant mes yeux : décharné, squelettique, recroquevillé dans son lit.
A peine un mois plus tard, l'Ishkhan mourut. Pendant l'enterrement, sa femme, l'Ishkhanouhi (Satenik, Tsaghik) disait en pleurant : « Je t'ai envoyé devant les balles, je n'ai pas eu de chagrin. Ishkhaⁿn, devais-tu mourir ainsi, où vas-tu ? ». Je vis le camarade Archag Jamalian pleurer à chaudes larmes. Nous pleurions tous déjà devant la mort du fidèle fedayi, du fervent patriote.
Une autre tragédie était que la terre de la tombe avait été achetée pour six mille francs, et quelques années plus tard, il fallait racheter la terre, sinon on enterrerait un autre mort sur ce cercueil.... Voilà la loi, et cela dans un quartier comme Chaville.
L'éloge funèbre fut prononcé par Jamalian, au nom du Bureau, il termina en pleurant.
J'avais lu que lorsque l'Ishkhan et un groupe de fedayis étaient assiégés dans le monastère de Derik, la femme de l'Ishkhan, Tsaghik (Satenik), chargeait les fusils des fedayis, et maintenant je voyais que le bout de sa chaussure était usé et que son doigt apparaissait... Je vécus moi aussi ma tragédie à cause de cette scène. C'est la fin d'un révolutionnaire arménien, pensai-je, et mes convictions s'affermirent encore plus en moi. N'allais-je pas aller en Arménie ? Le révolutionnaire arménien est en paix avec toutes les difficultés de la vie et l'idée de la mort.
֍
Après la 10e Assemblée Générale, le Bureau avait chargé le Dr. Armenag Melik Barséghian de parcourir les villes de France habitées par des Arméniens et d'enregistrer les membres du parti, de former des comités, afin qu'une Assemblée Régionale soit convoquée et qu'un Comité Central soit élu. Jusque-là, il n'y avait pas de Comité Central.
Lors d'une réunion du comité de Paris, je fus élu délégué pour l'Assemblée Régionale.
Les délégués à l'Assemblée Régionale étaient : Archag Jamalian (de la part du Bureau), le Dr. Armenag Melik Barséghian, Vahagn Krmoyan, Papazian, Vahan Hambardzumian (ancien diplômé du séminaire), Hrant Samuel, Benik Miltonian, Chatikian (de Marseille), Abo (Baghdasar) Aboyan, Andranik Ter Ohanian, Grigor Dzamoyan et trois ou quatre autres camarades dont je ne me souviens pas des noms.
Parmi ces camarades, le désagréable était Abo Aboyan, qui donnait l'impression d'un Juif flatteur, toujours avec un sourire narquois sur son visage. (C'est lui qui, plus tard, lança le mouvement dit « Martkotsagan », qui avait un caractère fractionnel et se termina par leur déshonneur ; à ce sujet, plus tard).
Les points de l'ordre du jour, relatifs à la vie organisationnelle et à l'organisation de la colonie arménienne, furent résolus par des résolutions appropriées. Vint le tour de l'élection du premier Comité Central pour l'Europe Occidentale.
Un comité de cinq membres fut élu : Vahagn Krmoyan, Benik Miltonian, Abo Aboyan, Hrant Samuel, André Ter Ohanian.
Immédiatement après l'assemblée eut lieu la première séance du Comité Central, Vahagn Krmoyan fut élu président ; le camarade Jamalian proposa ma candidature pour le secrétariat ; quand je commençai à prendre des notes de l'assemblée, Aboyan objecta que j'écrivais en arménien oriental, qu'il fallait rédiger les procès-verbaux en arménien occidental. Il était fractionnel, donc je refusai catégoriquement ; on nomma le camarade Hrant Samuel comme secrétaire.
Après deux ou trois séances, Vahagn Krmoyan démissionna du Comité Central ; quand je lui demandai en privé la raison, il dit : « Je ne peux pas travailler avec cet Aboyan... » Aboyan fut nommé président, et à la place de Krmoyan, le candidat Vahan Hambardzumian fut invité.
En ces années, les bolcheviks arméniens de Paris et de la province provoquaient des troubles, pour perturber nos manifestations. Des camarades racontaient qu'à Paris, ils avaient essayé de perturber une de nos manifestations par des cris et en distribuant des tracts, quand Arch (l'Ours) Petros était sorti seul contre eux et, avec sa force terrifiante, les avait attrapés et jetés en bas des escaliers de la salle comme des coussins... Un de ceux qui avaient essayé de perturber était l'ancien Hntchag Achot Patmagrian, qu'Arch Petros avait également jeté en bas. La manifestation eut lieu et ensuite, à Paris, ils n'essayèrent plus de perturber nos manifestations.
Nous avons pris comme responsable régional pour le Comité Central d'Europe Occidentale Mesrop Gouyumdjian, qui était un orateur long et fluide.
- Si dans la province aussi les bolcheviks essaient de perturber nos manifestations, il faut se défendre, contre-attaquer, - disait Benik Miltonian, énervé.
En ces années, les bolcheviks publiaient un journal nommé « Erevan », dont ils avaient envoyé comme rédacteur depuis l'Arménie Elia Tchoubar, avec qui j'avais participé au congrès estudiantin de Bakou. En ces jours, E. Tchoubar avait commencé un de ses discours par « Pendant mille ans et même plus, le Tatar s'est agenouillé sur notre poitrine » (de A. Hsahagian), et maintenant il était venu à Paris prêcher l'internationalisme. Je ne voulus pas le rencontrer. Le journal « Erevan » provoquait des troubles et divisait la colonie arménienne.
Nous envoyions des camarades en vue dans la province, pour donner des conférences. Pour notre manifestation qui devait avoir lieu à Lyon le 2 mai 1926, le Comité Central envoya dans la ville de Lyon le camarade Avédis Aharonian.
Le 2 mai, je pris un journal français, j'entrai dans le métro. En regardant le journal, mon œil tomba sur un communiqué en gros caractères :
Lyon. - Affrontement sanglant - troubles parmi les Arméniens...
Immédiatement, j'allai à la Délégation de la République, j'annonçai la chose et montrai le journal ; je demandai au camarade Khatissian, par l'intermédiaire du secrétaire Artavazd Hanumian, de contacter nos camarades de Lyon et de savoir ce qui s'était passé. Je téléphonai aux camarades du Comité Central, et je me précipitai moi-même à l'appartement d'Aharonian. À la porte, je rencontrai le camarade Mikayël Varandian, je lui montrai le journal et dis que j'étais allé au bureau de la délégation et avais demandé de contacter Lyon par téléphone. Varandian dit : « Montons. Mais que Nouart ne sache rien de ce qui est arrivé, attendons Avédis. »
Nous montâmes, chez Mme Nouart. Peu après, elle sembla sentir quelque chose à nos visages inquiets. Elle demanda :
- Vous avez l'air triste, qu'est-il arrivé ?
Varandian dit : « Rien, Avédis doit venir aujourd'hui, nous sommes venus le voir »...
Vers le soir, Aharonian arriva, la joue gauche bleuie... Varandian se précipita sur lui, l'embrassa, se mit à l'embrasser. Quand Mme Nouart vit le visage bleui d'Aharonian - Avédis, qu'est-il arrivé ? - s'écria-t-elle.
Aharonian commença à raconter :
- Vous savez que nous avions une manifestation à Lyon. Apparemment, les bolcheviks arméniens avaient amené des communistes marocains, algériens, italiens, en avaient fait entrer une partie dans les loges du haut, l'autre partie près de l'entrée de la salle. Quand je montai sur l'estrade - je commençai à parler, cet élément cria : « À bas le fascisme ! », puis l'un d'eux s'élança sur l'estrade et m'attaqua, me frappa la joue gauche avec son poing. Un instant, ma main alla à ma poche (Aharonian avait un petit pistolet Browning. A.A.), mais je me retins. À cet instant, quelques garçons de notre public s'élancèrent sur l'estrade et se mirent à frapper l'étranger qui m'avait attaqué et à le faire descendre de l'estrade. Quelques autres personnes m'entourèrent aussi, pour me protéger d'une nouvelle attaque.
La salle fut sens dessus dessous, les spectateurs assis commencèrent à expulser la foule bolchevique, et à la porte de la salle, près de deux cents personnes eurent des affrontements. Les nôtres infligèrent une telle raclée aux attaquants étrangers que ceux-ci prirent la fuite avec des vêtements déchirés. La colère du peuple était grande contre cette attaque lâche.
Varandian se leva à nouveau, embrassa la joue blessée d'Aharonian, disant : « Tu ne peux pas imaginer à quel point nous étions inquiets, moi et André, nous n'avons rien dit à Nouart, pour qu'elle ne s'inquiète pas. »
Le même soir, nous eûmes une séance du Comité Central. Pendant l'affrontement de Lyon, la police avait arrêté sept de nos camarades. Pendant l'affrontement, un jeune bolchevik nommé Baghdasarian avait été tué (le journal « Erevan » fit grand bruit à propos du « travailleur Baghdasarian »). Il ne tenait pas compte du fait que la majorité des spectateurs étaient des travailleurs.
Il fut décidé que le camarade Hrant Samuel, en tant qu'avocat familier des affaires judiciaires, se rendrait à Lyon, pour engager un avocat français, faire libérer nos camarades de prison, et on m'envoya aussi, pour encourager les camarades, remonter le moral.
Hrant Samuel partit pour Lyon, et un jour après, je partis aussi. Les camarades s'étaient rassemblés dans une chambre mansardée ; quand j'entrai, tous se levèrent et crièrent à l'unisson : « Vive la FRA ! »... Le moral était élevé. Je parlai de la lâche attaque, à laquelle les bolcheviks arméniens avaient associé des étrangers ; mais comme ils avaient reçu une leçon à Paris, de même à Lyon et désormais ils allaient reprendre leurs esprits. Les foules arméniennes sont avec la Fédération Révolutionnaire Arménienne, la manifestation de Lyon l'a prouvé.
Mon discours fut accueilli par des applaudissements nourris. Pendant mon discours, je vis que Hrant Samuel se retira dans la pièce d'à côté ; plus tard, quand je lui en demandai la raison, il dit qu'il devait traiter avec le tribunal et peut-être la police, pour libérer les camarades ; donc sa présence à cette réunion pourrait causer des désagréments... Hrant était très prudent.
La police libéra sous caution les camarades emprisonnés quelques jours plus tard ; on n'avait pas pu trouver l'auteur du meurtre.
Après cet incident, les bolcheviks n'osèrent plus perturber nos manifestations dans la province non plus.
En ces jours, le poète Avétic Hsahagian était venu de l'Arménie à Paris pour une affaire de l'Union Arménienne de Bienfaisance (HOK). Les Ramgavar (Démocrates libéraux) avaient écrit une circulaire à propos de l'incident de Lyon et en avaient rejeté la faute sur Avédis Aharonian ; Avétic Hsahagian avait aussi signé la circulaire... Quand Aharonian lui avait demandé pourquoi il avait signé, Hsahagian avait répondu : « Je n'ai pas lu ce qui était écrit, on m'a dit : signe cette circulaire »...
֍
Nous déjeunions au restaurant « Prix Fixe » du boulevard Saint-Michel. Le déjeuner coûtait 3,50 francs, le pain était illimité. Parfois, un Arménien de Perse venait à Paris, je l'emmenais au musée, dans les lieux de promenade et c'était toujours moi qui dépensais ; après cela, pendant quelques jours, je me nourrissais dans la rue avec de la saucisse (saucisson) faite de viande de cheval vendue sur pied.
Un jour, le soir, alors que nous n'avions rien mangé de la journée, nous descendions Saint-Michel avec un camarade ; alors que nous devions passer devant le « Café de la Source », Avédis Aharonian, assis à la table devant le café, nous voyant, nous appela et dit :
- André, votre visage montre que vous n'avez rien mangé aujourd'hui. Est-ce vrai... ?
- C'est vrai... dis-je.
- Venez, asseyez-vous, - dit Aharonian et commanda immédiatement pour nous du café au lait et des croissants.
La journée, je m'occupais à écouter des conférences, l'après-midi j'étais à la bibliothèque. Je lisais avidement. Un peu plus haut que Saint-Michel, il y avait aussi une bibliothèque russe, où, disait-on, Lénine aussi avait fréquenté. Les bibliothèques française et russe étaient très riches. Les nuits, je lisais dans ma chambre. Ceux qui voulaient me voir savaient qu'ils me trouveraient à la bibliothèque.
C'est à la bibliothèque française que je résumai le premier volume du « Capital » de Karl Marx dans les cent pages de mon cahier. Je lisais des écrits sur les anarchistes Kropotkine et Mikhaïl Bakounine. Les travaux de l'Autrichien Otto Bauer, théoricien-socialiste renommé, de l'Allemand Eduard Bernstein, de E. David, des anarchistes italiens Cafiero, Carlo, Costa, Malatesta. Et j'écoutais les socialistes français pendant leurs conférences publiques et leurs interventions, la plupart du temps avec mon cher ami, l'écrivain Vazguèn Chouchanian.
Il arrivait que des membres de factions de gauche ou de droite fassent irruption dans la salle de conférence des socialistes, fassent du bruit, perturbent, une fois même ils brisèrent les miroirs et les vitres de la salle. Je saisis le bras de Vazguèn Chouchanian et le fis sortir de la salle en disant : « Nous, Arméniens, avons subi beaucoup de pertes, nous n'avons pas besoin d'en subir ici aussi. » Vazguèn rit de sa manière particulière et nous quittâmes la salle.
4. ACTIVITÉ DANS LA DIASPORA ARMÉNIENNE DE FRANCE - 2ÈME PARTIE DES ANNÉES 1920 [B.]
DROCHAK, 11e année, N° 14, 29 Octobre, 1986, pages 16-17 (516-517).
Nous étions assis un jour au « Café de la Source » - Hambardzum Grigorian, Vazguèn Chouchanian et moi - quand le poète Ostanik entra, haletant, disant : « L'écrivain Costan Zarian est venu de Bruxelles à Paris avec sa femme et sa fille, ils sont assis dans une chambre d'hôtel sans nourriture. Donnez-moi quelques francs, j'achèterai du pain et du fromage à leur apporter, c'est triste. Zarian est un grand intellectuel, dans le passé il a collaboré avec Siamanto et D. Varoujan, à Constantinople... ». Nous fûmes touchés, chacun de nous donna quelques francs à Ostanik, qui partit.
Les jours suivants, C. Zarian aussi commença à fréquenter notre café ; nous fîmes connaissance, un jour je lui posai une question :
- Monsieur Zarian, comment se fait-il que vous soyez venu d'Arménie et que vous ne soyez pas retourné ? Il raconta ce qui suit :
- Vous savez que j'avais été invité en Arménie comme conférencier universitaire. Une fois, j'allai à Tiflis, au retour, dans mon compartiment, quelques voyageurs arméniens commencèrent à se plaindre de leur situation économique difficile. Quand le train arriva en gare d'Alexandropol, quelques tchékistes montèrent dans le train et, arrêtant les voyageurs de mon compartiment, les firent descendre du train et les emmenèrent en prison. Là, dans mon esprit, je décidai de quitter l'Arménie soviétique pour un pays libre et j'y parvins, je vins en Europe.
Nous n'étions pas en mesure de donner de l'argent à chaque fois pour que C. Zarian puisse manger ; donc un jour je dis à Ostanik :
- Demande-lui, si je m'entremets pour que Costan Zarian collabore à notre mensuel « Hayrenik » de Boston et reçoive des honoraires, acceptera-t-il ?
Ostanik avait parlé, il vint dire : il est d'accord.
J'allai immédiatement chez Aharonian, racontai ce qui s'était passé et le priai d'écrire au rédacteur en chef de « Hayrenik », le camarade Roubèn Darbinian, et de demander son accord. La revue « Hayrenik » payait vingt dollars par mois comme honoraires aux intellectuels collaborateurs, ce qui sauverait C. Zarian.
Aharonian écrivit immédiatement une lettre, lui aussi était ému.
A peine deux semaines s'étaient écoulées qu'une lettre de Roubèn Darbinian fut reçue ; il avait écrit à Aharonian qu'il accepterait avec plaisir la collaboration de Costan Zarian.
J'annonçai moi-même cela à Costan Zarian, qui en fut très satisfait. Il se mit à écrire.
Dans la revue « Hayrenik » commencèrent à paraître « La Banqueroute et les os de Mammouth », « Terres et Dieux » de Costan Zarian, qui suscitèrent un très grand intérêt. Plus tard aussi, en puisant des souvenirs de Roubèn, il écrivit « La Belle-fille de Tatragom », etc.
À Paris, le représentant commercial du « Torgpred » soviétique était le bolchevik Simonik Piroumian. Chez lui allaient et venaient : Hamlik Toumanian (le fils de Hovhannès Toumanian), qui avait été transféré de Londres à Paris, et Achot Patmagrian, qui avait été transféré de Berlin.
Nous remarquâmes qu'Ostanik et Eghiché Aïvazian commencèrent à faire des dépenses somptueuses ; Eghiché avait acheté un chapeau melon pour cent vingt francs, ce qui était une très grosse somme pour un homme sans emploi.
De même aussi Arpiar Aslanian (parmi les étudiants exilés) et sa femme, la lettrée Lass, qui était de « gauche »...
Je fis part un jour de mon soupçon à Hambardzum ; je dis que le camarade Hayk Asatrian à Prague m'avait raconté que, lorsqu'il était à Berlin, il avait appris que certains étudiants arméniens recevaient de l'argent des Soviétiques, à condition de partir en Arménie après leurs études, et il avait même donné le nom de Grigor Ter Andréassian, qui était de mes camarades de classe du séminaire.
Hambardzum confirma mon soupçon.
Un jour, Hambardzum me raconta qu'il avait rencontré Hamlik Toumanian dans la rue, que celui-ci avait dit que l'on payait vingt dollars par mois aux étudiants, mais que pour toi et André nous paierons cinquante dollars ; parle avec André.
Je me fâchai qu'on veuille faire de moi un objet de commerce ; insulter mes convictions. Je dis à Hambardzum de prendre rendez-vous avec Hamlik.
Hambardzum prit rendez-vous, nous nous rencontrâmes dans la rue près du jardin du Luxembourg.
- Dis-moi, Hamlik, qu'allais-tu dire ? - dis-je.
Hamlik commença à parler de la République d'Arménie de manière négative, quand il ajouta, que les ministres dashnaks.... volaient de la farine, je me jetai sur Hamlik ; Hambardzum intervint, Hamlik commença à fuir de toutes ses forces.
- En vain tu ne m'as pas laissé lui donner une bonne leçon - dis-je en colère à Hambardzum. « Que cela lui serve au moins de leçon », - dit Hambardzum.
Quelques jours plus tard, Hambardzum me dit :
- J'ai rencontré Hamlik, il a dit : « Si tout le monde était comme toi et André, nous n'aurions pas de succès... ».
C'était déjà évident pour nous que les bolcheviks recrutaient des espions sous le nom d'étudiants. J'allai au bureau du Bureau et expliquai la situation aux camarades S. Vratsian, Roubèn et Jamalian, et dis que E. Aïvazian et Ostanik devaient être écartés de notre groupe du parti. Le Bureau, par une circulaire, les déclara exclus tous les deux.
Les bolcheviks persuadent Ostanik d'aller en Arménie. Ils lui donneront une lettre de recommandation et paieront aussi les frais. Ils disent : « Tu es poète, tu iras, là-bas on te mettra en avant... ».
Ostanik part via l'Italie. Tout le monde savait déjà qu'Ostanik était parti pour l'Arménie.
Un jour, soudain, nous vîmes Ostanik à Paris...
Nous entrâmes au café tous les deux. Sa première parole fut :
- André, tu avais raison, je recevais de l'argent, une fois même j'ai reçu un chèque de mille deux cents francs d'Achot Patmagrian, en plus des frais de voyage. Quand j'arrivai en Italie, on m'avait remis une lettre de recommandation fermée, à présenter à Erevan. Je m'intéressais à ce qui était écrit dans la lettre, je l'ouvris et que lis-je ? Il était écrit : « Ne faites pas attention à ce gamin »...
Immédiatement, je décidai de revenir en arrière et ici je leur dis que j'avais été volé en chemin, qu'on m'avait volé mon argent et tout... Sachez-le ainsi.
Deux jours plus tard, Eghiché Aïvazian me rencontra et me demanda d'entrer au café. Lui aussi avoua qu'il avait reçu de l'argent, que j'avais eu raison.
Bien que nous ayons pardonné à tous les deux, nous ne les avons plus admis dans nos rangs.
Vazguèn était un jeune homme de taille moyenne, au corps plein, aux grands yeux noirs, aux joues roses, à la peau blanche, dès le premier instant de notre rencontre nous devînmes intimes. Il était l'un des orphelins du Génocide d'Avril ; il avait passé des années dans des orphelinats, puis on l'avait transféré dans un orphelinat d'Arménie, finalement il était venu à l'étranger, avait terminé les cours d'agriculture de Montpellier, mais avait peu pratiqué sa profession. Il était venu à Paris, s'occupait de lecture et d'écriture. Son aspect matériel était assuré par son camarade d'orphelinat Sépouh, qui se trouvait en Égypte. Il s'intéressait aux sciences sociales, c'était un socialiste fervent ; c'est pourquoi nous étions toujours présents avec lui aux interventions des socialistes français, qui parfois se terminaient par des bagarres, par des interventions perturbatrices de la droite ou de la gauche.
Les soirs tard, nous sortions nous promener avec Vazguèn sur les boulevards illuminés ou dans le jardin du Luxembourg, et Vazguèn récitait son passage préféré de Missak Medzarents :
« La nuit est douce, la nuit est voluptueuse,
Ointe de haschisch et de baume,
Je passerai ivre par le chemin lumineux,
La nuit est douce, la nuit est voluptueuse »...
Vazguèn avait un cœur pur et un caractère pur. Lui non plus, les bolcheviks ne purent le soumettre à une tentation matérielle.
Parfois, quand Artsrouni Toulian était avec nous, il ennuyait Vazguèn ; une fois, il frappa Vazguèn dans le dos et s'enfuit. « André, vois, il est sournois, hé, il frappe par derrière », disait Vazguèn et riait de son rire particulier, plein de poitrine.
Avec Vazguèn, nous lisions aussi des œuvres de poètes français célèbres, récitant parfois par cœur des passages de Baudelaire, Alfred de Musset, Paul Verlaine.
Derrière la place Saint-Michel se trouvait la caverne des célèbres Apaches français (classe aux mœurs de voyous) ; c'était l'endroit préféré de Vazguèn, bien que dangereux. Le poète Paul Verlaine, qui était aussi un ivrogne, avait souvent visité la caverne des Apaches, sur les murs de laquelle il avait écrit son nom. Vazguèn montrait avec ardeur les signatures de Verlaine et d'autres poètes et s'exclamait : « Vois, ces poètes aimaient les Apaches... » et se réjouissait de marcher lui aussi sur les traces de poètes célèbres.
Quand j'entrai pour la première fois dans la caverne des Apaches, les murs secs et de pierre et les excavations me firent une impression pesante. Nous descendîmes par des escaliers étroits et pierreux et pénétrâmes dans une petite caverne, où il y avait une petite table grossière et quelques tabourets grossiers sans dossier. Dans la petite pièce-caverne voisine étaient assis 3-4 Apaches, qui nous regardèrent d'abord avec un regard furieux, puis nous ignorèrent. Vazguèn me raconta que les Apaches volaient certains clients juste ici...
Nous commandâmes de la bière, en bûmes et sortîmes. Moi, qui avais eu une impression pesante en entrant la première fois, je devins maintenant amoureux de la caverne des Apaches et ensuite je disais parfois à Vazguèn : « Vazguèn, si on allait à la caverne des Apaches ? ». Il se réjouissait et nous y allions. Les Apaches nous reconnaissaient déjà et ne nous jetaient pas de regards hostiles.
« Comment se fait-il que ton nom de famille soit féminin : Chouchanian » demandai-je un jour à Vazguèn.
« J'ai entendu de mes parents que ma grand-mère était une femme très intelligente et influente, donc les nôtres ont décidé d'utiliser son nom comme nom de famille », répondit Vazguèn.
Vazguèn écrivait ses œuvres littéraires et ses articles dans un petit café qui se trouvait près du « Café de la Source ». Quand je voulais le rencontrer, j'allais à ce café ; dans un coin, assis près d'une petite table, il écrivait, son écriture était aussi menue.
Artsrouni Toulian disputait parfois avec Vazguèn au sujet de ses points de vue. Une fois, quand j'étais malade, couché dans ma chambre, lors d'une réunion Artsrouni avait accusé Vazguèn pour son point de vue. Ils vinrent me voir, pour connaître mon opinion. Quand j'écoutai, je dis : « La Fédération Révolutionnaire Arménienne prêche la liberté de pensée, de parole et de plume. Si les points de vue d'un membre de la FRA ne contredisent pas la conduite politique, il est libre de s'exprimer. S'il a un point de vue différent de la conduite politique, alors tout membre de la FRA peut exprimer ses points de vue dans les réunions six mois avant l'Assemblée Générale, si l'Assemblée Générale les approuve, c'est bien. Et si elle ne les approuve pas, le point de vue restera écrit dans les procès-verbaux, et lui-même se soumettra aux décisions de l'Assemblée Générale. »
Vazguèn resta satisfait de cette déclaration de ma part.
5. ACTIVITÉ DANS LA DIASPORA ARMÉNIENNE DE FRANCE - 2ÈME PARTIE DES ANNÉES 1920 [C.]
DROCHAK, 11e année, N° 15, 12 Novembre, 1986, pages 13-14 (557-558).
En 1927, on avait demandé un responsable depuis Buenos Aires (Amérique du Sud), pour organiser la région et fonder un journal. On avait donné mon nom. Je dis au camarade Roubèn que je devais partir pour le pays (l'Arménie). Je le lui avais dit, par conséquent je ne pouvais pas partir pour Buenos Aires. Roubèn dit : - « Tu as raison, nous leur écrirons que tu ne peux pas y aller, pour des raisons de santé. Toi, tu dois aller au pays. Déjà, notre lien avec le pays est rompu. »
On envoya le camarade Tadéos Medzadourian (parent de Missak Medzarents) ; il resta un an pour des affaires d'organisation, mais il ne pouvait pas être rédacteur.
Quand mon tour vint de partir pour l'Arménie (en Juin 1928), nous répandîmes la nouvelle que je partais pour Buenos Aires, comme responsable-rédacteur (Medzadourian était déjà revenu). Je ne dis même pas à mes camarades les plus proches que je partais pour l'Arménie, seul Artsrouni Toulian le savait, parce qu'il était allé au pays et était revenu ; nous avions participé ensemble à la 10e Assemblée Générale.
Les jours de mon départ, Vazguèn vint avec un paquet à la main, et me le tendant, dit : - « Nous avons été si intimes, à l'occasion de ton départ, accepte ce petit cadeau »... Le cadeau était un vêtement d'automne. Je fus ému. « Vazguèn, mon cher, pourquoi as-tu fait une telle dépense, c'est lourd pour toi », dis-je. « Je te prie de ne pas refuser, c'est un cadeau amical », dit-il, et il m'offrit aussi sa photo.
Des mois plus tard, quand il avait appris que j'étais parti pour l'Arménie et avais été emprisonné, en 1930, quand je fus expulsé d'Union Soviétique vers la Perse, Vazguèn écrivit immédiatement une lettre, exprimant sa joie que je sois libéré, il avait encore envoyé une autre photo.
Je conserve sa photo jusqu'à ce jour comme une relique, sur laquelle est écrit de sa main : « À mon cher André – de Vazguèn », Paris.
Du sud de la France, des jeunes venaient parfois à Paris, à peine de taille moyenne, au corps rond et trapu, Vazguèn me disait : - « André, regarde, hé, c'est de la marchandise d'orphelinat »... et, en effet, quand on vérifiait, ils avaient été dans des orphelinats.
Vazguèn Chouchanian se fit un nom dans la vie littéraire et jusqu'à maintenant encore ses écrits sont lus avec plaisir. Dommage qu'il soit mort prématurément. Je n'oublierai jamais mon cher Vazguèn Chouchanian et son doux ricanement.
L'Assemblée Déléguée Régionale de la FRA pour l'Europe Occidentale devait avoir lieu dans la ville de Lyon. Nous avions entendu qu'Abo (Baghdasar) Aboyan avait organisé des « mains » et devait avoir une intervention contre les responsables arméniens orientaux, avec une passion fractionnelle... Lors d'une réunion amicale du comité de Paris, on parla de cela, j'eus aussi une intervention, déclarant que la Fédération Révolutionnaire Arménienne ne reconnaissait ni les discriminations fractionnelles, ni celles de dénomination. Les camarades Guérasim Balayan et Armen Sassounian défendirent mon point de vue et insistèrent sur ma candidature, comme délégué. Avec moi étaient aussi Vazguèn Chouchanian, Mgrditch Erètsian, Guégham (qui écrivait de la poésie), Lévon Mozian et un autre camarade dont j'ai oublié le nom.
Lors de l'assemblée, le camarade S. Vratsian était présent de la part du Bureau, il se contint. Aboyan avait amené trente-trois « mains » qu'il avait organisées, en grande partie de jeunes nouveaux venus.
Chaque fois qu'Abo parlait, je demandais la parole et neutralisais l'impression de ce qu'il disait. L'assemblée s'était déjà habituée et après qu'Abo parlait, on disait : - « Maintenant André va demander la parole. »
De Lyon était venu un camarade âgé nommé Khkh Kakossian, de haute taille, au corps sec et osseux, les yeux vitreux. Pendant la pause de l'assemblée, on entendit du bruit du couloir ; quand nous descendîmes dans le couloir, on dit que Kakossian avait giflé Vazguèn Chouchanian et on nous avertit que Kakossi avait un pistolet sur lui. Je fus très affecté qu'un grossier Kakossian ait giflé un jeune camarade comme Vazguèn.
Lors de l'assemblée, je proposai qu'on interdise à Kakossian d'être présent pendant trois séances et qu'on confisque aussi son arme, la décision passa, mais quand vint le tour de confisquer l'arme, personne ne dit mot ; quand je vis que personne ne disait mot, je m'en chargeai. Tous attendaient impatiemment de voir ce qui allait se passer. Je passai dans la pièce voisine, où Kakossian était assis seul, je m'assis près de lui et dis : - « Camarade Kakossian, pour avoir giflé le camarade Vazguèn Chouchanian, l'assemblée a décidé de te priver de trois séances, en plus de cela, remets-moi ton arme. »
Kakossian, sans un mot, me remit le pistolet. Quand j'entrai dans l'assemblée et posai le pistolet sur la table de la présidence, tous furent étonnés. Je dis que le camarade Kakossian s'était soumis à l'instruction sans opposition et je proposai de réduire la punition de trois séances à deux.
L'assemblée en arriva là, que les trente-trois « mains » organisées par Abo furent détruites. Mesrop Gouyumdjian, qui était le bras droit d'Abo, me demanda d'aller dans la pièce voisine. « Camarade André, je vous prie de m'épargner », dit-il. « Camarade Gouyumdjian, - dis-je - je n'ai rien contre toi, mais la conduite d'Aboyan est divisionniste et je suis contre une conduite fractionnelle, et vous devez l'être aussi. »
Bref, Abo ne fut pas élu au Comité Central et, le nez baissé, partit pour Marseille. Moi aussi, je retirai ma candidature, d'abord parce que je devais partir pour l'Arménie, et aussi pour qu'on ne dise pas qu'il a renversé Aboyan pour être élu lui-même.
Quand nous retournâmes à Paris, Guérasim Balayan et Armen Sassounian exprimèrent leur satisfaction que j'aie neutralisé le divisionniste Aboyan.
Quand je rencontrai le camarade Roubèn, il dit : - « André, à Lyon vous êtes entré dans une bagarre... ». Je lui racontai ce qui s'était passé, la gifle de Kakossian et le désarmement. Roubèn resta satisfait.
Après mon départ pour l'Union Soviétique, Achot Artsrouni eut un affrontement avec Aboyan, Artsrouni lança une bouteille sur la tête d'Abo, le blessant.
C'est après mon départ que ce mouvement est appelé « Martkotsagan ». Ils fondent un journal à Marseille et exploitent le nom du chef de bande Smbat Baroyian (Smbat de Mouch, compagnon d'armes d'Andranik), qui était semi-lettré. Chahan Natali s'était aussi joint à ce mouvement. Finalement, il fut établi qu'Abo avait reçu de l'argent des bolcheviks, pour diviser la Fédération Révolutionnaire Arménienne... Benik Miltonian avait quitté Aboyan, Benik était une personnalité droite et pure, tandis que Mgrditch Erètsian et Lévon Mozian, qui lors de l'assemblée régionale étaient avec moi, étaient ensuite passés à collaborer avec Aboyan.
Abo part avec sa femme, Zarmik (c'était une femme très bavarde et médisante) pour l'Arménie soviétique, sur le conseil des bolcheviks. Un jour, la Tchéka l'appelle et dit :
« Répète ce discours que tu disais quand tu étais dashnak... ». Abo est stupéfait et se trouble. Le discours était le suivant : « Un jour, on demande à Staline comment il dirige deux cents millions du peuple russe. » Staline répond : « Ce sont deux cents millions d'ânes, que je monte et que je conduis... »
Abo et sa femme sont exilés en Sibérie, où il meurt dans la misère.
Un jour, lors d'une réunion amicale à Paris, Chahan eut une intervention et déclara : - « La Fédération Révolutionnaire Arménienne est devenue une écurie... ». Je demandai immédiatement la parole et déclarai : - « Je proteste contre l'expression du camarade Chahan. Sa parole est même hors de l'ordre du jour, je demande l'interrompre. » Le président de l'assemblée et les participants approuvèrent ma protestation et Chahan s'assit à sa place.
Le lendemain, j'allai au bureau du Bureau ; Roubèn était là et, énervé, je racontai au sujet de l'intervention de Chahan, ajoutant qu'il ne convenait pas à un membre du Bureau de comparer l'organisation à une écurie.
Roubèn dit : - « Il a d'autres choses aussi, que nous examinons. Nous y reviendrons aussi. »
Peu à peu, il fut révélé que 1) Chahan, ignorant la décision de l'Assemblée Générale, avait voyagé en première classe en bateau et en train, gaspillant l'argent du parti ; 2) En Amérique, il avait convoqué des réunions secrètes avec des camarades arméniens occidentaux, avait déclaré que la Turquie devait être détruite par des moyens scientifiques et avait collecté des fonds, les cachant secrètement des instances supérieures ; 3) Il s'était joint au mouvement « Martkotsagan », menant un travail destructeur, etc. ; 4) Le Bureau l'avait isolé – jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, pour examen.
L'Assemblée Générale (la 11e) expulsa Chahan de la Fédération Révolutionnaire Arménienne.
On composait « Mon Livre » d'Avédis Aharonian (Enfance) ; je corrigeais les épreuves. Nos dirigeants savaient que j'étais un correcteur infaillible. On commença à composer l'ouvrage du camarade S. Vratsian « La République d'Arménie » à l'imprimerie « Ghoukasov » ; la compositrice était Mlle Satto, qui composait sur une machine à composer (linotype) et faisait peu de fautes ; à la fin, quand Mlle Satto composait la préface, je vis que le camarade Vratsian avait aussi mentionné mon nom comme correcteur.
Je dis à Mlle Satto de ne pas composer mon nom. Le lendemain, quand j'allai à l'imprimerie, la préface était déjà imprimée.... Mlle Satto dit que Vratsian avait ordonné de absolument composer mon nom.
Le volume « La République d'Arménie » parut quasi sans faute. Le camarade Vahan Hambardzumian dit : - « Tu corriges plus consciencieusement que l'auteur lui-même. » J'écris à ce sujet, parce que surtout dans les dernières décennies, la presse et le livre sont pleins de fautes ; la langue arménienne a reculé ; ceux qui connaissent l'orthographe, on peut à peine les compter sur les doigts d'une main... Les livres que j'ai écrits moi-même, que j'ai moi-même corrigés, n'ont pas de fautes.
Vratsian voulut me rémunérer par l'intermédiaire d'Artsrouni pour la correction, je refusai d'avoir effectué une correction payante (j'avais aussi corrigé gratuitement le livre d'Aharonian). Artsrouni Toulian ensuite me joua un tour. Il savait que je devais partir pour le Pays ; un jour il dit : - « Tu vas aller au Pays, tu as besoin d'un imperméable (plastch). Moi, je n'en avais pas pris, j'en ai beaucoup eu besoin. » Cela me trotta dans la tête, nous allâmes au magasin, nous choisîmes un imperméable, Artsrouni courut immédiatement près du caissier pour payer ; j'arrivai derrière lui pour payer mon argent, il m'en empêcha en disant : « C'est le cadeau du camarade Vratsian, on ne refuse pas un cadeau... ».
Je dois dire que le vêtement offert par Vazguèn Chouchanian et l'imperméable offert par le camarade Vratsian s'usèrent dans les prisons soviétiques....
6. UN ACTIVISTE DE LA FRA À MOSCOU EN 1928
DROCHAK, 11e année, N° 21, 4 Février, 1987, pages 11-15 (835-838).
Avant mon départ, j'allai à la Délégation, pour faire mes adieux à Alexandre Khatissian. Lui aussi croyait que je partais pour Buenos Aires, comme responsable. Il commença à donner des noms et des adresses de connaissances, qui pourraient m'être utiles. « J'ai de vous, comme jeune responsable, de bonnes impressions. De ceux qui ont emprunté de l'argent à la Délégation, vous êtes le seul à l'avoir remboursé (à ce sujet, Khatissian l'avait aussi dit à Lévon Naïrtzi, qui me le dit). »
J'étais dans une situation gênante, où j'allais, où mes camarades croyaient que j'allais. La femme de Khatissian était russe, très modeste, polie et le sourire au visage, ils vivaient dans une pièce de la délégation ; je fis mes adieux à Khatissian et à sa femme, je sortis en sueur.
En faisant mes adieux à Artsrouni Toulian, je dis : - « Si jamais je signe une déclaration en Pays Soviétique, souvenez-vous de Vartan Mamigonian. Souviens-toi aussi que c'est moi qui t'ai baptisé du nom d'Achot Artsrouni, quand tu cherchais une signature appropriée pour tes articles de presse (jusqu'à maintenant encore, il signe : Achot Artsrouni, cela fait cinquante ans...). »
En nous séparant, Achot Artsrouni dit, ému : « Nous ne nous rencontrerons plus »... Il savait le danger de ma mission ; lui-même était venu du Pays et de 1928 jusqu'à aujourd'hui, 1978, nous ne nous sommes pas rencontrés, bien que nous ayons correspondu, lui à Buenos Aires, moi à Téhéran.
J'allai avec Roubèn chez Avédis Aharonian. En ces jours (fin Juin 1928), Aharonian, en parlant chez des Français, avait soudain perdu la vue... Roubèn dit : - « Avédis, nous envoyons André en Union Soviétique. Peux-tu donner une adresse, via Moscou ? » Aharonian fut très ému. J'étais debout près de son lit, Roubèn caressait le front d'Aharonian :
- Ah, c'est une mission dangereuse. À Moscou, va à l'église arménienne, Armianski pereoulok (la ruelle arménienne). Là-bas, il y a un prêtre respectable, Ter Arsen Simonian ; il te donnera l'adresse de camarades, - dit Aharonian. Il prit ma main, la serra, nous fîmes nos adieux avec Roubèn. (Plus tard, ses yeux s'étaient rouverts et il était redevenu l'ancien Aharonian).
Je fis mes adieux au camarade Vratsian dans le bâtiment de la Délégation, il m'embrassa, me souhaita du succès et dit : - « Qu'on ne me voie pas avec toi » et partit.
Je rencontrai Chavarch Missakian, qui était le trésorier du Bureau ; il me donna cent cinquante dollars, comme « prêt »... Je signai un reçu.
Je partis chez le camarade Jamalian, avec ma valise, je devais y recevoir des instructions ; puis, je devais partir en train. Il vivait en banlieue, avec sa famille.
Roubèn était là. « Maintenant tu dois mémoriser trois chiffres (code secret), avec les initiales Erna, André et Arous. Erna est le nom de ma fille, Arous sera aussi ton nom de couverture », dit
Jamalian et commença à m'expliquer le secret du chiffre. Je mémorisai le chiffre sur place. Ensuite il dit : - « Je te donne deux mots de passe, que nous avons pris de Dro ; à Moscou se trouve Dikran Aniev, qui a été officier dans l'Arménie Républicaine, à Moscou aussi il a été proche de Dro ; Aniev est un socialiste-révolutionnaire bien que, mais il est avec nous, c'est un homme de confiance. Tu dois d'abord lui dire ces mots de passe, pour que les camarades te fassent confiance. A. mot de passe : La lumière de Lealeia, B. mot de passe : Dieu et les quarante diables sont avec nous. »
« Sont exilés à Moscou nos camarades : Korioun Ghazazian, Dikran Avétissian, Bagrat Topchian, Smbat Khatchatrian, Arsen Shahmazian. Tu les rencontreras, mais évite de rencontrer Bagrat Topchian, parce que nous avons entendu qu'il a récemment des points de vue différents. Tu informeras les camarades de la situation politique actuelle, aussi des décisions de la 10e Assemblée Générale, à laquelle tu as toi-même assisté et participé. Tu t'informeras aussi de leurs points de vue, de notre politique à mener – envers les Soviets. Le Bureau t'autorise à neutraliser les camarades non fiables, même à dissoudre un organe, si c'est nécessaire et à en nommer un nouveau. Au Comité Central du Pays, tu demanderas ce qu'est devenu le Treizième de Boudachko... aussi : nous avons envoyé de la littérature et de l'argent, les ont-ils reçus ? », dit Jamalian. Roubèn dit : - « À Alexandropol se trouve Dikran Gavarian, c'est un de nos anciens fedayis du Daron et il me connaît bien. Tu le verras, il te fera connaître les camarades d'Alexandropol. Nous envoyons à Dikran de la littérature secrète et de l'argent. »
Jamalian continua : - « Tu travailleras à établir un contact via Bakou avec les nôtres en Perse, à Enzéli. Le dernier procès en Arménie a rompu notre lien et nous ne savons pas qui reste maintenant. Seulement, à Erevan, évite Mihran Grigorian, il a donné une déclaration ; il était membre du parlement d'Arménie. Tu seras prudent, ne te fie pas à n'importe qui, il y a beaucoup d'espions soviétiques. »
Roubèn dit : « Tu rencontreras le dirigeant bolchevik arménien Sahak Ter-Gabriélian et tu parleras du Karabagh et du Nakhitchevan, qu'ils travaillent à les rattacher à l'Arménie ; ce sont des terres arméniennes, c'a été une injustice de remettre ces régions à l'Azerbaïdjan », et il commença à expliquer l'importance militaire du Karabagh, que le Karabagh actuel est séparé de l'Arménie au nord-est par un sommet montagneux (Sélim) et un col. Il avait écrit des articles d'étude sur ces régions dans « Drochak », j'avais corrigé les épreuves ; le sujet m'était familier.
Je dis à Jamalian et Roubèn que le camarade Vratsian avait donné le nom du docteur Sarkissian, que je devais rencontrer à Bakou, peut-être par son intermédiaire j'établirais un contact sur la ligne Bakou-Enzéli. Après avoir parlé de quelques détails, je fis mes adieux à Jamalian, et Roubèn et le fils de quinze ans de Jamalian, Armik, qui m'était très attaché, vinrent à la gare pour me mettre en route. Nous nous embrassâmes ; quand je montai dans le train, je me retournai pour dire au revoir, je vis que des larmes coulaient des yeux de Roubèn... C'était notre dernière séparation, je ne devais plus le revoir.
֍
Le camarade Jamalian avait ordonné que je n'emporte avec moi aucun papier ou livre ; je lui avais dit que j'avais un livre de Lénine en français – « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme » et un petit dictionnaire de poche français-russe. Jamalian avait dit de ne pas prendre le livre de Lénine avec moi, cela pourrait susciter des soupçons, donc je jetai le livre par la fenêtre du train, mais je gardai le dictionnaire. Dans ma valise, il n'y avait que mes vêtements. J'avais pris un visa de transit au consulat soviétique de Paris ; en ces années, dans chaque ville principale, le voyageur avait le droit de rester vingt-quatre heures.
En ces jours, de Moscou était venu à Paris le groupe d'acteurs nommé d'après Vakhtangov, à l'un de whose représentations j'avais assisté ; et voici, quand notre train s'arrêta en gare de Berlin, le groupe d'acteurs nommé d'après Vakhtangov monta dans le train et remplit les compartiments près de moi. Un soupçon traversa mon esprit, donc je décidai de montrer que je ne connaissais pas le russe, et même de descendre à Varsovie pour deux jours (à ce sujet, Jamalian avait aussi dit, si je voyais quelque chose de suspect en chemin).
À Varsovie, je descendis dans un hôtel. J'allai en ville, j'achetai une blouse de style russe, une casquette. À Moscou, je devais circuler avec ces vêtements, pour ne pas éveiller de soupçons, autrement les vêtements européens attireraient l'attention et les soupçons. J'avais un bouton de poitrine avec l'image de Christophore Mikayélian, que m'avait offert, encore à Tabriz, en 1922, en partant pour l'Arménie, le camarade Hmayak Boghossian (le frère aîné du camarade Tachat Boghossian) ; je ne pouvais pas avoir cette décoration avec moi ; ma main n'alla pas non plus la jeter, donc je la mis sous la plaque extérieure de la fenêtre de l'hôtel, là elle pouvait rester en sécurité longtemps. Quand je devais partir de l'hôtel, cinq garçons de service se tinrent en rang... je devais donner un pourboire, alors que je n'en avais vu qu'un seul. Je donnai un pourboire et partis pour la gare.
À la frontière de l'Union Soviétique, je descendis, on regarda ma valise, je passai.
֍
À la gare de Moscou, je mis dans mon portefeuille un change de linge, mon rasoir, j'avais changé mes vêtements. Achot Artsrouni m'avait dit que les fonctionnaires soviétiques et les tchékistes portaient une blouse, mettaient une casquette sur la tête, un portefeuille à la main, moi aussi je m'habillais ainsi. Je laissai ma valise en consigne à la gare, je pris une voiture. J'ordonnai de conduire à Armianski Pereoulok (la ruelle arménienne [l'impasse]), où se trouvait l'église arménienne. La voiture avait une apparence très misérable, deux chevaux – squelettiques, les tentures intérieures de la voiture déchirées, pendantes, le cocher, un vieux Russe, squelettique comme ses chevaux... Moscou en ces jours, après Paris, ressemblait à un grand village.
Dans la voiture, mon cœur battait fort, - « et si je ne voyais pas le père Arsen dont avait parlé Aharonian, que ferais-je sans rencontrer de camarades à Moscou... ».
J'arrivai, je descendis de la voiture, j'entrai dans la cour de l'église, en face était l'église, sur le mur de l'aile gauche il y avait deux portes, propres, en bois marron, je frappai à une porte, la porte fut ouverte par une jeune femme au beau visage.
- Excusez-moi, puis-je voir le père Arsen ? - dis-je.
- Attendez une seconde, - dit la femme et passa à l'intérieur.
Je respirai librement, donc j'avais trouvé le père Arsen.
À la porte apparut un prêtre au visage agréable.
- Père Arsen, je viens de Paris. Avédis Aharonian vous envoie ses chaleureuses salutations. Récemment, il avait perdu la vue pendant trois jours, mais, heureusement, il l'a retrouvée. Je vous prie de me donner l'adresse de Smbat Khatchatrian.
Le père donna l'adresse, se réjouit de la salutation et de la santé d'Aharonian. Je dis : « Père, après Paris, Moscou ressemble à un grand village », il dit : « C'est encore bien maintenant, il y a cinq-six ans, si tu avais vu ce que c'était... ».
En faisant mes adieux, je dis : « Père, ni je ne t'ai vu, ni toi tu ne m'as vu. » - « Bien sûr, mon enfant, sois le bienvenu », dit-il, je partis.
En voyant l'église arménienne de Moscou, je me souvins de ce qu'avait raconté Aharonian au sujet de la terreur du diacre Jhamharian, qui avait eu lieu dans la cour de cette église même.
« Le terroriste était l'un de nos jeunes camarades à peine lettrés, il s'était réfugié à Genève, il s'était beaucoup attaché à moi. Le millionnaire arménien Jhamharian fut soumis à la terreur par décision de la Fédération Révolutionnaire Arménienne, parce qu'il avait dénoncé à l'Okhrana tsariste la collecte de fonds pour « La Tempête » », racontait Aharonian.
L'église arménienne de Moscou est une dépendance du séminaire Lazarian, dont je vis le bâtiment de l'extérieur.
֍
J'allai à l'adresse donnée par le père Arsen, dans le vestibule d'entrée, sur un tableau noir, était écrit à la craie en russe : comité de maison, de garde : Smbat Khatchatrian. Je montai par les escaliers, je frappai à la porte du premier étage, la partie médiane de la porte était en cuir, à l'intérieur rembourrée de laine... Sans doute, pour se protéger des froids de Moscou. Je frappai plusieurs fois – personne n'ouvrit la porte. Je pensai partir, revenir un peu plus tard, peut-être qu'il serait arrivé.
Dans la rue, je vis un salon de coiffure, j'entrai. Deux militaires étaient assis en attente, je m'assis aussi. Mes vêtements étaient tels qu'ils ne soupçonneraient pas. Quand mon tour vint, le coiffeur bavard commença à poser des questions.
- D'où êtes-vous, citoyen ? - demanda-t-il.
- De Léningrad, - dis-je.
- Le pain coûte combien ? - demanda-t-il.
À Paris, j'avais suivi la presse soviétique, donc je dis un prix.
- La viande coûte combien ?
Je dis encore un prix.
- C'est la première fois que vous venez à Moscou ?
- Non, je suis allé à Léningrad via Moscou, - dis-je.
Enfin, la coupe de mes cheveux se termina, il voulut me raser le visage, je ne le laissai pas. Pour me libérer de nouvelles questions, je payai, je sortis en sueur... Je m'éloignai rapidement vers le logement de S. Khatchatrian ; il n'était encore pas à la maison...
Je pris une voiture vers l'église arménienne, chez le père Arsen.
- Père, le camarade S. Khatchatrian n'est pas à la maison, j'y suis allé deux fois, j'ai frappé à la porte - Oh, aujourd'hui c'est dimanche, probablement il est allé chez des connaissances. Veux-tu que je te donne l'adresse de Bagrat Topchian ? - dit-il.
Bien que le camarade Jamalian eût dit « Efforce-toi de ne pas rencontrer Bagrat », mais puisque le père Arsen donna le nom et que je n'avais pas d'autre adresse, je dis oui.
- Il vit avec sa femme dans le bâtiment du cimetière arménien de Moscou. Seulement, en entrant, sois prudent, le concierge est un espion russe, - dit le père Arsen.
Je fis mes adieux, je pris une voiture vers le cimetière arménien.
La porte du cimetière était une grande grille en fer ; je vis une petite fille derrière la porte qui jouait à la balle :
- Chère petite fille, l'oncle Bagrat est-il à la maison ? demandai-je en russe. Elle dit oui.
- Alors, ouvre la porte, - dis-je.
La fille ouvrit la porte, j'entrai ; je vis sur la gauche, à une cinquantaine de pas, le concierge russe assis sur les marches de sa cabane, avec sa famille. Je passai rapidement vers la droite, près des arbres, vers ce bâtiment de plain-pied du cimetière, où
Bagrat vivait. En 1917-1919, j'avais vu Bagrat à Tiflis, son visage m'était familier.
Je frappai à la porte du logement, elle s'ouvrit. C'était lui, je le reconnus.
- Camarade Bagrat, je viens de Paris, je dois vous rencontrer pour des missions importantes, puis-je entrer ?
Bagrat, silencieux, m'accueillit à l'intérieur. Je m'assis sur une chaise, lui passa derrière son bureau, commença à manger des blinis (bouillon de pâte), silencieux et pensif. Je le comprenais, il était dans le doute, donc je dis.
- J'ai des mots de passe concernant Dikran Aniev, pour que vous me fassiez confiance. Jusque-là, vous pouvez ne rien me dire.
L'expression du visage de Bagrat changea.
- Je vous ai vu à Tiflis, j'ai entendu vos conférences, aussi celles des camarades Vahan Issorènine, Korioun Ghazazian, Dikran Avétissian. Je dois aussi rencontrer le camarade Korioun et D. Avétissian, - dis-je.
- Korioun et Avétissian se trouvent dans la prison de l'Oural, - dit-il.
- Dans ce cas, je parlerai et je rendrai compte à vous, aux camarades Arsen Shahmazian et Smbat Khatchatrian ; je suis allé au logement de Khatchatrian, il n'était pas à la maison, - dis-je, - j'ai pris son adresse et la vôtre du père Arsen.
Puis je racontai que le lien avec le Bureau était rompu, à cause du procès de Manouk Khuchoyian et des emprisonnements, des dénonciations du provocateur Boudachko.
- Boudachko vint de Paris ici, s'assit juste à la place où tu es assis, je savais que c'était un espion, nous avions envoyé une nouvelle à Tabriz à son sujet, pour informer le Bureau. J'ai mis Boudachko dehors, déclarant que je ne m'occupe pas des affaires du parti, il partit, s'en alla, - dit Bagrat.
- Maintenant, je dois établir un lien par votre intermédiaire ici et par les camarades du Pays, pouvons-nous aller chez Dikran Aniev ? - demandai-je.
- Maintenant ce n'est pas possible, c'est le jour, nous irons ce soir, - dit-il.
- Dans ce cas, je vous demande une chose, le Bureau m'a donné des chiffres, que j'ai mémorisés, je vous donne ces chiffres avant l'heure, parce que si je suis arrêté, ma mission sera vaine, - dis-je.
- Attends, je vais venir, - dit Bagrat et sortit de la pièce.
A peine dix minutes plus tard, il revint avec un jeune homme énergique, dont le nom était Kolik. Il portait une blouse russe blanche. Nous fîmes connaissance, nous passâmes dans la pièce du fond, j'écrivis rapidement les trois chiffres, aussi l'adresse donnée par le Bureau et je dis, - Camarade Kolik, emportez cela immédiatement d'ici, ni je ne vous ai vu, ni vous vous ne m'avez vu.
- Très bien, - dit Kolik, et en mettant le papier dans la manche de sa blouse, il partit immédiatement.
Bagrat n'avait plus de doute, il demanda :
- Tabriz n'avait-il pas informé le Bureau de la nouvelle que nous avions envoyée concernant Boudachko ?
- Malheureusement, la nouvelle était arrivée avec deux mois de retard, quand Boudachko était déjà parti de Paris, - dis-je.
Ensuite je racontai comment Boudachko avait dénoncé et révélé la ligne secrète des S-R (socialistes-révolutionnaires) via la Finlande vers l'Union Soviétique. Quant à la dénonciation et au procès de nos camarades d'Arménie, aux prisons et à l'exil, Bagrat et les camarades de Moscou le savaient. C'était cela, que le lien était rompu.
֍
Quand la nuit tomba, Bagrat dit : allons chez Aniev, où je devais dire les mots de passe.
Dikran Aniev était de haute taille, au teint un peu basané, au visage sympathique, c'était un ancien officier, exilé à Moscou. Bagrat nous laissa, moi et Aniev, seuls dans la pièce. Je dis le premier mot de passe : La lumière de Lealeia. Aniev réfléchit, puis dit :
- Je ne me souviens pas...
Je me sentis mal à l'aise, donc ils allaient me soupçonner, pensai-je.
Juste à cet instant, une petite fille brune entra en courant, une poupée à la main...
- Ah, je me souviens, - s'exclama Aniev.
- Camarade Aniev, vous m'avez sauvé, dis-je, - sinon...
Apparemment, Lealeia était justement le nom de cette fille...
- Dieu et les quarante diables sont avec nous, - dis-je.
- Dro ! C'est Dro ! - s'exclama Aniev et alla dans la pièce voisine.
Je vis alors entrer dans la pièce les camarades : Smbat Khatchatrian, Arsen Shahmazian et Bagrat Topchian. Je compris qu'ils avaient attendu dans l'autre pièce, que si j'étais suspect, ils me laisseraient partir, et si j'étais digne de confiance, ils entreraient.
Je leur transmis les salutations des camarades du Bureau, puis je rendis compte de la 10e Assemblée Générale et de la vie du parti. La rupture du lien avec le Pays, les destructions causées par l'affaire Boudachko, etc.
Je dis aussi que bien que j'aie pris un visa de transit, à Erevan je devais faire une demande pour rester, une partie de ma mission était accomplie ici, l'autre partie restait encore.
Puis seul Smbat Khatchatrian parla :
« Nous sommes reconnaissants pour les informations que tu as données ; tu as accomplis tes devoirs à 90 pour cent, donc nous te demandons de ne pas t'arrêter en Arménie, passe directement en Perse et communique au Bureau de notre part ce qui suit :
1) Dissoudre, supprimer notre organisation secrète en Arménie, parce que de nombreux camarades sont emprisonnés et exilés, les familles restent sans aide ; tandis que si ces camarades restent en Arménie, ils influenceront leur entourage par leur mentalité, et les familles ne resteront pas non plus sur le carreau.
2) Déjà, les bolcheviks arméniens d'Arménie ont commencé à faire ce que nous voudrions ; par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avoir une organisation secrète », termina sa parole le camarade Smbat Khatchatrian, demandant à nouveau que je passe en Perse.
Je leur fis mes derniers adieux, je retournai avec Bagrat au cimetière arménien.
La femme de Bagrat, Mme Ania, était une personne agréable, quand elle demanda mon nom, je dis : Ananoun (Sans nom). Elle fut d'abord étonnée d'un tel nom, puis il sembla qu'elle comprit, après cela elle disait avec un accent particulier : Monsieur Ananoun...
La nuit, on m'attribua un lit dans la troisième pièce, non meublée et vide, et on verrouilla la porte de l'extérieur.
֍
Le lendemain, dans la matinée, le camarade Bagrat dit : - « Aujourd'hui à midi, nous aurons une séance du Comité Central ; tu feras connaissance avec la composition, tu rendras compte et ensuite tu écouteras leurs opinions. »
À midi arrivèrent : la camarade Mlle Héliné Medzboyian, Kolik (que j'avais vu la veille) et Vardoyan ; ces deux étaient de mon âge, tandis que Mlle Medzboyian était âgée.
Quand le camarade Bagrat me présenta à Mlle Medzboyian, je dis : - « Vous avez été institutrice à Tabriz dans le passé, n'est-ce pas ? » - « Oui », dit-elle. « Ma mère, Yéranouhi Melik Vardanian (maintenant : Ter Ohanian) a été votre élève et m'a raconté à votre sujet, je suis le fils d'une élève qui vous aimait beaucoup, je suis de Tabriz » - dis-je.
Mlle Medzboyian fut émue, son visage s'éclaira,
« Je me suis souvenue de votre mère, c'était une fille de petite taille, très lectrice, je suis contente de faire votre connaissance », - dit-elle.
Bagrat dit que le camarade Martiros Zaroutian avait envoyé un message, qu'il ne pouvait pas venir, il a toujours une raison... (c'est peut-être mieux, pensai-je, si nous sommes arrêtés, au moins il restera libre).
Lors de la séance, présidait Mlle Medzboyian, d'une parole brusque et brève, cette camarade intellectuelle m'impressionna, qui était aussi exilée à Moscou et sous surveillance.
Je rendis compte de la situation politique, des décisions de l'Assemblée Générale, de la vie organisationnelle, de la rupture du lien et d'autres problèmes. Ils écoutèrent, et Mlle Medzboyian aussi répéta que j'avais accompli mes devoirs à 90 pour cent, que je passe en Perse, pour tenir le Bureau informé de leur situation et de celle de la patrie. Eux-mêmes vivaient avec de grandes privations, le parti n'a pas non plus de moyens matériels. Quant au lien par chiffres, les bolcheviks examinent maintenant les lettres aussi par des moyens chimiques. Le lien par des personnes vivantes est plus pratique, comme le mien.
Quand les autres partirent (c'était aussi le dernier adieu avec eux...), Bagrat me dit :
- Dikran Gavarian, ce fedayi du Daron, est maintenant suspect ; on lui envoyait de la littérature secrète et de l'argent de Tabriz, mais il ne les donnait à aucun camarade ; maintenant aussi, tous nos camarades d'Alexandropol ont été emprisonnés et exilés, sauf Gavarian... Ne descends à Alexandropol à aucun prix.
- J'ai une mission concernant la terreur de Boudachko, - dis-je.
Bagrat se mit très en colère :
- Assez ! Assez ! - dit-il, - nous en avons déjà fait un, nous avons vu ce qui est arrivé...
- Lequel ? - demandai-je.
- Celui de Djemal ! près de six cents camarades furent déportés, une partie dans la prison de l'Oural, l'autre partie dans les profondeurs de la Sibérie, - dit Bagrat, et il ajouta, - nous avons entendu que Boudachko se trouve à Tiflis, ne descends pas non plus à Tiflis.
J'écoutai Bagrat, mais dans mon esprit il y avait l'instruction du Bureau, je devais régler le compte de Boudachko, mais je ne le dis plus à Bagrat à ce sujet.
J'avais pleinement exécuté les instructions du Bureau à Moscou, remis les chiffres et l'adresse, rendu compte et écouté leurs points de vue, donc je partis de Moscou, y restant deux jours (4-6 Juillet 1922).
7. ARRIVÉE À EREVAN ET ARRESTATION
DROCHAK, 7e année, N° 23, 4 Mars 1987, pp. 11-15 (923-925)
De Moscou, sur la route de Bakou, j'étais couché sur la couchette supérieure du wagon, le visage tourné vers le mur, pour ne pas être remarqué par des yeux fouineurs.
Dans une gare du Caucase du Nord, lorsque le train s'arrêta, plusieurs montagnards armés montèrent dans le wagon et exigèrent des voyageurs qu'ils se lèvent.
Nous nous levâmes, ils nous regardèrent tour à tour d'un regard furieux et perçant. Plus tard, nous apprîmes qu'ils avaient fait descendre deux personnes, sous prétexte qu'elles étaient suspectes...
J'arrivai à Bakou tôt le matin. Je me rendis en voiture chez la fille de ma tante. Il était 6 heures du matin lorsque son mari, Boris, ouvrit la porte et resta stupéfait : « André, toi ici ?... » « Oui, je suis venu te voir, toi et Perchik, je vais à Erevan », dis-je.
Il était évident que tous deux avaient peur. Je les rassurai en disant que je me rendais à Erevan, chez notre famille, et que je voulais les voir aussi après des années de séparation. C'étaient un mari et une femme médecins, sans parti, établis à Bakou, ils avaient un garçon de deux ans ; une nourrice russe venait garder l'enfant le jour, tandis qu'ils partaient travailler. Je leur recommandai de dire à la nourrice que j'arrivais de Moscou. Dans la journée, je parlais russe avec la nourrice, j'avais dit que j'arrivais de Moscou.
Le camarade S. Vratsian, je l'ai écrit, m'avait donné le nom d'un médecin nommé Sarkissian que je devais rencontrer à Bakou. Je demandai à Boris s'il y avait un médecin nommé Sarkissian dans leur hôpital. Il dit :
- Il y a deux médecins nommés Sarkissian, duquel parles-tu ?
- Je ne connais pas le prénom, dis-je, et la question se termina ainsi...
Nous avions d'autres parents à Bakou : Mkrtich Karapetian et Grigor Nikogossian, qui avait été typographe à Tabriz. On envoya un message à Grigor, il vint le soir (c'étaient les enfants de la sœur de ma mère avec ma tante). À l'époque de Tabriz, Grigor était Dachnak.
Grigor raconta que maintenant aussi il était typographe et qu'en tant qu'ouvrier sa situation n'était pas mauvaise ; mais son frère, Mkrtich, qui était tailleur, était mécontent et disait qu'il ne resterait pas dans ce pays, qu'il partirait pour la Perse, s'installerait à Enzeli.
- Es-tu le Grigor d'avant, ou non ? demandai-je.
- Je suis celui d'avant, mais maintenant ici on m'appelle sans-parti, dit-il.
- Si je reste en Arménie, garderas-tu le contact avec moi ?
- Bien sûr, d'autant plus que nous sommes parents, dit-il.
Je pensai : Mkrtich, qui va partir pour Enzeli, gardera le contact avec son frère Grigor, et Grigor avec moi.
J'écrivis une lettre ouverte à Paris, à Mshag Ardzrouni, pour qu'il sache que j'étais arrivé à Bakou ; cela sera communiqué au Bureau. Je signai : Arous, ce pseudonyme leur était connu.
En quittant Bakou, il arriva une chose intéressante : je ne savais pas que la gare ferroviaire était au premier étage. Lorsque je voulus entrer par l'entrée du rez-de-chaussée, un garde rouge me barra la route :
- Où vas-tu ? dit-il sévèrement.
- À la gare, dis-je.
- C'est en haut, dit le garde.
Inutile de dire que c'était le bâtiment de la Tchéka de la gare. J'étais sur le point de tomber dans le piège à deux pieds...
Je passai par Tiflis, là-bas il ne restait aucun camarade, et je n'avais rien à y faire non plus.
Le train approchait d'Alexandropol. En moi-même, une lutte commença : descendre ou ne pas descendre ? D'un côté, je me souvenais de la recommandation de Rouben de voir Tigran Gavarian, de l'autre, des paroles de Bagrat Topchian, que Gavarian était déjà un homme de la Tchéka...
J'étais dans ces réflexions lorsque deux soldats armés vinrent se poster de chaque côté de l'entrée de notre compartiment... Un soupçon traversa mon esprit. C'est pourquoi je décidai de ne pas descendre à Alexandropol. Je pensai : depuis Erevan, plus tard, je pourrai entrer en contact avec Alexandropol, si les camarades le conseillent.
֍
Lorsque la voiture s'arrêta devant notre logement, ma mère sortit sur le balcon et, me voyant descendre de voiture, s'écria, prise de court : « Ma fille, c'est André !... » Elle en avait presque la langue paralysée, car elle n'attendait pas mon arrivée ; moi non plus, évidemment, je n'avais pas écrit.
Mes deux sœurs, Marous et Seda, étaient parties pour Karajichag (Darachichag) pour les vacances scolaires ; mon frère cadet, Hratch, était à son poste, et mon frère puîné, Vatché, était soldat à Tiflis.
Ma première action fut de me présenter au commissariat de l'Intérieur, en tant que visiteur. Le bâtiment du commissariat se trouvait sur la rue centrale Astafian (maintenant Abovian), dans l'ancien bâtiment du grand hôtel (« Oriant »). Je dis au fonctionnaire que je voulais rester une semaine à Erevan, chez ma mère. Le visa était un visa de transit. Il me donna un formulaire, je le remplis, il dit : « Reviens demain ». Le lendemain, je me présentai, le fonctionnaire dit : « C'est autorisé, mais à condition que tu te présentes ici chaque jour à midi ». Je le remerciai.
À Moscou, les nôtres m'avaient dit que Sahag Torossian était revenu d'exil à Erevan ; et que Vartan Mehrabian (Vartan de Khanasor) se trouvait dans un jardin à Erevan.
Je rencontra Mihran Grigorian (lui qui avait écrit une déclaration et à qui les nôtres ne faisaient pas confiance), je le priai de rencontrer Sahag Torossian, de lui dire que son élève du « Séminaire Guéorguian » voulait le rencontrer. Et aussi Vartan Mehrabian, que je voulais le rencontrer, que j'étais venu de Paris.
Mihran exécuta ma demande. Sahag Torossian avait dit : « Même mes toilettes sont sous surveillance ; dis à André de ne pas me rencontrer, il se mettrait lui-même en danger »... Et Vartan de Khanasor avait aussi dit : « On m'a donné un petit jardin à cultiver, en dehors de la ville, pour que je le travaille - que je vive et que je ne m'occupe absolument pas de politique, des affaires du parti »...
Tous nos camarades étaient emprisonnés ou exilés ; et Mihran Grigorian, lui aussi, qui était considéré comme suspect, ne me dénonça pas.
Je vérifiai que Sahag Ter Gabriélian, un dirigeant bolchévique avec qui je devais parler du Karabagh et du Nakhitchevan, n'était pas à Erevan ; il était parti pour Moscou. Déjà à Moscou, le camarade Bagrat Topchian m'avait déconseillé de rencontrer Ter Gabriélian à Erevan ; il avait dit : « Il vient souvent à Moscou, nous lui parlerons de cela ».
֍
Était venu à Erevan, d'Achkhabad (ville transcaucasienne ? [d'Asie centrale]), notre parent Babguén Ter Ohanian ; il avait participé à une représentation à Achkhabad, un tchékiste, qui était assis au premier rang, s'était moqué de Babguén ; et lui, à la fin de la représentation, était descendu dans la salle et avait tué le tchékiste de son couteau...
Babguén, en tant que mineur, avait été emprisonné six mois, puis avait été éloigné à Erevan, où il étudiait (son père avait joué un rôle dans l'adoucissement de la peine : Vartan Ter Ohanian, qui était bolchévik et avait des relations).
Un soir, j'étais assis avec Babguén sous un arbre dans la cour du club, sur un banc, quand soudain je vis Boudachko descendre les escaliers de la cour... Je rabattis ma casquette sur mes yeux, de façon à ce qu'on ne voie pas mon visage, et dis à Babguén à voix basse de bien observer celui qui descendait les escaliers. « Qui est-ce ? », demanda Babguén, je lui dis : « Regarde bien, je te dirai après ».
Boudachko passa du côté du bâtiment du club. Je pris Babguén et nous sortîmes du club. Je lui dis brièvement que Boudachko était un provocateur, qu'il avait dénoncé beaucoup de gens, qu'il pouvait nous dénoncer nous aussi. Puis je chargeai Babguén de me rencontrer samedi soir, j'avais quelque chose à lui dire. Je pensais à l'intimidation de Boudachko...
Le lendemain à midi, lorsque j'allai me présenter au commissariat, il y avait un client chez le fonctionnaire, il me dit d'attendre quelques minutes dans le couloir. J'étais debout près du mur du couloir quand soudain je vis Boudachko entrer par la porte du fond...
Je tournai mon visage vers le mur, feignant de lire la grande affiche collée au mur. Boudachko vint, passa, puis fit demi-tour, s'arrêta derrière moi et dit :
- André...
Je me retournai lentement, le regardai. « Je ne te connais pas, qui es-tu ? », dis-je.
Il enleva sa casquette et dit : « Tu ne me reconnais pas ? Je suis Boudachko »...
- Tes yeux ont quelque chose, dis-je ; à cet instant, le client sortit du bureau du fonctionnaire, j'entrai immédiatement. Je posai quelques questions au fonctionnaire pour gagner du temps, que celui appelé Boudachko s'en aille.
Je sortis du bureau du fonctionnaire, Boudachko se tenait près de lui...
- André, mon oncle, Tsovaguim Boudaghian, de quoi est-il mort à Paris ? demanda-t-il.
- Il est mort à cause de toi, misérable, dis-je en marchant vers la porte.
- Mais Chamoyan dit qu'il avait la syphilis...
- La syphilis est dans ton cerveau, bon à rien, le pauvre homme est devenu fou à cause de ton comportement, dis-je et je descendis rapidement les escaliers, je m'éloignai.
Samedi, vers midi, lorsque je me présentai au commissariat, je dis au fonctionnaire : « Je veux rester en Arménie, que dois-je faire ? ».
Il me donna une feuille de papier : « Dans la pièce à côté, écrivez une demande, apportez-la-moi », dit-il.
Je passai dans la pièce voisine, où il n'y avait personne ; je n'avais pas encore signé ma demande lorsqu'un tchékiste en uniforme militaire entra et dit : « Il y a une irrégularité dans votre laissez-passer, venez ». Je le reconnus, il était de ceux qui avaient émigré de la Vieille Djoulfa à Tabriz, il s'appelait Micha Aghamalov. « Quoi qu'il en soit, venez avec moi », dit-il.
Je mis la demande non signée dans ma poche et le suivis.
Nous descendîmes, une voiture attendait, nous montâmes en voiture. « Va au Guépéou », dit le tchékiste ; le cocher hésita. « Alors, je dois dire Tchéka, tu comprends ? », dit le tchékiste. Le cocher partit, pris de panique.
- Je te connais de Tabriz. Tu présidais la réunion régionale des Dachnaks. Je vivais dans la cour du secrétaire du comité central des Dachnaks, Mikayel Stépanianents ; j'ai lu ses procès-verbaux quand il n'était pas à la maison. Nous avons appris que tu as été à Moscou...
- Moi aussi, je connais ta sœur ; c'était une jeune fille trapue, aux cheveux noirs, elle avait dessiné le grand portrait de Srpazan Melik-Tanguiane, dis-je.
Le tchékiste ne parla plus, car le nom de Melik-Tanguiane était très dangereux ; Guégham Chamavonian, lui aussi, qui était bolchévik, avait été emprisonné parce qu'à l'époque où il était enseignant à Tabriz, il avait fréquenté Melik-Tanguiane.
(En 1922, les Soviétiques avaient exigé que le Primat du diocèse arménien de l'Adrabadagan, Nersès Melik-Tanguiane, retourne à Etchmiadzine. La communauté arménienne de Tabriz avait organisé une manifestation, les meneurs étaient Tarlan baji et Dzabel baji, qui criaient : « Nous ne laisserons pas notre primat partir, nous voulons le primat comme notre dirigeant ». Et le primat ne partit pas. Les Soviétiques le considérèrent comme « hors la loi »...).
On me jeta dans une pièce à l'étage supérieur du nouveau bâtiment de la Tchéka d'Erevan, qui était vide, il n'y avait même pas de chaise. Je restai debout là plus de deux heures.
On me fit descendre dans une petite pièce à l'étage inférieur, derrière une table était assis un tchékiste, un autre commença à me fouiller minutieusement ; lorsque sa main toucha le nœud dur du caoutchouc de la chaussette à l'intérieur de ma culotte, il soupçonna. « Quoi, vous pensez que ça pourrait être une bombe ? », dis-je, et mon regard rencontra celui du tchékiste assis derrière la table ; celui-ci me fit comprendre du regard de ne pas dire de telles choses...
C'était le 14 juillet 1928 que je fus arrêté ; c'était ce soir-là (un samedi) que je devais avoir une rencontre avec Babguén... « Le vendredi est arrivé avant le samedi », comme dit l'expression populaire...
La vieille prison de la Tchéka d'Erevan était un misérable bâtiment, composé de quelques caves en sous-sol, et au-dessus d'elles, cinq chambres (cellules), en briques, une petite cour, sèche et aride, dans un coin de la cour la cuisine, à côté, les toilettes avec des murs de terre, sales, il n'y avait pas de place pour mettre le pied... Près du mur de la cour se trouvait le lavabo, une cuvette et un récipient d'eau.
On m'emmena dans une cellule près de l'entrée de la cour, où la lumière ne pénétrait pas ; il n'y avait qu'un lit de planches. Il y avait des fourmis dans la cellule.
Je m'allongeai sur le lit de planches sec. De temps en temps, les tchékistes ouvraient la porte, m'observaient et partaient sans parler. Je passai la nuit ainsi.
Le matin, lorsque le klioutchnik (le gardien de service qui avait les clés de la prison) me fit sortir pour me laver, lorsque je vis la lumière du soleil, ce fut comme si on plantait un couteau dans mes yeux... Je venais de voir la lumière après l'obscurité. Après cela, lorsqu'on me faisait sortir, je couvrais mes yeux avec ma main, puis les ouvrais prudemment, pour ne pas avoir mal comme le premier jour.
Le deuxième jour, on me transféra au sous-sol du bâtiment, semblable à une cave, il y avait là une petite fenêtre avec des barreaux, d'où la lumière pénétrait dans ma cellule.
Le quatrième jour, on me mit dans la cellule du côté gauche du premier étage du bâtiment, qui avait plus de lumière.
Ma mère envoya un lit et de la nourriture ; mais j'avais une forte dysenterie ; à cette époque, ceux qui venaient d'Europe vers l'Orient attrapaient cette maladie, à cause de la différence de nourriture ; en Europe, on utilisait de l'huile végétale, tandis qu'en Orient, de la vraie huile, naturelle [animale]. Je ne mangeais rien, j'avais des saignements, ainsi passèrent six jours, la dysenterie s'arrêta.
Une fois par jour, on nous faisait sortir dans la cour pour nous promener... et il n'y avait même pas de place pour se promener, la cour était très petite. Pendant cette promenade, les détenus des cellules voisines observaient par les fentes pour voir qui était le nouveau détenu.
Dans les fentes du lit de planches de ma cellule, il y avait des centaines de punaises qui me tourmentaient jour et nuit. Lorsqu'on donnait de l'eau chaude pour le thé, je la versais dans les fentes de mon lit, pour détruire les punaises, mais cela n'aidait pas non plus...
Le déjeuner était un potage incolore, à la place de la viande, des os et des tendons ; plus tard, j'appris que le cuisinier de la prison mangeait lui-même le peu de viande qu'il y avait, et donnait les os et les tendons aux détenus.
On avait permis à ma mère de m'envoyer de la nourriture deux fois par semaine...
On me transféra dans une autre cellule, dont la fenêtre donnait sur la cour, et je voyais les détenus des cellules voisines lorsqu'on les emmenait en promenade, je voyais qui ils étaient. C'est en ces jours que je vis Artaches Mirzoyan ; lui aussi m'avait vu lorsqu'on l'emmenait en promenade ; la fenêtre de sa cellule donnait aussi sur la cour, il était dans la cellule du bout.
8. DANS LA PRISON D'EREVAN (A.)
DROCHAK, 7e année, N° 24, 18 Mars 1987, pp. 16-19 (973-976).
On me transféra dans une autre cellule, dont la fenêtre donnait sur la cour, et je voyais les détenus des cellules voisines lorsqu'on les emmenait en promenade, je voyais qui ils étaient. C'est en ces jours que je vis Artaches Mirzoyan ; lui aussi m'avait vu lorsqu'on l'emmenait en promenade ; la fenêtre de sa cellule donnait aussi sur la cour, il était dans la cellule du bout.
Artaches Mirzoyan (de Taron) était venu à Tabriz avec les exilés de la République d'Arménie ; il était proche de Hayk Asatrian, c'est pourquoi nous étions devenus amis ; Artaches s'était développé par son propre travail et était un véritable homme du peuple, un bon Dachnak, un Arménien pur et bon. En 1923, le parti l'avait envoyé de Tabriz en Arménie Soviétique, pour des affaires d'organisation, puis il avait été emprisonné. Il avait une grave tuberculose...
En passant devant ma fenêtre, il jeta une boulette de papier à l'intérieur. Je l'ouvris, il avait écrit : « Mon cher, je vais mettre une lettre dans le mur de terre des toilettes, toi aussi fais de même ». Ainsi commença notre correspondance. J'écrivais en répondant à ses questions sur la vie à l'étranger ; je n'écrivais rien sur moi.
Nous avions deux gardiens-clés. L'un, nommé Tsakov, vulgaire, ignorant ; l'autre, nommé Aram, au visage sympathique et au bon comportement ; on voyait qu'il me portait de la sympathie, et moi aussi j'étais très poli avec lui.
Un jour, alors qu'on m'avait fait sortir dans la cour pour me promener, à peine étais-je sorti des toilettes que deux gardes russes m'arrêtèrent, appelèrent Aram et dirent : fouille-le... Aram commença à me fouiller, mes poches, les poches de mon caleçon, et lorsqu'il allait arriver à mes pieds et mes chaussures, je dis : « Allons, Aram, tu as regardé partout, ça suffit »...
Aram ne fouilla pas mes chaussures, dit aux soldats qu'il n'y avait rien... on me laissa partir, à peine arrivé dans ma cellule, je sortis ma lettre de l'intérieur de ma chaussette et la cachai dans une fente du poêle en briques du mur. Je respirai librement, Aram m'avait sauvé* (Lorsque deux ans plus tard je fus exilé en Perse, je décrivis dans notre organe égyptien « Tsaysaber » en 1931, la prison de la Tchéka d'Erevan, dans un feuilleton intitulé « Sous les talons de fer ». J'avais signé : A. Amourián. (A.A.)).
֍
On amena dans ma cellule un jeune berger turc d'à peine vingt ans, un « zır çoban », comme on dit. Il avait tué un homme dans son village, vivait un cauchemar mortel, la nuit, parfois, il sursautait dans son lit, délirait. Il était pouilleux, lorsqu'il frappait son bonnet en peau de mouton d'une main contre l'autre, les poux se dispersaient sur le sol...
Ensuite, on amena dans ma cellule un autre Turc et deux Arméniens bolchéviks, qui, apparemment, étaient des tchékistes. Le plus âgé s'appelait Abraham, l'autre plus jeune, nommé Nersès, avec une barbe courte et pointue, les cheveux coiffés en arrière, il ressemblait à Trotsky, disait Abraham. L'amour-propre de Nersès était flatté. En ces jours, Trotsky avait encore des partisans, dont nous parlerons plus tard.
Nersès était indigné d'avoir été emprisonné, disait qu'il avait eu des pouvoirs sur le chemin de fer Tiflis-Léninakan, même jusqu'à arrêter le train, et voilà qu'on l'avait emprisonné, il ne disait pas pour quelle raison. Il se vantait des succès qu'il avait eus auprès des femmes...
Le nouveau détenu turc avait été arrêté en traversant la frontière vers le territoire soviétique ; en ces jours, l'insurrection kurde de l'Ararat avait déjà commencé, le Turc dit :
« Dedlar ki Dachnak gelmiş Ağrı dağı »... (Ils ont dit qu'un Dachnak est venu sur l'Ararat). Cette nouvelle m'enthousiasma intérieurement. La 10e Assemblée générale du H.H.D. en 1925, lorsque la question de l'insurrection kurde fut posée concernant l'Ararat, décida : « Soutenir l'insurrection de l'Ararat... ». C'est ainsi qu'avait agi le Bureau ; il avait donné l'instruction d'envoyer le camarade Artaches Melkonian, et aussi pour une courte période, Vahan Galstian (Vahan le Noir). La Turquie avait engagé de grandes dépenses et faisait des victimes, elle ne parvenait pas à réprimer l'insurrection* (J'écrirai plus tard, en son lieu, sur la fin de l'insurrection kurde de l'Ararat. Elle prit fin en 1930. A.A.).
Abraham disait quelque chose avec Nersès, puis se tourna : « Je suis un Dachnak moi-même... ». Je fis semblant de ne pas entendre, mais je pensai que je devrais encore entendre beaucoup de telles choses de la part de ces misérables.
Les cellules souterraines de la prison se remplirent de jeunes trotskistes, du bruit, des cris, des slogans, puis aussi « L'Internationale », leur hymne. Cela donnait l'impression que c'étaient les démonstrations du « Chakhsé-Vakhsé » des musulmans.
On emmena tous les détenus de ma cellule, on amena un jeune trotskiste dont le visage ressemblait à celui d'un bouledogue, le nez court, les lèvres protubérantes, la voix cassée. Il se joignait aux autres avec des cris et hurlait : « Pourquoi m'avez-vous mis avec un Dachnak contre-révolutionnaire... ? » Je ne lui parlai absolument pas ; on vint l'emmener aussi, on amena un autre, qui s'appelait Atchoyan, originaire de Van. Lui aussi était un sympathisant du social-démocrate David Ananouni ; à son sujet, Jinoviev avait dit : « En Arménie, il existe un atchoyanisme... ». Et cela avait flatté son amour-propre. David Ananouni avait un ouvrage : « Le développement social des Arméniens de Russie », qui est un ouvrage sérieux ; avec quelques-uns de ses sympathisants, il avait été exilé en Sibérie, et il y mourut...
Lorsqu'on faisait sortir les trotskistes dans la cour pour la promenade, je remarquai deux visages connus. L'un était le frère cadet du poète Garnik Kealachian, Nikol Kealachian, que je connaissais de Vagharchapat ; l'autre, un jeune homme nommé Sassoun, qui avait été à Keopri Keuy, comme volontaire ; il était facteur, on lui avait donné un cheval, il maintenait la liaison entre notre état-major de Keopri Keuy et le village de Yachan.
Ni eux ne me firent signe de reconnaissance, ni moi à eux ; surtout pour eux, il aurait été très dangereux d'être en relation avec moi. N'étais-je pas un Dachnak ?
Une fois, Artaches Mirzoyan, en revenant de la promenade dans la cour, en passant devant les cellules des trotskistes, disait d'une voix cassée : « Faites-vous baptiser, faites-vous baptiser... » Les détenus dachnaks entendirent ces paroles et se turent ; ils devaient vraiment être baptisés ; car ils étaient encore des Panchouni, ils avaient beaucoup à apprendre.
UNE ANCIENNE RENCONTRE AVEC UN DÉNONCIATEUR
Lors des dernières séances de la 10e Assemblée générale (à Paris), un télégramme fut reçu de nos camarades de Roumanie, qu'un étudiant venant de l'Union Soviétique avait traversé la frontière et voulait venir à l'Assemblée générale. On leur télégraphia que c'était déjà tard, l'Assemblée se terminait.
Un jour, je me rendais de la maison à l'université, lorsqu'une personne de taille à peine moyenne, aux yeux noirs et grands, la tête presque chauve, m'arrêta dans la rue :
- Vous êtes André, n'est-ce pas ? demanda-t-il.
- Oui, mais vous, qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas, dis-je.
- Je suis cet étudiant, Boudachko * (* c'était le nom abrégé de Haroutioun Boudaghian), qui ai fui le pays soviétique vers la Roumanie ; je devais venir à l'Assemblée générale, mais j'étais en retard, ensuite je suis passé à Paris, j'ai pris connaissance des procès-verbaux de l'Assemblée, dans lesquels vous aviez aussi des écrits. Le camarade Rouben m'a donné une lettre pour rencontrer la direction des socialistes-révolutionnaires russes se trouvant à Prague, afin qu'ils m'envoient en Union Soviétique par leur voie secrète. Le camarade Rouben a dit de vous rencontrer, que vous me conduisiez au centre des socialistes-révolutionnaires.
- Demain, à la même heure, attends-moi ici même, nous irons au centre des soc.-rév., je te présenterai, d'ici là, tu ne dois avoir de rencontre d'aucune sorte avec nos étudiants, car tu as une mission secrète, tu ne dois pas te montrer, dis-je et nous nous séparâmes.
Le lendemain, nous nous rencontrâmes, je le conduisis au centre des soc.-rév., il présenta la lettre du camarade Rouben ; ils approuvèrent et lui dirent de revenir deux jours plus tard, pour qu'ils l'acheminent.
Le lendemain, lorsque j'entrai à la « Maison des Étudiants », les étudiants exilés d'Arménie dirent : « André, Boudachko est venu du pays, nous l'avons rencontré... ». Intérieurement, je fus furieux, puis je dis : « Je ne connais personne du nom de Boudachko » et je partis immédiatement.
Le soir, je rôdais autour de la « Maison des Étudiants » pour rencontrer celui appelé Boudachko, et je le rencontrai.
- Viens, allons-y, j'ai affaire avec toi, dis-je.
J'entrai dans un bistrot, m'assis près du mur, derrière une table, Boudachko en face de moi, je commençai à le réprimander :
- Quel genre d'agent secret es-tu ? Ne t'avais-je pas dit de ne rencontrer personne ? Maintenant tu t'es montré et tu as mis en danger l'affaire secrète. Je regrette de t'avoir présenté au centre des soc.-rév...., dis-je sévèrement.
- Je passais dans la rue, les gars m'ont rencontré par hasard, commença-t-il à se justifier.
À cet instant, un intellectuel russe, qui avait une chope de bière à la main, ivre et tenant un discours, s'approcha en titubant de notre table, regarda le visage de Boudachko et dit :
- Eh, toi, Caucasien, tes yeux... sont suspects.
Sur ces mots du Russe, mon soupçon envers Boudachko se renforça, c'est pourquoi je dis :
- Je n'ai plus affaire avec toi, que je ne te voie plus, et, ayant payé l'argent de la bière, je sortis rapidement du bistrot.
Dans notre logement, je racontai tout à Gaspar, qui avait participé à l'Assemblée générale, et j'ajoutai que je n'avais même pas parlé de Boudachko à Gaspar, parce que le camarade Rouben m'avait seulement désigné pour le présenter aux soc.-rév.
- Tu as bien fait de rompre le lien avec lui. Qui sait, quel type c'est.
(Plus tard, j'aurai à nouveau l'occasion d'écrire sur Boudachko, en son lieu). A.A.
֍
On amena dans ma cellule l'ancien tchékiste Micha Safrazbékov, de Zanguézour. Il avait été chef de la section spéciale de la Tchéka d'Arménie, maintenant détenu. Dès le premier abord, il dit : « Tout ce que j'apprendrai, je devrai le rapporter en haut... ». C'était déjà le « devoir sacré » de tout bolchévik...
Plus tard, Micha, lors d'une conversation, dit : « Lénine a dit : celui qui est bolchévik, est tchékiste. Celui qui n'est pas tchékiste, n'est pas bolchévik ».
L'homme faisait comprendre que bien qu'il soit détenu, il était un espion, puisqu'il était bolchévik.
J'étais réservé dans mes expressions et je montrais que je ne comprenais pas grand-chose à la politique.
Micha, au visage marqué par la variole, au crâne chauve, mais au caractère retors, était un individu. Chaque jour, il recevait le journal « Sovietakan Hayastan », moi aussi je le lisais.
Parfois, Micha s'énervait et se mettait en colère au sujet de l'accusation pesant sur lui et injuriait Mughdousi, l'assistant du président de la Tchéka Melik Osipov.
֍
La femme de Micha lui apportait des livres de lecture, et voilà qu'un jour elle avait apporté les mémoires traduits en russe du Jeune-Turc génocidaire Djemal Pacha.
Djemal Pacha avait été soumis à un attentat en 1923 à Tiflis, organisé par le Comité central du H.H.D. de Géorgie, juste dans la rue de la Tchéka. La Tchéka avait emprisonné près de six cents Dachnaks et sympathisants, mais n'avait pas pu identifier précisément les terroristes.
Des dirigeants dachnaks avaient été emprisonnés : Korioun Ghazazian, Bagrat Topchian, Minas Makarian, puis aussi : Tigran Avétisian. Celui-ci s'était d'abord caché. Sentant que la Tchéka pouvait fusiller nos camarades, Tigran avait appelé de la région de Dilidjan à Tiflis près de vingt-cinq camarades, puis avait envoyé une menace à la Tchéka, que si un seul Dachnak était fusillé, la Tchéka serait soufflée... Les tchékistes étaient furieux, mais connaissant la force terroriste de la Fédération Révolutionnaire Arménienne, ils avaient décidé la prison et l'exil (j'ai déjà écrit dans les pages précédentes que j'avais eu une conversation à Moscou avec le camarade Bagrat Topchian au sujet de Djemal).
Lorsque je vis chez Micha les mémoires de Djemal (un livre de 3-400 pages), bien que ma curiosité fut très éveillée, je fis semblant d'être indifférent. Micha lisait et s'exclamait. J'étais silencieux et indifférent. Trois-quatre jours passèrent ainsi, finalement Micha me dit : « Tu dois lire ce livre ». Quel livre ? demandai-je. « Les mémoires de Djemal Pacha », dit-il. « Qu'est-ce qui est intéressant dans la lecture des mémoires d'un pacha ? », dis-je en appuyant sur le mot pacha. « Tu liras et tu verras que c'est intéressant », dit-il en me mettant le livre dans la main.
Les Soviétiques avaient traduit les mémoires de Djemal, pour perpétuer la mémoire du génocidaire, du compagnon sanguinaire d'Enver et de Talaat, qui avaient massacré un million et demi d'Arméniens innocents.
Le cas des mémoires de Djemal éveilla en moi le soupçon que la Tchéka voulait lier mon nom à un attentat. Plus tard, au cours des interrogatoires, je vis que l'enquêteur insistait particulièrement sur l'endroit où j'étais en 1922-1923...
Donc, ils soupçonnaient que j'étais soi-disant passé par Batoum vers Tiflis en 1922-23, pour donner l'instruction de l'attentat contre Djemal, et que maintenant j'étais venu via Moscou, peut-être avec l'instruction d'un autre attentat...
Je lus les mémoires avec un grand intérêt intérieur. Djemal Pacha avait constamment essayé de prouver que le gouvernement ottoman avait bien traité les Arméniens, qu'il avait même donné une Constitution en 1861, qu'aucun autre État n'avait donnée à sa minorité nationale...
Lorsque j'eus terminé le livre, Micha demanda : « Alors, ce n'était pas intéressant ? ». Je n'en tins plus, disant : « C'est si intéressant que des gens comme lui, après avoir massacré un million et demi d'Arméniens, écrivent encore qu'ils ont bien traité les Arméniens »... Et, à ma grande surprise, Micha se mit à parler d'Antranik, qui, lorsqu'il était passé par le Zanguézour, avait pris Manquiz, qui était la plus grande forteresse des Turcs et que personne n'avait pu prendre auparavant.
La femme de Micha apporta aussi un ouvrage de Friedrich Engels. Micha lisait, s'exclamait avec admiration, puis se tourna vers moi, demanda :
- Peux-tu dire de quoi s'occupe la science ?
- La science ne s'occupe pas du commencement et de la fin, mais de ce qui existe, dis-je.
- Pourquoi ? demanda Micha.
- Pour ne pas tomber dans le giron de la métaphysique, dis-je.
- Waouh ! Engels a écrit la même chose ici, regarde. D'où le sais-tu ? dit-il, étonné.
Après cette question et réponse, Micha commença à se comporter avec moi avec respect.
֍
Je portais ma vieille veste d'étudiant. Micha en saisit le col, disant : « Ce tissu est européen » et retourna mon col et resta stupéfait... À l'intérieur de mon col, un petit tricolore était épinglé avec une aiguille, que je n'avais pas remarqué en enlevant mes affaires et qui était resté... « Qu'est-ce que c'est, hein ? », s'exclama-t-il. Je ne perdis pas mon sang-froid. « Lors des fêtes, on accroche de tels ornements sur la poitrine des gens, c'est de là », dis-je ; à cet instant, le gardien-clé Aram était debout à la porte de notre cellule ; Micha se tourna vers lui en disant : « Aram, va raconter une histoire ». Je ne sais pas si Aram vit le petit drapeau sur ma poitrine ou non, il partit.
Lorsque Micha fut appelé pour une visite avec sa femme et que je restai seul, j'avais une cravate sur laquelle il y avait des bandes colorées, j'en coupai un morceau d'un bout et le mis dans ma poche, pour dire, si on me demandait, que c'est cela qu'il avait vu. Et le petit drapeau, je ne parvins pas à le prendre pour le détruire, mais je le mis dans une fente du poêle en briques délabré du mur (kamina) de telle sorte que même si on fouillait, on ne le remarquerait pas.
À ma grande surprise, l'enquêteur de la Tchéka ne dit rien à ce sujet. Micha et Aram n'avaient-ils pas informé, ou bien la Tchéka fut-elle discrète, parce que le drapeau n'était pas tombé entre ses mains ? Jusqu'à présent, cela est resté une énigme pour moi.
֍
Micha avait commencé à s'occuper à résoudre des problèmes d'algèbre, je sentis que c'était très dangereux. À ses insistances pour que je m'y mette aussi, j'évitai catégoriquement, prétextant que je n'y connaissais rien en algèbre.
Le danger était le suivant : les lettres algébriques, les chiffres et les signes ressemblent à des chiffres (code secret) ; la formule la plus simple pouvait devenir accusatoire, que soi-disant j'écrivais des lettres en code. Plus tard aussi, dans la forteresse Metekh de Tiflis et dans l'isolement de Iaroslavl, des espions essayèrent de me faire écrire des choses, j'évitai ; d'autant plus que j'avais remis des codes à nos camarades, à Moscou (j'ai écrit à ce sujet dans les pages précédentes).
Cette tentative de Micha n'eut pas non plus de succès. J'étais très réservé, je pesais mes mots, puis je parlais.
֍
Le journal « Sovietakan Hayastan », que Micha recevait, je le lisais aussi. Dans le journal, je rencontrais des noms qui m'étaient connus : l'arménologue Manuk Abeghian, mon ancien professeur, conférencier à l'université d'Erevan. Hrachia Acharian - arménologue-linguiste, conférencier. Grigor Ghapancian - arménologue-linguiste. Achot Hovhannessian - secrétaire du Parti communiste d'Arménie (historien). Poghos Makintsian - dirigeant communiste, qui se trouvait mostly à Tiflis et Moscou. L'ancien séminariste Mouchegh Santrossian - pédagogue-psychologue. Mon ancien camarade de classe, Nahapet Kiourghinian - membre du bureau politique. Haïkaz Ghazarian - ancien séminariste, dirigeant communiste. Nchan Makounts - ancien séminariste, dirigeant communiste.
Je sais ce qui suit concernant ces personnes : On avait forcé Manuk Abeghian (sous la menace de la prison et de l'exil) à composer la nouvelle orthographe arménienne. On avait exigé de Hrachia Acharian d'introduire la dialectique dans la linguistique ; j'étais encore à Paris, lorsque je vis dans le journal « Sovietakan Hayastan » une caricature d'Acharian, sous laquelle étaient écrites ses paroles : « Tu peux mettre ta dialectique où tu veux, mais ne l'introduis pas dans ma linguistique... ». Et on l'avait emprisonné. Grigor Ghapancian n'était pas non plus communiste et on lui avait causé des ennuis. Achot Hovhannessian avait été chassé en Sibérie lors des purges staliniennes (il s'en était bien tiré... on avait fusillé ses autres camarades), il ne revint en Arménie qu'après Staline.
On avait envoyé Poghos Makintsian en mission à Constantinople, puis rappelé et fusillé.
Mouchegh Santrossian était toujours resté conférencier.
Nahapet Kiourghinian fut victime des purges staliniennes. Haïkaz Ghazarian et Nchan Makounts, de même.
֍
L'amour-propre de Micha était flatté lorsque je disais : « Tu as l'air d'un tchékiste expérimenté... ». Il commençait à raconter les méthodes de la Tchéka. « Nous avons appris des choses des méthodes japonaises. Par exemple : le « jujuban » et il expliquait : « L'organisation d'espionnage des Japonais s'appelle « Dragon ». Lorsque quelqu'un de l'extérieur va au Japon, l'espion le suit à chaque pas, même jusqu'aux toilettes ; finalement, le visiteur, agacé, quitte le pays. Notre Tchéka a des écoles spéciales pour former les tchékistes. Je suis un diplômé de cette école », disait Micha.
Une fois, un tchékiste nommé Peredereïev vint voir Micha. Ils parlèrent de son accusation. « Celui appelé Mughdousi a décidé de me détruire », dit Micha. Ils parlaient russe. En partant, Peredereïev promit à Micha de faire le possible ; puis il jeta un regard oblique sur moi et partit. C'était un Arménien russophone.
Une fois, on parla à nouveau de la Turquie. Je dis : « Kars et Ardahan sont arméniens, mais ils ont été cédés à la Turquie ». Micha répondit : « Maintenant, ce n'est pas leur moment, quand le temps viendra, on les reprendra. Il faut patienter... ».
֍
Ma mère m'envoyait de la nourriture deux fois par semaine ; au bureau de la remise, un tchékiste examinait la nourriture ; s'il y avait des gâteaux, il les brisait devant moi, pour voir s'il n'y avait rien à l'intérieur ; je recevais les miettes du gâteau... même les pommes de terre étaient coupées. Voilà à quel point l'examen était strict, et sur les détenus aussi, il y avait des détenus-espions placés. C'était une atmosphère de suspicion, il était difficile de déterminer qui était le vrai détenu, qui était l'espion.
9. DANS LA PRISON D'EREVAN (B.)
DROCHAK, 7e année, N° 25, 1 Avril, 1987, pp. 11-13 (1011-1013).
Le premier jour de mon arrestation, lorsqu'on me fouilla dans la pièce du bas de la Tchéka, à côté du tchékiste assis derrière la table se tenait un autre tchékiste ; le tchékiste assis commença à m'interroger et à remplir le questionnaire : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Je répondais ; à cet instant, le tchékiste debout près de la table entra une seconde dans la pièce voisine, le tchékiste enquêteur me demanda rapidement :
« Tu es sans-parti, n'est-ce pas ? ». Je fus surpris. Je dis : « Vous avez dit... ». Il écrivit sans-parti ; à cet instant, les autres questions n'avaient pas un caractère politique, je dis que j'étais venu à Erevan avec un visa de transit, que j'avais obtenu la permission de rester une semaine, que je m'étais présenté chaque jour à midi au commissariat de l'Intérieur, la dernière fois, lorsque j'avais exprimé le désir de rester définitivement, le fonctionnaire m'avait donné un papier pour écrire une demande ; ma demande non encore signée, on m'avait arrêté ; en disant cela, je donnai ma demande non signée à l'enquêteur.
Le second interrogatoire eut un caractère formel. Nous montâmes dans un bureau à l'étage supérieur. C'était ici l'assistant du président de la Tchéka Melik Osipov, Vardanian, et un autre tchékiste ; sur le bureau, je vis des numérés du « Drochak » empilés les uns sur les autres. J'y avais des articles signés « André ».
Lorsque Vardanian allait sortir de la pièce, il dit au tchékiste : « Donnez-lui le "Drochak", qu'il lise ». « Je n'en ai pas besoin, c'est à vous de lire », dis-je au tchékiste...
֍
C'était le jour du 29 septembre 1928. Un soldat de l'Armée rouge russe m'emmena sur le balcon du troisième étage du bâtiment de la Tchéka, dit : attends une seconde, lui-même frappa à la porte, je regardai derrière moi et je vis le Massis dans toute sa splendeur...
C'était l'Arménie spiritualisée, le rêve de l'arménité, après les ténèbres de la prison, face à cette vue vertigineuse, il me sembla que le Massis-Ararat fut transféré en moi ; je sentis une force psychique extraordinaire ; à ce moment, le soldat russe se retourna et dit : « Entre ».
À peine entré, je vis, assis face au bureau de l'enquêteur, le dos tourné à la porte par laquelle j'étais entré, le provocateur appelé Boudachko, vêtu d'une blouse à la Tolstoï, de couleur rouge délavée... Une colère me saisit en le voyant.
Adossé à la fenêtre de la pièce, un pied posé, était assis un militaire russe, la main droite sur son pistolet.
L'enquêteur était Levon Margarian, celui qui m'avait dit : « Tu es sans-parti, n'est-ce pas ? ».
- Assieds-toi près de lui, me dit mon enquêteur.
- Je ne m'assiérai pas près de lui, dis-je catégoriquement.
- C'est un détenu, assieds-toi près de lui, dit-il.
- C'est faux, ce n'est pas un détenu, je ne m'assiérai pas près d'un tel individu, dis-je.
L'enquêteur se leva, vint prendre la chaise près de lui, la plaça près de l'angle droit de la table ; je m'assis là.
L'enquêteur commença, en montrant Boudachko :
- Celui-ci dit qu'il a été avec toi à la conférence des Dachnaks à Paris...
- Ce misérable ment, je n'ai pas été en réunion avec lui, dis-je, et je me jetai sur Boudachko. À cet instant, le tchékiste russe et mon enquêteur coururent vers moi. « Sors, sors », dit mon enquêteur à Boudachko, qui partit immédiatement. Puis, se tournant vers moi, mon enquêteur dit avec colère :
- De quel droit as-tu attaqué un détenu...
- Ce n'est pas un détenu, c'est un menteur trompeur, il vous trompera vous aussi, n'importe qui, dis-je. L'enquêteur s'assit sur sa chaise et dit :
- Alors, tu n'as pas participé à la conférence des Dachnaks, n'est-ce pas ? demanda-t-il.
- J'y ai participé, mais vous ne devriez rien en savoir, dis-je.
L'enquêteur dit :
- André ! André !... alors tu as participé, dit-il avec un regret évident... (il voulait m'épargner, c'était la deuxième fois).
Il rédigea le procès-verbal, je signai. Avec cette déclaration, mon dossier devait s'alourdir, mais j'étais aussi confiant en moi et déterminé.
Ma déclaration à propos de Boudachko : « Il vous trompera vous aussi, n'importe qui », la Tchéka étant très méfiante, devait penser que Boudachko ne leur avait pas tout dit et devait lui causer des ennuis.
On me ramena dans ma cellule.
La même nuit, après minuit, on m'emmena à nouveau pour interrogatoire, et quoi ? je vis sur la table le livre de Simon Vratsian « République d'Arménie ».
Cette fois, assis derrière la table était un tchékiste nommé Petrossian, au caractère et aux expressions acerbes, et près de la table, un tchékiste nommé Poghosian.
- Vous avez écrit ce livre avec Vratsian, ton nom y figure, dit Petrossian.
- Je n'ai pas écrit de livre avec Vratsian, j'étais un ouvrier correcteur d'imprimerie, j'ai seulement fait des corrections, dis-je.
- Non, vous l'avez écrit ensemble, insista Petrossian.
- Je n'aurais pas pu écrire un tel livre, parce qu'à ces dates je n'étais pas en Arménie, répondis-je.
- Participer à la conférence des Dachnaks, écrire un livre contre les Soviets, savez-vous que nous avons la Sibérie ? dit-il.
- C'est un plaisir pour vous d'envoyer des jeunes en Sibérie, dis-je sévèrement.
- Citoyen, pourquoi insultez-vous notre chef ? dit Poghosian.
- Je n'ai fait que répondre à la menace de votre chef, dis-je.
Il était environ une heure et demie après minuit lorsqu'on me ramena dans ma cellule. Ce jour fut exceptionnel durant mon emprisonnement.
La nuit, je vis en rêve que le camarade S. Vratsian se tenait en haut des escaliers. D'en bas, je dis :
- Camarade Vratsian, pourquoi as-tu envoyé ton livre ?
N'ayant pas reçu de « réponse », je me réveillai. Je regardai Micha allongé dans ma cellule. Était-il éveillé ? N'avais-je pas posé à haute voix la question de mon rêve, Micha avait-il entendu...
Le lendemain, je fus attentif, pour voir si Micha n'avait pas entendu. Je me convainquis que je n'avais pas parlé à haute voix, Micha ne savait rien.
֍
Le lendemain, dans le journal « Sovietakan Hayastan », je lus ce qui suit à propos du tchékiste Chahazizov et de Boudachko –
« Quarante mille roubles du MOPR (organisation d'aide aux ouvriers emprisonnés à l'étranger) ont été détournés dans un jeu d'argent : le tchékiste Chahazizov et Boudachko. Chahazizov a laissé une lettre déclarant : "vous ne me reverrez plus", Boudachko est emprisonné ».
En lisant cela, je crus la parole de mon enquêteur, que Boudachko était un détenu ; d'un autre côté, ce monstre ne pouvait plus faire de nouvelles dénonciations, il était emprisonné.
Un jour, lorsque Boudachko, revenant de la cour, passait devant la fenêtre de ma cellule, je crachai en disant : « Craa ! Provocateur ! Maintenant tu vas payer... ».
Et en effet, plus tard, on l'exila en Sibérie et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles de lui.
La Providence régla son cas. Si je n'avais pas été emprisonné et que son attentat réussisse, moi, et le terroriste, et peut-être d'autres innocents, aurions été sacrifiés. La fin du mal se termina par le mal.
֍
Les détenus se donnaient des nouvelles en frappant le mur (ils avaient un code). Je m'allongeais sur mon lit de planches et j'écoutais les coups du code, qui s'entendaient bien à travers le mur. J'entendis un jour : « Ils ont emmené Témour bey cette nuit... ». Témour bey était l'un de nos camarades, de grande taille, d'environ soixante ans, le frère aîné du docteur Smbat Yeghiazarian, le père de Babguén et Sourén Yeghiazarian. Eux se trouvaient à Tabriz, puis à Téhéran.
Il y avait un autre jeune de forte carrure, nommé Varantsov, de nos camarades de la région de l'Aragats.
Mukuch Abarantsi, qui était un des étudiants exilés et était revenu au Pays, était emprisonné ; on disait qu'il était membre du Comité central.
Tous ceux-là étaient emprisonnés dans les cellules souterraines.
Le poêle (kamin) du mur de la cellule à droite de ma cellule était délabré, il avait des fentes, de là aussi, une ou deux personnes me parlaient lorsque Micha n'était pas près de moi. On avait amené dans cette cellule un évêque arménien venu de Roumanie, au corps corpulent, je le vis lorsqu'on le fit sortir dans la cour le premier jour.
Parmi les détenus, la nouvelle s'était déjà répandue à mon sujet, qu'un « leader dachnak » était venu d'Europe et avait été emprisonné. Un jour, quelqu'un me dit par une fente du poêle du mur de la cellule voisine : « Ne les crois pas, hein ! Ils feraient pleurer la mère d'un homme... ».
֍
Toutes nos conceptions éthiques sont, aux yeux d'un bolchévik, bourgeoises, des préjugés. Lorsqu'un jour on en parla avec le tchékiste Micha Safrazbékov, il dit absolument : - « Quand un bolchévik dit à quelqu'un "parole d'honneur", il peut faire le contraire complet, à moins qu'il ne dise : "parole d'honneur communiste", il ne faut pas croire... seule la "parole d'honneur" est bourgeoise, c'est pourquoi le bolchévik ne fait pas de distinction dans les moyens, pour vaincre la bourgeoisie ».
Lénine a dit : « Pour vaincre l'impérialisme capitaliste, il ne faut pas faire de distinction dans les moyens ».
֍
Mélik Osipov, le président de la Tchéka d'Arménie, de corpulence mince, les cheveux peignés sur un côté, vint un jour alors que nous étions sortis dans la cour pour la promenade. En me voyant, il demanda mon nom. « Tu as participé à la conférence des Dachnaks à Paris », dit-il.
- Paris ne se trouve pas dans les frontières de l'Union Soviétique, dis-je.
- Ainsi, donc, participer à une conférence à Paris, ce n'est rien... dit-il et partit.
Lorsque ma mère s'était présentée à Mélik Osipov et avait demandé ma libération, Mélik Osipov avait demandé :
- Combien de fils as-tu ?
- Trois, avait dit ma mère.
- Qu'il n'y en ait pas un, avait-il dit, avait dit Mélik Osipov.
- Aïe ! Que dites-vous, vous aussi vous êtes père d'enfants, comment pouvez-vous renoncer à vos enfants ? avait dit ma mère.
Je dois dire que ce même Mélik Osipov, lors des purges staliniennes (en 1937), avait été destitué, envoyé comme directeur d'une boulangerie. Puis on l'avait arrêté, fusillé...
Mughdousi, le chef de mon enquêteur Levon Margarian et le directeur de cette section, était un homme mince, vif, aux yeux noirs et aux longs cils. Une fois, pendant mon interrogatoire, il entra, me toisa rapidement des pieds à la tête et sortit. Lui aussi, après la destitution de Mélik Osipov, prit sa place un court moment, puis fut arrêté ; la Tchéka avait trouvé un passeport persan dans son appartement... Il avait probablement pensé, en cas de danger, fuir en Perse.... Lui aussi fut fusillé.
Chose étrange. J'étais un détenu et je me considérais comme « mortel », mais il arriva que tous mes enquêteurs, presque, eurent une mort non naturelle. J'ai été deux fois le prisonnier du cruel Lavrenti Beria. Lui non plus n'échappa pas au peloton d'exécution, la faux de la révolution faucha aussi lui et Staline...
Mais j'y reviendrai plus tard.
֍
On m'appela chez l'enquêteur et on m'annonça que mon dossier avait été transféré à Tiflis, près de la Tchéka Transcaucasienne. Moi aussi, on allait m'envoyer à Tiflis.
Nous, un grand groupe de détenus, fûmes emmenés à la gare d'Erevan, sous la garde de soldats de l'Armée rouge. À environ 50-60 pas de la gare, des proches de détenus s'étaient rassemblés, mais on ne leur permit pas d'approcher.
Nous nous assîmes dans les wagons-cellules, dont les fenêtres avaient des barreaux de fer. Dans mon wagon se trouvaient en grande majorité de jeunes trotskistes, qui se mirent à crier des slogans, et aussi à insulter les « Dachnaks ». Pendant ce temps, je vois Varantsov, assis parmi eux, se lever et déclarer sévèrement : « Si j'entends encore une insulte pareille, je vous casse le nez et la bouche à tous », dit-il et vint s'asseoir près de moi. Je l'avais vu en prison, mais nous ne nous étions pas encore connus. À partir de cet instant, nous devînmes amis. Les trotskistes n'osèrent plus nous insulter.
De la gare de Tiflis, on nous emmena devant la forteresse-prison de Metekh ; j'avais mis l'imperméable offert par Vratsian ; apparemment, j'attirai l'attention, un tchékiste russe aux bottes à longues pointes (sapogi) s'approcha de moi. « Comment t'appelles-tu ? », demanda-t-il. Je dis mon nom et prénom. Il me jeta un regard et s'éloigna.
Des détenus debout près de moi dirent : « C'est le tchékiste Papov, malheur à nous ».
(Je reviendrai plus tard sur ce Papov).
On nous logea d'abord dans la cellule du haut de la première cour, où il y avait aussi quelques détenus ossètes, qui s'asseyaient et chantaient en chœur une chanson monotone : « haralô ! ha ! haralô ! ».
Il y avait un vieillard osseux d'origine allemande, qui se vantait d'avoir été gendarme sous le régime tsariste et d'avoir emmené Staline en sécurité de Batoum à Bakou. « Staline me connaît », répétait-il sans cesse. Deux jours plus tard, à minuit, ce vieillard s'effondra sur le sol, on entendit le bruit des os, on vint l'emmener à l'hôpital. Parmi les détenus, une rumeur circula : « on l'a empoisonné... ».
J'appris que le prêtre Khatchvankian se trouvait dans la prison de la cour intérieure de Metekh. Varantsov était débrouillard, je lui envoyai par son intermédiaire un message pour qu'il vienne près de la porte de la cour extérieure, que nous nous rencontrions. Je ne pouvais pas passer dans la cour intérieure.
Le lendemain, je me postai derrière les grilles de la porte de notre cour ; le prêtre Khatchvankian vint avec son aspect sympathique et sa barbe blanche. C'était un ancien diplômé du séminaire, instruit, équilibré ; nous nous étions déjà rencontrés à Tabriz.
- Ah, toi aussi ici, dit-il de derrière les grilles.
- Oui, mon père, je suis venu de Paris, j'ai voulu rester, on m'a arrêté. Où est Onnik ? demandai-je.
- Onnik a été exilé à la ville de Voronej, peut-être qu'on m'enverra aussi près de mon enfant, dit-il.
Nous ne pouvions pas parler de ces choses, car il y avait d'autres personnes.
- Si on me transfère dans la cour intérieure, nous parlerons, mon père, dis-je et nous nous séparâmes.
Nos gars me dirent que le coiffeur de la cour de notre prison avait rasé la tête de la première expédition de Sarkis Koukounian (en 1890) ; c'était un vieil homme.
Je descendis dans la cour et allai à la boutique du coiffeur, pour me faire couper les cheveux et raser.
C'était un vieillard de 60-62 ans, de belle taille, au visage sympathique, aux cheveux blancs.
Lorsque mon tour vint, je demandai :
- Maître, depuis combien d'années es-tu ici ?
- Depuis près de 38 ans. J'en ai rasé beaucoup. Maintenant aussi, il y a deux mille détenus dans cette prison. Jamais il n'y en avait eu autant. J'ai aussi rasé le groupe de Koukounian, dit-il d'une voix douce.
- Je te souhaite longue vie, cher Arménien, dis-je et je sortis de la boutique.
J'étais heureux.
(Cinq ans plus tard, en 1933, à Tabriz, je recueillis les « Souvenirs de l'expédition Koukounian » de Yovsèp Movsissian, qui parut dans le mensuel bostonnais « Hayrenik » en 1933-1934, suscitant un grand intérêt. Ensuite, il fut réimprimé sous forme de feuilleton : le journal « Hayrenik », l'hebdomadaire « Azdak » (Beyrouth, en 1948), le journal « Alik » en 1973, puis parut sous forme de livre séparé :
Sous le titre « L'Odyssée d'Ephrem le Révolutionnaire », à Téhéran, il fut traduit en persan par Hr. Khalatian, avec le mécénat de Ghoukas Karapetian, puis l'édition persane eut une seconde impression. Ainsi, l'histoire de l'expédition Koukounian fut sauvée de la perte).
Il y avait un prêtre détenu, à peine lettré, pauvre et misérable ; il me demanda d'écrire une lettre ouverte à sa famille de sa part. « La vache Maral a-t-elle vêlé ? comment vont les moutons ? », des questions similaires. Comment ce prêtre illettré, pauvre et misérable, allait-il vivre en Sibérie ? La créature humaine n'avait aucune valeur aux yeux du régime soviétique... Mais le communisme n'était-il pas censé être fondé pour les hommes ?
Il y avait un vaurien effronté qui embêtait le prêtre et disait des paroles indécentes ; une fois, je marchai vers lui pour le frapper. Il s'enfuit et ensuite laissa le prêtre tranquille.
10. DANS LA PRISON INTÉRIEURE DE METEKH
DROCHAK, 8e année, N° 2, 13 Mai, 1987, pp. 18-20 (62-64):
De la cour de la prison extérieure, un passage étroit, où il y avait des ateliers dans un état misérable, permettait d'accéder à la prison intérieure, qui se trouvait sur la partie rocheuse supérieure de la rivière Koura. La rive de la Koura est une haute falaise, coupée comme un mur ; aucun détenu ne s'échapperait s'il se jetait de la falaise ; la rivière coule avec un rugissement, heurtant les rochers et elle est profonde. Sur ce grand éboulis rocheux se dresse le monastère de Chouchank, fille de Vartan Mamikonian, qui avait été transformé en club... il y avait des guirlandes de papier suspendues.
Lorsque nous devions monter du fond de la cour aux cellules du deuxième étage, les gars dirent que les détenus sociaux-démocrates géorgiens ne laissaient pas... Je vérifiai : c'était vrai.
Je retournai vers les camarades et dis que nous devions nous ruer en rang à l'intérieur. Varantsov et Artiuch d'Akhaltsikhé, qui étaient de forte carrure, passèrent devant et nous entrâmes de force ; dans la cellule, il y avait des lits libres, lorsque j'eus installé tout le monde, il ne me resta plus de place ; je dis : je vais m'allonger sur le sol ; les gars s'y opposèrent, je dis que je ne céderais pas ; finalement, ils décidèrent qu'à tour de rôle, chacun passerait une nuit sur le sol, jusqu'à ce qu'une place se libère. La première nuit, je m'allongeai sur le sol.
Le lendemain, dans la cour, nous eûmes une dispute avec les Géorgiens. Je leur dis en russe : « Vous avez l'internationalisme dans votre programme, alors que vous ne nous tolérez pas ; c'est une contradiction ». Un tchékiste vint, nous dispersa. L'un des Géorgiens s'approcha de moi et me parla amicalement. Plus tard, ce monsieur me demanda de lui donner des leçons de français...
Je lui dis que je n'écrirais rien sur du papier. « Alors comment ? », demanda-t-il. « J'écrirai sur de la terre ou du sable », dis-je. Il voulait avoir mon écriture, sur laquelle la Tchéka pouvait tout inventer...
Nous apprîmes que la Tchéka de Géorgie gardait les détenus sociaux-démocrates géorgiens à Metekh, ne les envoyait pas en Sibérie, autorisait les visites des familles ; le nationalisme géorgien parlait à l'intérieur des bolchéviks géorgiens.
֍
Je m'isolai dans la cour avec le prêtre Khatchvankian et lui dis ce qui suit : « Mon père, votre fils, Onnik, a été mon camarade de classe intime au "Séminaire Guéorguian". Je ne peux confier mon secret qu'à vous, considérez-moi comme votre enfant ».
- Oui, mon enfant, sois assuré, dit-il.
- Mon père, on t'exilera probablement à Voronej, près d'Onnik. Je te prie de là-bas, d'une manière ou d'une autre, de faire savoir au prêtre Arsen Simonian de Moscou que je suis emprisonné. C'est tout, dis-je.
- Sois assuré, mon enfant, que je ferai le possible, dit le prêtre Khatchvankian. Plus tard, je lui racontai des choses sur l'étranger, comme information. Lui aussi était emprisonné en tant que Dachnak.
Plus tard, on annonça au père que la Tchéka allait l'exiler à Voronej. Nous étions debout près du bâtiment de la prison intérieure de Metekh, lorsqu'un gros morceau de pierre tomba du deuxième étage juste entre nous deux.... C'étaient les Géorgiens. Si la pierre était tombée sur la tête de l'un de nous, nous serions restés sur place ;
- Ce sont des gens passionnés, bons à rien, dit le père. En nous séparant, je dis : « Mon père, alors tu ne m'oublieras pas », - je lui rappelai ainsi ma demande, qu'il entre en contact avec le père Arsen de Moscou. « Sois assuré », dit-il et partit.
֍
Se trouvait dans la prison de Metekh Makents de Zanguézour, qui était un type désagréable ; nos gars me dirent que c'était un agent de la Tchéka. Il avait été près de Nzhdeh, à Zanguézour, mais au moment de la soviétisation, il était devenu un espion. Ce Makents me raconta à Metekh ce qui suit :
- Micha Safrazbékov, de Zanguézour, qui était assis avec toi dans la prison de la Tchéka d'Erevan, avait été emprisonné du temps de Nzhdeh en tant que bolchévik. Il avait un ami nommé Guéorg. Micha dénonça Guéorg. Nous, pour faire avouer Guéorg, dans la pièce voisine, nous feignions de battre Micha, celui-ci poussait des cris. Guéorg fut fusillé à cause de Micha. Après la soviétisation de l'Arménie, Micha se présente comme un bolchévik persécuté et parvient jusqu'au poste de chef de la section d'Exécution de la Tchéka d'Erevan... finalement, ceux qui connaissaient Micha firent comprendre à la Tchéka le passé de Micha* (* Ceux qui dénoncèrent Micha étaient : lui-même, Makents, et Mughdousi, c'est pourquoi Micha ne voulait pas entendre le nom de Mughdousi ; il ne prononçait pas le nom de Makents. - A.A.), et Micha fut emprisonné.
Plus tard, j'appris qu'on avait condamné Micha à dix ans d'exil sur l'île appelée Salavki, située dans le nord de la Russie - c'était l'endroit le plus terrible pour les travaux forcés ; beaucoup de sociaux-démocrates et de socialistes-révolutionnaires avaient aussi été exilés à Salavki et y avaient péri... (deux ans plus tard, ma mère me dit que la femme de Micha lui avait dit : - « Dans une lettre de son lieu d'exil, Micha avait écrit qu'André lui avait envoyé de la nourriture à transmettre, qu'il était reconnaissant ». Ce n'était pas vrai, j'étais en prison, comment et pourquoi aurais-je dû envoyer quelque chose à Micha).
Je rencontrai Artaches Stépanian de Sassoun, un jeune sympathique et Dachnak dévoué, il avait été jugé lors du procès de l'attentat de « Manuk Khuchoyan » en 1926, condamné à trois ans de prison, avec le camarade Sahag Stépanossian, dans la prison de l'Oural. Avant même que les trois ans ne soient écoulés, la Tchéka l'avait libéré de prison, même avec le droit de retourner à Alaguiaz.
- Lorsque je suis retourné à l'Aragats, disait Artaches, - nos Sassountsi soupçonnèrent : pourquoi t'ont-ils libéré avant le terme, pourquoi ont-ils gardé les autres ? - Une situation difficile se créa pour moi. Je ne savais que faire, jusqu'à ce que la Tchéka m'arrête à nouveau et m'emprisonne. Voilà pourquoi je me trouve ici.
Puis Artaches me communiqua une nouvelle très importante :
- Si jamais tu rencontres Mukuch Abarantsi* (* J'ai rencontré ce Mukuch plus tard dans la prison de Iaroslavl. J'écrirai à ce sujet en son temps. Il n'a pas réussi à apprendre quoi que ce soit de moi. - A.A.), sois prudent, il est suspect.
Lorsqu'on annonça à Artaches de rassembler ses affaires, je lui offris ma couverture en guise d'adieu (en avril 1929).
(En 1930, lorsque je fus exilé en Perse, Artaches, avec les fedayin Cholo et Mourouk Karo, traversèrent illégalement l'Araxe et vinrent à Tabriz. J'écrirai à ce sujet en son temps).
֍
Avec moi, plusieurs jeunes Arméniens, d'une vingtaine à vingt-cinq ans, avaient été amenés de Erevan à Metekh en tant que détenus. Ces jeunes s'approchèrent de moi dans la cour de Metekh et me demandèrent ce qui suit :
- Nous avions formé en Arménie une société secrète nommée « Union Haykazian », avec des revendications nationales. La Tchéka nous a emprisonnés et accusés d'être des Dachnaks, mais nous ne connaissons pas le programme de la Fédération Révolutionnaire Arménienne. Nous vous prions de nous l'expliquer.
Lorsque j'expliquai notre programme, ils s'exclamèrent :
- Alors l'accusation était juste, nous sommes des Dachnaks...
- Vous êtes tous sous cette accusation ? demandai-je.
- Seuls les yeux de celui-ci sont coupables, dirent-ils, en montrant un jeune d'une vingtaine d'années aux beaux yeux.
- Comment ? demandai-je.
- Une belle fille, un tchékiste, était amoureuse de ses yeux ; pour s'emparer de la fille, ce garçon a été fait emprisonner en tant que Dachnak, répondirent-ils ; de tels cas arrivent.
֍
Un exemplaire du journal bolchévik « Erevan » publié à Paris apparut dans la prison de Metekh. Quelqu'un lisait à haute voix le discours de Chahan Natali contre la Fédération Révolutionnaire Arménienne. J'informai nos gars que Chahan avait été expulsé de la Fédération Révolutionnaire Arménienne pour des dépenses d'argent et des activités arbitraires.
֍
Lorsqu'on appelait un détenu de la prison de Metekh jusqu'à une heure de l'après-midi, c'était pour l'envoyer en exil, et si on l'appelait après midi, cela signifiait soit l'emmener à la prison de la Tchéka, soit l'exécution.
On m'appela après midi. Nous étions un groupe de détenus, entourés de gardes, on nous fit marcher à pied jusqu'à la prison de la Tchéka. Nous traversâmes un pont, par une partie d'Avlabari, par le marché de Tiflis, nous sortîmes sur la place d'Erevan. Je marchais dans le premier rang du groupe. Beaucoup de choses me rappelaient mes jours passés à Tiflis. Rien n'avait changé, il n'y avait pas eu de construction au cours des dix années (1919-1929).
Nous passâmes aussi près de notre rue (Joukovskaïa), la rue Veliaminovski, et nous nous arrêtâmes devant le bâtiment de la Tchéka. Artiuch d'Akhaltsikhé était avec moi. Dans l'antichambre de la Tchéka, on nous répartit sur les cellules, nous nous séparâmes.
Ce qu'on appelait la prison de la Tchéka était une série de cellules sombres et étroites s'ouvrant sur des couloirs étroits et tortueux du sous-sol. On me fit entrer dans une cellule qui n'avait pas de fenêtre ; je me tins à l'intérieur de l'entrée, d'abord je ne vis rien, un Géorgien âgé s'approcha de moi ; il dit : -
- Chez nous, c'est étroit, mais nous vous ferons une place, - on m'installa près du mur, dans un endroit étroit. Ils étaient quatre, nous devînmes cinq.
Ce vieux Géorgien, Varachvili, était un homme bon, il ne ressemblait pas aux Géorgiens de Metekh. Il y avait un autre jeune Géorgien, qui était aussi de bonne volonté ; il avait été soldat, maintenant il était emprisonné. Il y avait un jeune Arménien nommé Sarkis, c'était un ancien orphelin. Dans un coin était allongé un Turc au corps corpulent, près de lui, sur le sol de planches, un grand trou, d'où sortaient parfois la tête des rats, dont Tiflis était riche. Les chats ne peuvent pas attraper ces rats, ils sont si féroces, avec des dents pointues ; j'ai vu à Tiflis qu'un chien s'approchait prudemment et mordait le dos du rat, le paralysant. Les deux Géorgiens de notre cellule avaient trouvé un moyen pour attraper les rats. Ils plaçaient autour du trou une boucle de fil solide, tenaient l'extrémité du fil dans leur main, lorsque le rat sortait la tête du trou, ils tiraient immédiatement l'extrémité du fil, le cou du rat se serrait, puis ils soulevaient le fil - le rat dans la boucle - et le jetaient dans l'eau d'un seau ; le rat se noyait. Ce seau était l'urinal des détenus et le seau pour les gros besoins, parce qu'on ne nous faisait sortir qu'une fois par jour pour nous laver et pour les besoins naturels, à 5 heures du matin.
Les Géorgiens méprisaient le détenu turc ; la plupart du temps, il dormait ; nous lui jetions parfois un morceau de sucre. Une fois, le Turc dit : - « Ah, si j'étais libre, si j'avais mon repas quotidien et un kilo de sucre.... ». Les Géorgiens se moquèrent : « Idiot, un kilo de sucre, c'est la nourriture d'un mois ». Le Turc s'était trompé, il aurait dû dire : un morceau de sucre.
On amena dans notre cellule un jeune Géorgien, qui apparut immédiatement comme un espion. Les deux Géorgiens se comportèrent froidement avec lui et ne lui parlèrent presque pas.
L'espion commença un jour à parler de l'insurrection géorgienne (de 1924). Il avait été témoin de la manière dont les tchékistes chargeaient les camions avec les insurgés géorgiens, pour les emmener être fusillés ; les femmes des détenus criaient, pleuraient, voyant leurs proches emmenés vers la mort.
- La Tchéka a fusillé quatre mille insurgés, se vanta l'espion....
Varachvili me raconta plus tard combien d'innocents ils avaient fusillés. Jughéli était le chef des insurgés, il fut fusillé. Dans une cellule, il y avait des ecclésiastiques emprisonnés, avec eux, un jeune diacre ; lorsqu'ils vinrent chercher les ecclésiastiques, ils ne devaient pas emmener le jeune, mais celui-ci demanda à ne pas être laissé seul, ne sachant pas de quoi il s'agissait ; les tchékistes ne laissèrent pas le jeune seul, l'emmenèrent avec les autres et le fusillèrent....
֍
J'avais placé sous le pont en or de mes lunettes (pince-nez) la petite bague offerte par ma sœur Siranouch, avec une pierre bleue, que je portais depuis des années à mon petit doigt ; je l'avais mise sous le pont, pour qu'on ne la remarque pas lors des fouilles, et je l'avais fermée dans l'étui à lunettes. L'espion géorgien vit mon étui à lunettes, le prit pour regarder, puis ferma l'étui, me le rendit. Peu après, lorsque j'ouvris l'étui, je vis que la bague n'était plus là.... Je dis : j'avais une bague dans cet étui, elle n'y est plus... Varachvili et l'autre Géorgien me demandèrent de les fouiller, je refusai. Ils secouèrent un à un leurs affaires et vidèrent les poches de leurs vêtements ; je ne les soupçonnais pas ; l'espion aussi mélangea ses poches avec la main, feignant qu'elle n'y était pas.
Plus tard, Varachvili me dit : - « Le voleur, c'est l'espion. C'est un vaurien, tu vois que nous ne lui parlons pas ».
Le même soir, on appela l'espion. Le voleur emporta la bague. Tiflis était aussi célèbre pour ses pickpockets.
֍
On m'appela ; nous montâmes par des couloirs étroits, tortueux et sombres jusqu'à une pièce du deuxième étage du bâtiment de la Tchéka Transcaucasienne, où, derrière une table, était assis le tchékiste Kolia Guéorgov, un enquêteur arménien subordonné au chef de la Tchéka Valentin Khavrentkh Beria.
- Asseyez-vous, dit le tchékiste, - Vous êtes accusé d'appartenance à la Fédération Révolutionnaire Arménienne. La Tchéka d'Arménie avait transmis votre dossier à la Tchéka Transcaucasienne, maintenant nous transmettons aussi votre dossier à la Vétchéka (Tchéka générale de l'Union Soviétique). Ce soir, on va vous envoyer à Moscou.
Kolia Guéorgov était un homme de taille moyenne, pas gros, au visage pâle, aux cheveux coupés court. J'avais entendu parler de lui à la prison de Metekh, qu'il était cruel. Artiuch d'Akhaltsikhé me l'avait raconté, - « Quels radis mangez-vous, vous, les Dachnaks ? », avait-il dit à Artiuch.
Guéorgov ordonna que je passe dans la pièce voisine, lorsque je passai, il y avait un gardien géorgien d'une cinquantaine d'années, « On vous a donné la permission de voir votre mère », dit le Géorgien en russe.
Peu après, ma mère entra, émue, nous nous embrassâmes. « Que s'est-il passé, tu es émue ? » demandai-je.
- En bas, lorsque je me suis approchée de Kolia Guéorgov pour demander une visite, il m'a attrapée par le bras, m'a brutalement repoussée, qu'est-ce que je lui ai fait ? dit ma mère.
Je me mis en colère, me tournai vers le Géorgien, dis : « Kolia Guéorgov s'est comporté grossièrement avec ma mère, et il se considère comme un partisan de l'égalité des droits des femmes, le misérable ». Le Géorgien ne dit rien.
On me transféra dans la cellule de la Tchéka de la gare de Tiflis, dont la fenêtre avait des barreaux de fer.
Un tchékiste arménien ami vint, en uniforme militaire, me fit sortir et m'emmena m'asseoir dans un wagon, sous la garde de deux soldats de l'Armée rouge russe. Comme le train n'était pas encore parti, je demandai au tchékiste :
- Puis-je me tenir près de la fenêtre ? - On me le permit. Soudain, je vis ma mère marchant vers notre wagon, le visage empreint d'une lourde souffrance.
- Puis-je parler à ma mère, en votre présence, demandai-je au tchékiste. On me le permit.
Je dis à ma mère des mots apaisants ; peu après, le train se mit en marche... Je me souvins d'un poème du poète-bolchévik Vahan Tériane :
« Je m'en vais vers un monde étranger,
Un pays lointain - je ne reviendrai plus.
Souvenez-vous de moi dans vos pensées,
Restez bien, restez bien... »
11. DANS LA PRISON DE BOUDYRKA À MOSCOU [A.]
DROCHAK, 8e année, N° 3, 27 Mai, 1987, pp. 33-35 (121-123).
J'étais assis dans un compartiment-cellule, en face de moi, un tchékiste arménien, de chaque côté de l'entrée, deux soldats russes debout.
- Puis-je connaître votre nom et prénom ? demandai-je au tchékiste.
- Micha Mikayélian, dit-il.
- De quel endroit êtes-vous ? demandai-je à nouveau.
- D'Aghoulis, dit-il.
Je me raidis, pensant : serait-il un parent de Kristapor Mikayélian, qui maintenant, en tant que bolchévik-tchékiste, surveille un membre du parti de Kristapor, la Fédération Révolutionnaire Arménienne... Quelle tragédie.
Dans une gare du Caucase du Nord, lorsque le train s'arrêta, j'étais assis près de la fenêtre, je vis l'un de nos anciens séminaristes, qui était d'une classe au-dessus de nous. Son nom : Kakavian. L'étrange était qu'il était vêtu de l'habit de séminariste, délavé.... Que vit ce pays, que ce garçon porte le même vêtement depuis onze ans, la même ceinture autour de la taille..., pensai-je.
֍
En chemin, le tchékiste Micha Mikayélian se comportait bien avec moi, pas une grossièreté, pas d'incident désagréable. Même lorsque j'étais debout près de la fenêtre, une belle femme russe du compartiment voisin se tint près de moi. Elle demanda de quelle nationalité j'étais. Je dis : « Je suis arménien », elle dit : « Oh, les Arméniens ont une belle chanson appelée "Tsitsernak" (les Russes ne peuvent pas prononcer notre lettre "ts") ; chantez-vous cette chanson ?... ». Je vis que la femme ne réalisait pas que j'étais un détenu, je dis : « non », et, m'excusant, je rentrai dans mon compartiment.
Était-ce fortuit ou appris ? Je ne sais pas, mais Micha Mikayélian ne fit aucune remarque.
À Moscou, on m'emmena à la prison de Boutyrka, qui contenait parfois quarante mille détenus. Des bâtiments avec des cellules, une petite cour, où l'on faisait sortir les détenus pour la promenade. Le mur de briques de la cour datait de l'époque tsariste, sur lequel les bolchéviks avaient construit un ajout en bois, de sorte qu'on ne voyait pas de l'autre côté.
J'étais dans la cellule n°11. Sur la porte, il y avait un petit judas qui avait un couvercle de l'extérieur. Le gardien surveillant dans le couloir tirait parfois le couvercle et regardait à l'intérieur de la cellule, au cas où le détenu ne s'échapperait pas... mais où et comment s'échapper ? C'était impossible.
Les trotskistes constituaient un grand nombre, en tant que détenus, et correspondaient entre eux, par l'intermédiaire de pigeons nichant sur les toits de la prison, en attachant des messages à leurs pattes.
J'avais lu dans le journal qu'en mai, il y aurait des élections en Angleterre et qu'il était probable que le Parti travailliste remporte la victoire pour la première fois et que son leader MacDonald devienne Premier ministre. Mais à Boutyrka, on ne me donnait pas de journal. Il y eut une surprise intéressante : la cellule voisine recevait un journal ; ce jour-là, le gardien, au lieu de jeter le journal là-bas, par erreur, le jeta dans ma cellule. Immédiatement, je le pris et lus, écrit en gros caractères, que les Travaillistes avaient gagné.... À cet instant, la porte s'ouvrit et le gardien me demanda le journal, je le donnai. J'avais atteint mon but.
Les jours sans littérature étaient ennuyeux : ni journal, ni livre. La cellule était aussi si petite pour marcher que mes pieds avaient laissé des traces sur le ciment du sol, j'avais tant marché.
J'écrivis une demande à l'administration pénitentiaire, demandant qu'on me donne des livres à lire, de la bibliothèque de la prison de Boutyrka.
Ils permirent, mais ne me mirent pas le catalogue en main, dirent : écris sur un papier le livre que tu veux, nous l'apporterons.
Je savais que la littérature russe traduite était la plus riche, que ce soit sous le tsarisme, et surtout sous le bolchévisme, étaient traduits même des livres de valeur secondaire, tertiaire de la littérature étrangère.
Sous le bolchévisme, ces intellectuels à qui on ne donnait pas de travail s'occupaient de traduction, par exemple, notre surveillant principal du séminaire, Yovsèp Grigorian, j'avais entendu qu'il traduisait « Le Capital » de Karl Marx, Tadéos Avdalbéguian, Sahag Torossian et d'autres, de même.
En premier lieu, j'écrivis les noms d'écrivains français : Baudelaire, Alfred de Musset, Paul Verlaine et, à ma surprise, je les reçus un à un.
Je commençai à lire toute la journée, mon temps passait fructueusement, je connaissais par cœur certains poèmes, à Boutyrka, je traduisis le poème de Baudelaire intitulé « La Mort ». –
« Ô mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l'ancre,
Ce pays nous ennuie, ô mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre,
Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons !
Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte !
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ?
Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau ! »
Ainsi dura ma lecture un mois et demi. Je commandais cinq livres par semaine, de pure orientation littéraire-artistique, j'évitais le politique, pour ne pas donner lieu à des soupçons inutiles. Mais quel que soit le livre que j'écrivis, ils l'apportèrent, donc la bibliothèque de la prison de Boutyrka devait être très riche.
Je commandais « Les pas sur la neige » de René Bazin, lorsqu'ils arrêtèrent de donner des livres... Il était clair que la Tchéka ne voulait pas que je m'occupe de littérature, mais que je devais sombrer dans les réflexions propres au détenu. On ne m'appelait pas non plus pour l'interrogatoire de mon dossier.
Il restait un moyen : la grève de la faim. Et je décidai d'annoncer une « grève de la faim sèche ». C'est-à-dire même sans boire d'eau, ce qui était le plus difficile, l'organisme le plus fort ne résiste que dix jours. Alors qu'avec de l'eau, la grève de la faim peut durer jusqu'à trente jours.
J'écrivis et annonçai aussi au gardien que j'étais en grève de la faim, qu'il ne m'apporte pas de nourriture ni de thé. Je lui montrai ma cellule, pour qu'il se convainque que je n'avais ni nourriture ni eau.
La partie difficile de la grève de la faim est le troisième et le quatrième jour, lorsque tu sens la faim. À partir du cinquième jour, tu ne sens plus la faim, seulement tu commences à maigrir rapidement ; mais la soif te tourmente. Je maigrissais si vite que la ceinture de mon pantalon s'était élargie et en marchant, je tenais la ceinture pour que mon pantalon ne tombe pas.
Je commençai à avoir des hallucinations ; j'étais allongé, le mur de la prison disparut devant mes yeux, au loin je vis une cascade, avec des eaux torrentielles, à côté, sur la terre ferme, un pain posé, dessus un morceau de fromage... Confus, je m'assis sur mon lit, la vision disparut... la même cellule, avec son mur, était à sa place.
Ensuite, une autre vision, quelqu'un avec un doigt transparent m'appelle de la main, montrant de l'eau et du pain.... De nouveau, je m'assis à ma place et l'apparition s'évanouissait.
Ces visions me firent réfléchir aux apparitions des ecclésiastiques ascètes dans les déserts ou les grottes, eux aussi, par manque de nourriture, ont eu des hallucinations, certainement, et ont vu des esprits saints. Ces questions devraient devenir l'objet d'étude de médecins spécialistes et de psychologues. Le problème, certainement, a un lien avec le corps et le cerveau.
Le neuvième jour de ma grève de la faim, lorsque je descendis du lit, j'eus un fort vertige. Je tombai sur le sol. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé lorsque le gardien et une sœur de charité entrèrent. « Vous avez déclaré une grève de la faim sèche », dit-elle et tint un médicament sous mon nez. Puis elle dit qu'on allait me transférer à l'infirmerie de la prison, ils avaient apporté un brancard, je refusai, je marcherai, dis-je et je commençai à marcher en m'appuyant sur les murs. Lorsque nous sortîmes dans la cour, l'air était frais, devant moi marchait un détenu russe, crachant constamment du sang... Le pauvre homme était tuberculeux au dernier degré.
Lorsque j'entrai dans une salle de malades ; je m'arrêtai à la porte, à ce moment, une personne à la physionomie arménienne, avec une barbe et une moustache, s'approcha de moi du fond de la salle. « Vous êtes Arménien, dit-il, il y a un lit libre près de moi, venez », dit-il et me conduisit. « Je suis du Karabagh, dit-il, mon nom est Tigran Bek Hassan Djalalyan, moi aussi je suis allongé ici en tant que malade. Vous avez beaucoup maigri, n'auriez-vous pas fait la grève de la faim ? », dit-il. Je confirmai ce qu'il disait.
Tigran Bek me fit une place près de son lit et commença à donner des conseils. « Celui qui fait la grève de la faim, lorsqu'il recommence à manger, pendant autant de jours qu'il a fait la grève de la faim, doit prendre seulement de la nourriture liquide, puis pendant autant de jours, des légumes, à la troisième phase seulement, de la viande. Si à la première phase, il mange de la viande ou quelque chose de solide, les intestins éclateront, parce qu'avec la grève de la faim, leurs parois s'amincissent ». Donc je devais faire ainsi. Déjà, je ne sentais plus la faim, je pouvais garder l'ordre.
Tigran Bek raconta qu'il était du Karabagh, qu'il avait de l'influence dans son village, c'est pourquoi la Tchéka ne le toléra pas et l'emprisonna. « Les villageois jurent par mon nom », disait-il. Et en effet, Tigran Bek était un homme bon, même les Tatars présents dans notre salle se comportaient avec lui avec respect.
- Notre médecin est un vieux Russe, il est intime avec moi et est très impressionné par mon nom de famille Hassan Djalalyan. Bien que je sois guéri, je garde une toux, je la lui montre, je prolonge mon séjour ici, car qui sait, peut-être qu'on m'enverra aussi à Salavki....
Et en effet, lorsque le vieux médecin russe vint, il redemanda son nom à Tigran Bek et lui-même répéta : Gassan Djalalov... (les Russes n'ont pas le son « h »).
Le détenu, après un long temps sans manger de viande, contracte le scorbut et ses dents commencent à tomber. Il y avait un groupe de détenus d'une tribu appelée « Kalmouk », avec une barbe clairsemée poussant sous le menton. En parlant, ils bêlaient comme des chèvres. Ils buvaient une sorte de thé de couleur verte, qui était insipide. Tous souffraient du scorbut.
On dit à un détenu tatar de préparer ses affaires. Tigran Bek écrivit immédiatement une lettre sur un papier, le Tatar la mit dans sa chaussette, pour l'emporter au village.
Tigran Bek me racontait les caprices et les violences des bolchéviks. « Ils ont détruit toute mon économie », conclut-il.
Ma préoccupation était autre. Je pensais : le prêtre Khatchvankian a-t-il réussi à faire parvenir la nouvelle au père Arsen, à Moscou, que je suis emprisonné ? Comment les camarades se comporteront-ils ? Quant à moi, je mourrais, mais je ne donnerais pas de secret, que les camarades soient en sécurité.
֍
On m'appela. C'était un jeune enquêteur, vêtu d'une blouse noire. Je dis : j'ai déclaré la grève de la faim et j'attends le résultat. Il dit :
- En vain.
- Cela fait plus d'un an que je suis en prison et mon sort est encore incertain. Les livres de lecture ont aussi été arrêtés, c'est pourquoi je proteste, dis-je. De nouveau :
- En vain, dit-il, maintenant on va vous envoyer à l'isolateur de Iaroslavl, dit-il et se leva.
Lorsqu'on devait me faire sortir de l'infirmerie, Tigran Bek fut très ému. « Ne pense pas, dit-il, tu es sujet persan, à la fin, ils te libéreront, notre cas est difficile. Adieu, mille fois adieu, mon frère », dit-il avec des yeux larmoyants.
Je fis mes adieux, lui souhaitant à lui aussi du succès.
La ville de Iaroslavl se trouve au nord-est de Moscou, à environ deux cent cinquante kilomètres. C'est une vieille ville russe historique. À la gare, on nous aligna, nous un groupe de détenus, et on nous fit marcher à pied, tandis que quelques vieillards furent assis sur une charrette ; en s'asseyant sur la charrette, un vieux Turc caucasien, qu'ils appelaiaent Machti, s'exclama, « aï bir dana kiabab olsaydı, yerdih... » Tous rirent, « aï Machti, ici où, le kiabab où ? », dirent-ils.
Nous arrivâmes dans la cour de la prison des criminels de Iaroslavl, lorsqu'on sépara les criminels, nous, les politiques, on nous emmena dans la section politique située derrière celle-ci.
C'était un vieux bâtiment à deux étages, un ancien couvent, avec des cellules petites et étroites, sèches, avec des murs et un sol en pierre. On me mit dans la cellule n°11 du deuxième étage (les étages étaient très bas), dont le lit était suspendu au mur ; le jour, on enlevait les pieds des lits, pour que les détenus ne s'allongent pas pour se reposer... La nuit, on remettait les pieds. La fenêtre était barrée, à double battant (dans les endroits froids, les fenêtres sont à double battant, le battant extérieur gèle sévèrement en hiver).
Sur le mur d'en face de la cour, il y avait une guérite de garde, nous étions toujours sous surveillance. De ma fenêtre aussi, je devais regarder prudemment les détenus se promenant dans la cour, qu'on faisait sortir une fois par jour pour la « progoulka » (promenade).
֍
Le lendemain de mon emprisonnement, alors que je me promenais dans la cour, je remarquai deux visages connus parmi les marcheurs. L'un était... Moukuch Abarantsi, que je connaissais de Tabriz et, à propos duquel mon camarade sassountsi Artaches Stépanian m'avait averti à la prison de Metekh, qu'il était suspect, et l'autre était le Géorgien Kartzivadzé, des étudiants de Prague, dont j'avais entendu parler déjà à Paris, qu'il était entré secrètement en Union soviétique via la Turquie, mais avait été arrêté. Kartzivadzé appartenait au parti social-démocrate géorgien. Lui aussi m'avait probablement vu en me promenant dans la cour, mais nous ne nous rencontrâmes pas, ni ne parlâmes l'un de l'autre.
En ces jours, lorsqu'on me faisait sortir dans la cour pour la promenade, je remarquai que Moukuch était aussi parmi les marcheurs. Soudain, je le vis s'approcher de moi avec un détenu turc azerbaïdjanais :
- André, toi aussi ici ? dit-il en se tenant face à moi.
Je dis : qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas.
- Quoi ! Tu ne te souviens pas, je suis Moukuch, d'Abarants.
- Je ne me souviens pas, dis-je sèchement.
Il fut décontenancé. Il avait amené le Tatar avec lui, pour qu'il soit témoin, si je faisais connaissance avec Moukuch ; maintenant, il fut aussi témoin que je ne le connaissais pas. « Qu'ils aillent rapporter leur échec à leur Tchéka. Ce numéro n'a pas passé », pensai-je.
Cependant, par la suite, Moukuch continua à essayer d'autres « numéros ». Il demandait : « Où sont Nikol Nikogossian, Mkhon (Grigor Mkhitarian) ? » Je ne sais pas, répondais-je. « Mais n'étiez-vous pas ensemble à Prague, sauriez-vous où ils sont maintenant ? » Je ne sais pas, répondais-je, j'ai quitté Prague il y a longtemps.
Se promenait avec nous aussi une jeune Ukrainienne, nommée Nadejda Vitalévna, qui avait été envoyée en Pologne, en mission, mais on l'avait rappelée et emprisonnée.
Moukuch marchait parfois avec elle, bras dessus, bras dessous. Nadejda commença à me prendre le bras ; je l'écartai poliment, disant : « nous sommes des détenus, nous n'avons pas le droit de nous donner le bras, d'autant plus que votre mari se trouve aussi dans cette prison ».
Un jour, Moukuch dit : « Viens, ayons une correspondance entre nous. Je donnerai la lettre à Nadejda, elle te la donnera. Toi aussi, tu lui donneras, elle me la donnera... ».
- Quel besoin y a-t-il d'une correspondance, lorsque nous nous rencontrons ici ? Si tu as quelque chose à dire, dis-le et obtiens ta réponse, dis-je en le regardant fixement dans les yeux.
Il était clair que Moukuch voulait obtenir mon écriture, mais ainsi se confirmait qu'il était un espion.
Donc, la Tchéka avait transféré Moukuch Abarantsi de la prison d'Erevan à l'isolateur de Iaroslavl, pour me piéger ; mais elle s'était trompée : je savais quel fruit amer était Moukuch. Jusqu'à présent, je me sens reconnaissant envers Artaches Stépanian de Sassoun, qui m'avait mis en garde contre Moukuch.
Un jour, pendant la promenade, l'ami turc de Moukuch s'approcha de moi et commença à raconter, furieux, comment les Dachnaks avaient massacré les habitants de leur village de Malbalikéand... Je l'écoutai en silence, puis dis : « Je ne sais rien de telles choses, j'ai vécu en France ».
Un autre jour aussi, lorsque nous revenions de la promenade dans la cour vers nos cellules, Nadejda et moi montâmes devant nos cellules du deuxième étage ; à ce moment, notre vieux portier entra une seconde dans une cellule, pour quelque ordre ; profitant de cet instant, Nadejda m'embrassa... Je fus confus, mais le portier sortit et nous répartit sur les cellules, sans remarquer.
Dans ma cellule, je pensai : est-ce que cela aussi ne faisait pas partie des « numéros » de la Tchéka ? Nadejda n'est-elle pas intime avec Moukuch, et puis, son mari est aussi dans l'une de ces cellules...
12. DANS LA PRISON DE BOUTYRKA À MOSCOU B.
DROCHAK, 8e année, N° 5, 24 Juin, 1987, pp. 20-22 (204-206):
Lorsque les tentatives de Moukuch échouèrent, on commença à me faire sortir pour la promenade dans la seconde cour. Les détenus qui marchaient avec moi étaient : Anna Abrikossova, qui était la sœur du médecin de Lénine, Abrikossov. Elle avait étudié à l'université de Cambridge ; c'était une femme d'environ 55-60 ans, une intellectuelle très cultivée, avec qui discuter était un plaisir pour moi ; elle était digne de confiance. Elle recevait un journal à lire, me le donnait secrètement, je le lisais dans ma cellule, puis le lui rendais le lendemain. Elle maîtrisait l'anglais et le russe ; elle m'apprit même une série de mots anglais que je ne connaissais pas à l'époque. Elle raconta son emprisonnement :
- Je suis revenue de l'Angleterre dans ma patrie pour travailler, d'autant plus que mon frère avait été le médecin de Lénine, il ne me serait pas venu à l'esprit que je finirais en prison. Un jour, c'était en 1923, un ambassadeur de l'Union Soviétique fut assassiné en Suisse, nommé Voronski. Nous n'avions pas de nouvelles.
On emprisonna plusieurs dizaines d'entre nous à Moscou ; on fusilla près de vingt personnes en tant que contre-révolutionnaires, en réponse à l'attentat. Moi aussi, on me condamna à dix ans de prison ; voilà cinq ans que je suis assise... vous verrez quel régime c'est, conclut-elle.
Parmi ceux qui marchaient avec nous, il y avait aussi un médecin âgé, qui était un homme sérieux et parlait peu. Il était digne de confiance.
Un autre vieil homme, de taille naine, au corps corpulent, au crâne chauve et à la barbe absolument blanche et longue, descendant jusqu'à la poitrine, était un Russe nommé Vaznessenski, très pieux et religieux, qui prêchait la théologie et la religion à un jeune détenu russe d'à peine vingt ans. Ce jeune était un garçon affable, amoureux fou lorsqu'on l'avait emprisonné ; finalement, il devint fou dans la prison, criant « Èvèrine, Èvèrine ».
Le cinquième était un Chinois nommé Tchan-Tchin, qui avait été arrêté près de la frontière de la Mandchourie. Je donnais du tabac à Tchan-Tchin, lui raccommodait mes chaussettes avec des fils, de manière très délicate, propre aux Chinois. Il y avait aussi un Russe mêlé de Tatar, dont nous sentîmes qu'il n'était pas une bonne personne, nous ne lui parlions pas, c'est pourquoi on le retira de notre rang.
Le journal donné par Anna Abrikossova, je le lisais secrètement dans ma cellule en une demi-heure environ, jusqu'à la dernière lettre, ensuite je n'avais rien à faire, je m'asseyais et récitais par cœur les nombreux poèmes que je connaissais : « Anouche », « La Prise de Tmbkaberd », « Le Requiem » de Hovhannès Toumanian en mémoire du million et demi de martyrs arméniens, massacrés par le Turc génocidaire, les poèmes « L'Horloge » et « Le Mât » de Dérénik Démirdjian, mais surtout le poème « Le Prisonnier de Chillon » de Lord Byron, que Hovhannès Toumanian a merveilleusement traduit. Cela correspondait tout à fait à mon état de détenu, voici le prologue du « Prisonnier de Chillon ».
« Ô Liberté ! c'est toi dont le brillant flambeau
Luit dans l'obscure nuit des cachots ténébreux ;
Là, c'est toi que l'espoir, dans son brûlant foyer,
Adore et reconnaît pour son astre radieux.
Et quand tes fils, frappés par la chaîne cruelle,
Dans les cachots profonds meurent en combattant,
Leur patrie à leur nom devient plus solennelle :
C'est toi qui fais voler leur nom dans tous les vents.
Chillon ! ton noir cachot devient un sanctuaire ;
Et ton pavé hideux, un autel glorieux :
Car Bonivard y vint souffrir pour sa patrie,
Et de ses pieds y fit un sentier précieux.
Puisse ce sentier, né dans la sombre torture,
Ne jamais s'effacer sous les pieds des tyrans !
J'avais aussi tellement marché dans ma cellule étroite que mes pieds avaient laissé des traces sur le sol.
Je sentais un grand besoin de lire des livres. J'écrivis une demande à l'administration de la prison.
Heureusement, ils permirent, à condition que je paie le prix des livres ; ma petite somme d'argent était chez eux. J'acceptai et demandai une liste de livres. Il y avait des études intéressantes : 1) L'étude de l'académicien Ossipov « Sur les États-Unis d'Amérique », 2) Une étude intitulée « Japon », un grand volume, 3) Une grande étude sur le théoricien-activiste anarchiste, le célèbre Bakounine, sous l'autorité de Vaznessenski, tous en russe. Les prix étaient bon marché, édition soviétique, sauf le livre « Japon », qui était une édition de l'époque tsariste.
En premier lieu, je lus à fond l'étude sur l'Amérique de l'académicien Ossipov, qui était très sérieuse et objective, avec des tableaux statistiques.
Dès 1927, l'académicien Ossipov écrivait que les États-Unis consommaient soixante pour cent du papier du monde, qu'ils avaient soixante milliards de pièces d'or dans le trésor public, que la productivité du travail aux États-Unis était la plus élevée de tous les pays, tant dans l'industrie que dans l'agriculture, que l'Amérique était un pays capitaliste, etc.
En ces jours, je ne pouvais imaginer qu'un jour je partirais pour les États-Unis en tant qu'activiste-rédacteur, comme ce fut le cas en 1953, 25 ans plus tard ; et je mis le pied aux États-Unis en étant déjà assez familiarisé avec ce pays.
J'appris aussi l'anglais par moi-même en Amérique, avec l'aide de mon français.
Ensuite, je passai au livre « Japon ». L'auteur russe (j'ai oublié son nom) avait été correspondant d'un journal russe pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, avait été fait prisonnier par les Japonais, y avait vécu trois ans et l'avait étudié assez habilement.
Je passai à la biographie de l'anarchiste Mikhaïl Bakounine, sous l'autorité de Vaznessenski. J'avais beaucoup lu et étudié sur les anarchistes : Kropotkine, Mikhaïl Bakounine, les Italiens : Cafiero Carlo, Costa et Malatesta, à Paris, pendant mes années d'étudiant. Maintenant, je m'intéressais à l'approche des théoriciens soviétiques.
Il était significatif que Vaznessenski s'enthousiasme à propos du fait qu'il disait : « Voyez, Mikhaïl Bakounine aussi était partisan de la dictature du prolétariat ». Cependant, Vaznessenski ne citait pas complètement la déclaration de Bakounine sur la dictature du prolétariat, qui dit :
« Le principe de la dictature doit être : rendre son existence superflue et inutile le plus tôt possible ».
Mikhaïl Bakounine était un opposant aux théories de Karl Marx et avait lutté contre Marx.
֍
Après avoir lu les livres mentionnés ci-dessus et un ou deux autres livres, on m'interdit à nouveau d'avoir des livres.
Cette fois, je ne me limitai pas seulement aux poèmes que je savais par cœur ; je décidai de mémoriser définitivement les dates principales de l'histoire arménienne, en restaurant ma mémoire. J'étais Arménien, nous avions une Question Arménienne - qui était négligée et trahie par les puissants du monde, par une diplomatie perfide ; j'étais Dachnak, dévoué à la cause juste du peuple arménien. Par conséquent, je devais maîtriser à fond notre histoire. Comme j'avais restauré ma mémoire pendant mes années d'étudiant, en mémorisant des poèmes, de même je devais restaurer les périodes et dates historiques et les mémoriser à fond. C'était difficile, car je n'avais pas de livres à ma disposition, mais c'était possible. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque j'écris un article, je ne consulte jamais de source pour les dates ; j'ai une mémoire exceptionnelle et beaucoup en témoignent. Seulement, ma mémoire est faible sur un point : lorsque je pose un papier quelque part, ensuite je n'arrive pas à me souvenir de l'endroit... Cela aussi reste de la prison ; n'est-ce pas que dans la cellule de prison, il n'y a pas la possibilité ni le besoin de poser un objet quelque part, et parce que je suis resté deux ans continuellement dans les prisons soviétiques, cette partie de ma mémoire fut détruite ; je soumets cela à l'attention des psychologues-médecins.
LA QUESTION ARMÉNIENNE. - Face à l'indifférence des grands de ce monde, je récitais souvent le poème « Le Mât » de Dérénik Démirdjian :
« Dans les espaces libres et sauvages de la mer,
Où la tempête se lamente en vain,
Gît dans le sein des vagues
Un mât brisé, désespéré.
Parfois il s'élance soudain vers le haut,
Parfois, désespéré, il redescend,
Et puisque la vie est une ruine,
Il ne se lamente plus désormais.
Sa vie est déjà une triste plaisanterie,
Tantôt en haut, tantôt en bas, jour après jour,
Il erre en vain, fatigué, seul.... »
C'était la Question Arménienne symboliquement : un mât, brisé, livré au caprice des vagues hurlantes...
Et mes larmes coulaient ; puis une colère m'envahissait, contre les puissants et les injustes du monde ; je me renforçais dans ma foi, qu'un jour le peuple arménien martyr devait accéder à ses justes droits, et j'étais prêt à appeler tout le monde au combat...
֍
L'hiver approchait, je n'avais ni vêtements chauds, ni couverture (j'avais offert ma couverture à mon camarade sassountsi Artaches Stépanian à Metekh). La mince couverture de prison (odeal) ne me protégeait pas du froid descendant jusqu'à 40-45 degrés en dessous de zéro, que connaissait Iaroslavl.
Un jour aussi, soudain, de manière inattendue, je reçus un manteau chaud, un chapeau, des bottes en feutre à longues pointes et un gâteau-pâtisserie. Ma mère, sans connaître la langue (le russe), comment était-elle arrivée à Iaroslavl* (Plus tard, j'appris qu'elle avait engagé une femme assyrienne, connaissant le russe, et était venue à Iaroslavl), à des milliers de kilomètres d'Erevan. On ne me donna pas de visite avec ma mère... Je compris à nouveau la cruauté du pouvoir.
Je déclarai la grève de la faim, protestant que je n'avais pas eu de visite avec ma mère, et que mon dossier était dans un état incertain. Je posai le gâteau apporté par ma mère sur la console (petite table adossée au mur), n'y touchai pas.
Le 24 janvier 1930, le directeur de la prison m'avait appelé. Je me présentai. Le directeur, au grade de colonel, de constitution robuste, était un homme à la parole pesante. Il commença à me exhorter à mettre fin à ma grève de la faim. Je vis que sur son bureau, il y avait un portrait de Lénine, le visage tourné vers moi. Je refusai de mettre fin à ma grève de la faim. Lorsque je retournai dans ma cellule, je réfléchis au portrait de Lénine : c'était probablement le quatrième anniversaire de sa mort, et le directeur voulait que je ne sois pas en grève de la faim ce jour-là. Mais j'avais déjà déclaré que je continuerais. Le gardien voyait aussi que le gâteau apporté par ma mère avait moisi, je n'y avais pas touché.
Ma grève de la faim dura dix-huit jours, lorsqu'on annonça qu'un enquêteur de Moscou allait venir.
֍
On m'appela chez l'enquêteur venu de Moscou. L'enquêteur était une femme, appelée Andréïeva, la fille de l'activiste soviétique Andréïev. Une femme de haute taille, au visage cruel. Elle demanda d'où je venais en Union soviétique. Je répondis : de France.
- Vous êtes un agent français, dit-elle.
- Alors, quiconque vient de France est un agent français ? dis-je.
- Oui, c'est ainsi, répondit-elle.
- Avez-vous une conscience révolutionnaire et des preuves ? -
- Nous savons, dit-elle.
- Si tout ce que vous savez est ainsi, je vous plains, dis-je et me levai, - vous me gardez dans vos prisons depuis des années avec une accusation aussi infondée...
(Plus tard, lorsque les purges staliniennes eurent lieu en 1937, la tête d'Andréïev fut aussi dévorée, peut-être avec lui, celle d'Andréïeva, qui m'avait calomnié).
֍
J'avais une montre de poche jaune, que je posais sur ma petite table. Pendant la grève de la faim, j'eus aussi une hallucination à cet endroit. J'étais allongé avec mon manteau et mes bottes en feutre à longues pointes sur moi (je n'avais pas de couverture, je me couchais habillé). Soudain, je sentis qu'un grand chien noir, posant ses pattes lourdement sur mes deux côtés, montait vers mon visage. Je repoussai le chien, la montre apparut à mes yeux : il était trois heures ; mais la montre était en position horizontale sur la petite table, lorsque je m'assis et regardai ma montre, il était exactement trois heures... Comment se faisait-il que, allongé, j'avais vu trois heures sur la montre en position horizontale ? Jusqu'à aujourd'hui, c'est une énigme pour moi. Peut-être que les psychologues résoudront cette énigme.
Il faisait un froid terrible. La vitre de ma fenêtre avait gelé, était couverte de glace ; si parfois je sortais dans la cour pour la promenade, je tirais mon chapeau vers le bas de mon front, parce que le gel serrait mon front comme un anneau ; j'avais une moustache et une barbe, qui gelaient immédiatement ; en retournant dans ma cellule, il fallait une demi-heure pour arracher les glaçons de ma barbe. Déjà dans ma cellule, il faisait froid, il y avait soi-disant un poêle, mais il ne brûlait pas ma main, on chauffait si peu.
Les corbeaux de Iaroslavl, blancs et noirs, étaient de grande taille, avaient des plumes abondantes.
L'ISOLATEUR DE IAROSLAVL s'appelait « Section d'Exécution de l'OGpéou général (Tchéka) ». On y envoyait des détenus d'une importance exceptionnelle de Moscou ; on racontait que dans cet « isolateur » avait été emprisonnée la terroriste socialiste-révolutionnaire mademoiselle Kaplan, qui avait attenté à Lénine ; Lénine avait été blessé, avait dit : « Il faut épargner la vie des femmes courageuses », et on avait donné la prison à perpétuité à Kaplan, puis on l'avait envoyée dans les prisons de Sibérie, où elle était morte dans l'anonymat.
On avait aussi amené Léon Trotski à l'isolateur de Iaroslavl, puis on l'avait expulsé à l'étranger.
J'avais lu dans le journal que lorsque Trotski était arrivé à Constantinople par bateau, il avait envoyé un message à Mustafa Kemal : « Je ne suis pas venu dans votre pays de mon plein gré, monsieur, mais en cédant à la force », mais le « camarade Kémal » n'avait pas donné asile au « camarade » Trotski, c'est pourquoi celui-ci était parti pour le Mexique, pour devenir plus tard la victime du terroriste envoyé par le « camarade » Staline.
֍
Les criminels de droit commun étaient honorés dans les prisons soviétiques. « Ce sont les victimes du système social précédent », - c'est ainsi que raisonnaient les bolchéviks. Et voilà que dans la section des criminels attenante à notre prison politique, avaient lieu des conférences, des représentations et des soirées musicales, pour éduquer, corriger les criminels ; il y avait des « maisons de correction » spéciales, pour redresser les voleurs, les bandits, les meurtriers.
Lorsqu'il y avait une soirée musicale pour les criminels, et que la porte nous séparant d'eux était ouverte un instant en bas, les ondes sonores de la musique m'atteignaient... Je jouissais, car cela faisait des mois qu'aucun son de musique n'était parvenu à mes oreilles. La musique est un langage international, accessible à tous et agréable, alors que c'étaient les internationalistes qui nous avaient privés de ce langage...
֍
C'était au début de février 1930 qu'on vint me chercher de l'isolateur de Iaroslavl pour m'emmener à Moscou. D'abord, ils voulurent me raser la barbe, qui avait poussé, je ne les laissai pas faire ; ils se contentèrent de la tailler. Cette fois, on m'installa dans une automobile de tourisme, qui avait bonne apparence, avec deux tchékistes en uniforme militaire avec moi.
13. DE PRISON EN PRISON À MOSCOU
DROCHAK, 8e année, N° 6, 8 Juillet, 1987, pp. 13-15 (241-243):
À la gare de Moscou, on m'installa sur un banc. On amena et déposa juste en face de moi un jeune homme blessé, allongé sur un brancard, avec des bandages.
Je fus surpris de voir plusieurs militaires vêtus de l'uniforme des gendarmes tsaristes, qui sifflaient souvent avec de petits sifflets de bouche. Soudain, je vis le jeune homme gravement blessé avec des bandages se lever très vivement et s'éloigner du brancard ; sur la toile du brancard, il y avait une grande trace de sang séché... « C'est un numéro (une mise en scène) », pensai-je et j'affectai une apparence tout à fait indifférente (c'était une allusion à un meurtre, un attentat). Ensuite, on me transféra dans une cellule où il y avait trois jeunes Russes, assis par terre ; je m'assis aussi par terre (il n'y avait pas de chaise). Et voilà que les jeunes Russes commencèrent à proférer des insultes russes à trois étages : « Il est venu faire sauter nos ponts, faire sauter nos usines, organiser des sabotages... je lui ... ».
J'observais et écoutais avec un air indifférent, sans prononcer un mot. Je voyais que c'était un nouveau « numéro » (mise en scène).
De là, on m'installa dans une automobile de la Tchéka, dont le chauffeur était un Russe de forte carrure, les paumes de ses mains de la taille de la tête d'un petit enfant.... (jusqu'à présent, c'est devant mes yeux). Il conduisait comme une tempête, en grognant des insultes (les automobiles de la Tchéka roulent toujours très vite et ne sont pas responsables si quelqu'un est écrasé). Je vis que la rue était nettoyée par des femmes russes (des khalakouchki) avec de grands balais, je fus surpris.
On me fit entrer dans un bâtiment. Des détenus faisaient la queue ; je me mis aussi en rang. Le tchékiste enquêteur derrière la table commença à demander un à un le nom, le prénom. « Bitonov » (de bidon), dit l'un. « Jarov » (de chaleur), dit le suivant. « Bajárov » (de feu), « Bombov » (de bombe)... C'était clair pour moi, c'étaient des numéros (mises en scène) ; j'étais froid et indifférent. Cette prison s'appelait « Dom 14 » (Maison 14) ; nous étions entassés dans une cellule. On amena aussi un groupe de personnes arrêtées dans la rue ; il y avait un Arménien, je demandai la raison, il dit : « Dehors, j'ai entendu du bruit, je suis sorti du magasin pour voir ce qui se passait, on m'a arrêté aussi... ».
Un jeune Russe racontait quelque chose à propos d'un incident, il utilisa le mot « armiachka » (petit Arménien), qui était propre au régime tsariste, lorsque les Arméniens étaient méprisés ; et voilà que sous le pouvoir soviétique, le même mot humiliant...
Un vieux Russe grelottait, il voulait dormir un peu, je jetai mon manteau sur lui. « Vous êtes très gentil », dit-il et dormit une heure. Lorsqu'il se réveilla : « Vous m'avez sauvé, sinon je n'aurais pas pu dormir, me reposer dans cet enfer », dit-il.
Cette cellule s'appelait « peresyelny punkt » (point de transit) ; de là, on m'emmena à la prison de la « Loubianka », dont le nom inspirait la terreur aux détenus et aux citoyens, parce que la plupart de ceux qui y étaient emmenés étaient des candidats à l'exécution.... C'était un ancien bâtiment d'hôtel, qui avait été transformé en prison. Il y avait sept détenus ; il y avait un intellectuel de haute taille, impressionnant, et environ trois personnes qui lui parlaient. On me fit une place près d'un détenu géorgien. Le Géorgien commença à me parler amicalement, en tant que Caucasien. Il dit que cet intellectuel détenu sérieux s'appelait Vershinski, c'était un architecte célèbre, il n'avait pas permis que le slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » soit imprimé sur ses livres, maintenant lui et ses deux mille partisans avaient été emprisonnés en tant qu'organisateurs d'un « coup d'État ». Il était l'un des architectes célèbres de l'époque tsariste et avait écrit beaucoup de livres.
Notre cellule était sombre ; on ne nous faisait pas sortir pour la promenade ; tôt le matin, on nous emmenait aux toilettes, qui étaient ouvertes ; il y avait un évêque russe de forte carrure avec nous, il s'asseyait sur le trou des toilettes et disait « Notre Père qui es aux cieux... ». Les autres Russes faisaient de même. Moi, en tant qu'Arménien, j'étais pudique et me retins pendant deux jours, mais le troisième jour, il n'y avait pas d'autre solution, je m'assis aussi... en présence des autres, qui faisaient la queue. Je me souvins de l'Arménien de Crimée de la prison de la Tchéka de Tiflis, qui disait chaque fois : « Moi, leur... ils nous épargnent même les toilettes ».
La troisième nuit, à une heure, après minuit, on vint appeler Vershinski... « raskhod »... (mot propre aux prisons soviétiques... signifie littéralement « liquider », utilisé à la place du mot exécution...) chuchotèrent les détenus.
Deux nuits plus tard, à minuit, on vint et le tchékiste lut mon nom, ainsi : « Ter Akonian »... (les Russes n'ont pas le son « h », Ohannian se prononce Oganian, et Agonia signifie agonie).
- Alors, Ter Agonia (c'est-à-dire Seigneur Agonie....).
- Dépêche-toi, dit le tchékiste russe.
- Je ne suis pas une machine, dis-je avec colère et une détermination m'envahit.
- Raskhod.... raskhod... chuchotèrent les détenus, - il est jeune...
Je sortis du bâtiment avec le tchékiste. Une « corneille noire » (l'automobile fermée de la Tchéka est de couleur noire et le peuple l'a appelée « Corneille noire », qui est de mauvais augure).
L'entrée de la « Corneille noire » est par l'arrière, par des marches ; un couloir très étroit, puis une porte à barreaux de fer, à l'intérieur on entasse les détenus serrés les uns contre les autres.
Lorsque je montai les marches et mis le pied dans le couloir étroit, on me poussa dans le compartiment de gauche et on tira la porte... je restai serré dans ce compartiment, debout. L'automobile commença à filer très vite.... Le moment était critique, à mon oreille résonnait : « Ter Agonia, Ter Agonia.... ».
À ce moment, je me souvins de Kristapor Mikayélian... Tiens bon, tiens bon, je me donnais du courage.
- Si je m'en sors vivant d'ici, je devrai prendre le nom d'Amourian, pensai-je.
La « Corneille noire » s'arrêta. On ouvrit la porte de mon compartiment, disant : descends.
Lorsque je descendis, le tchékiste russe dit avec malignité :
- Alors, c'était bien, n'est-ce pas ?
Je ne répondis pas. Cette fois, on m'avait ramené à la prison de Boutyrka. On me fit entrer dans une cellule : numéro treize.
« Treize est un chiffre maléfique, jusqu'au matin, ils peuvent m'emmener pour être fusillé », pensai-je et je restai éveillé jusqu'à l'aube, soupçonnant à chaque bruit de pas.
Le jour se leva... le danger de cette nuit était passé, avec des émotions nerveuses ; mais il y avait les nuits suivantes.
Le jour, je m'allongeai et m'endormis profondément, mes nerfs étaient épuisés. Le déjeuner : une soupe avec des arêtes de poisson, je refusai. Je demandai de l'eau potable au gardien de service ; mon cœur brûlait.
Je déclarai à nouveau la grève de la faim, mais je buvais de l'eau. J'étais déjà habitué au jeûne, c'était ma troisième grève de la faim. Le troisième jour, je commençai à frapper du pied le couvercle du seau et à crier. Le couvercle se tordit.
- Le détenu est un Caucasien turbulent, j'entendis des cellules donnant sur la cour, les paroles des détenus russes. Les Russes considèrent les Caucasien comme des gens sanguins et rebelles.
Le gardien ouvrit ma porte et dit :
- Vous savez que nous avons une bachnia* (tour). On va vous y emmener.
(* Pougatchovskaïa bachnia - la tour Pougatchov, où avait été emprisonné le Russe rebelle Pougatchov, qui fut ensuite pendu, à l'époque des tsars.
Cette tour est célèbre dans l'histoire russe).
- C'est pareil de mourir de faim ici ou dans la tour, monsieur, dis-je en raillant.
Le mot « monsieur » était blessant pour lui ; je n'avais pas dit « tovarichtch » (camarade).
Et comment pouvais-je dire « camarade » à ceux qui me conduisaient aux portes de la mort ?
J'avais entendu en prison qu'on ne fusillait pas les grévistes de la faim, tant qu'ils n'arrêtaient pas.
Le quatrième jour, on m'appela pour un interrogatoire.
Je m'assis près d'une table, dont le mur derrière était en planches.
La porte s'ouvrit, entra un homme vêtu comme un gendarme tsariste (j'en avais vu des semblables à la gare, j'ai écrit à ce sujet dans les pages précédentes), avec des bottes à longues pointes brillantes (sapogi), à son côté un étui à pistolet en cuir noir brillant, à la ceinture une ceinture, d'environ 40-50 ans, les cheveux gris peignés sur un côté, typique des Slaves, au teint jaunâtre clair, au nez charnu, aux yeux bleus.
Sa voix était rauque, parfois tonitruante.
Il s'assit, sortit un questionnaire. - Nom - prénom.
- Pour quelle raison avez-vous déclaré la grève de la faim ? demanda-t-il.
- Pour l'incertitude de mon sort, dis-je.
À ce moment, il jeta sa cigarette dans la corbeille à papier voisine, la corbeille prit feu... je ne fis pas de bruit (il voulait que je m'exclame : pajár (feu). Il éteignit le feu avec son pied, en grognant sous son nez. Puis il se leva, ouvrit la fenêtre, ce qui n'était pas nécessaire, il faisait froid. Je me tus à nouveau, comprenant que c'étaient des numéros.
Je m'assis, alors qu'il écrivait quelque chose, il se mit à jurer sous son nez, avec des insultes russes à trois étages. (Il voulait faire comprendre que soi-disant j'avais juré*... * Dans ma vie, je n'ai pas l'habitude de jurer, seulement envers les menteurs j'utilise le mot vaurien, qui signifie enclin au mensonge).
- Mettez fin à votre grève de la faim, dit-il.
- Cela fait vingt mois que je suis assis et qu'on me traîne de prison en prison, dans un état incertain. Déterminez mon sort, dis-je.
Il déclara d'une voix tonitruante :
- Soit on te fusillera, soit on t'enverra loin et on te poursuivra jusqu'à la tombe.
Lorsqu'il disait : « on t'enverra loin », à cet instant, derrière le mur de planches, on entendit un hennissement de cheval.... Intérieurement, je me réjouis, car le cheval est un bon signe dans les rêves et les contes.
Jusqu'à aujourd'hui, la voix de l'enquêteur est dans mon oreille.
- Quel est votre nom ? demandai-je.
- Iakouchev, dit-il à haute voix.
Ce nom me sembla familier.... Iakouchev, Iakouchev, je répétais dans mon esprit, où ai-je entendu ce nom, mon Dieu.
Lorsque je retournai dans ma cellule, je me mis à fouiller ma mémoire et soudain, je me souvins. J'avais lu dans le journal des exilés russes de Paris un article de Vladimir Lvovitch Bourtsev* (* Vladimir Bourtsev avait démasqué trente et un espions de l'« Okhrana » ; aussi le tristement célèbre Azef. Puis il avait infiltré des agents dans l'« Okhrana ». Il fonda la première Tchéka à Paris) sur l'ancien espion de l'« Okhrana » tsariste, devenu ensuite espion de la Tchéka, Iakouchev. Lorsque la révolution bolchévique a lieu en Russie, une partie des agents de l'« Okhrana » fuit en Pologne. De là, l'« Okhrana » envoie Iakouchev en Russie par une voie secrète, pour maintenir le contact, organiser les agents de l'« Okhrana » de Russie. Lorsque Iakouchev met le pied sur le sol russe, il voit qu'il est tombé dans les filets de la Tchéka.... La Tchéka propose à Iakouchev : soit devenir son agent, soit être fusillé. Iakouchev choisit la première proposition et devient un agent important de la Tchéká. Puis, il est envoyé en Europe par la Tchéka, près du vice-roi Nikolai Nikolayevich, en tant qu'agent de l'« Okhrana » ; le vice-roi ne se méfie pas, Iakouchev livre à la Tchéka toutes les lignes et contacts des monarchistes, il organise même l'enlèvement de l'activiste monarchiste célèbre, Koutiepov, de Paris.
C'était ce Iakouchev qui était mon enquêteur...
Préoccupation : - Ma présence dans la prison de Moscou avait ses préoccupations. Mes camarades à l'extérieur, comment vont-ils, leur langue est-elle fermée ? Ma langue est fermée, mais je sais qu'eux non plus ne sont pas insouciants. Plus tard, lorsque j'étais dans la prison d'Ortachala à Tiflis, ma mère raconta lors d'une visite que lorsqu'elle était allée à Moscou pour voir l'ambassadeur de Perse, à ma demande, elle avait aussi rencontré le prêtre Arsen Simonian ; celui-ci avait dit : « Sois béni, toi qui as élevé un tel enfant. Sa langue est fermée, nous sommes tous en sécurité ».
Ma mère s'était aussi adressée au fils de sa tante, Hayk Bzhishkian (Gay), qui était conférencier à l'Académie Militaire de Moscou. Hayk avait promis de faire son possible pour m'être utile, d'autant plus qu'il se souvenait de moi de Tiflis.
Ma mère raconta aussi qu'à Moscou, au bureau commercial des Aghamov, lorsqu'on avait parlé de mon emprisonnement, un Hentchak de Tabriz, Arakel Patmagrian, avait dit : - « C'est bien fait, ce Dachnak a battu beaucoup de komsomols à Tabriz.... ». Les Aghamov lui avaient fait une remarque de ne pas dire de telles choses sur un détenu. Le frère cadet de ce même Patmagrian, Achot Patmagrian, qui avait le surnom de « l'œil de Moscou » à Paris, avait eu les mêmes expressions à mon sujet ; mon enquêteur n'avait pas donné de nom, mais avait utilisé la même expression que son grand frère.
À Tabriz, dans le corps étudiant de l'École diocésaine, il y avait eu des affrontements de 1923 jusqu'en 1930, alors qu'à ces dates je n'étais pas à Tabriz, j'étudiais en Europe jusqu'en 1928, et de cette date jusqu'en 1930, j'étais dans les prisons soviétiques et je ne pouvais pas battre des komsomols....
Le matin du septième jour de ma grève de la faim, on vint, m'annonça de mettre fin à ma grève de la faim, on allait m'envoyer à Tiflis.
14. DE MOSCOU À TIFLIS ET LA FRONTIÈRE PERSE - VERS LA LIBERTÉ
DROCHAK, 8e année, N° 11, 16 Septembre, pp. 9-10 (401-402).
C'était vers la mi-mars 1930. Nous partîmes en train, accompagnés d'un tchékiste russe et d'un garde. Dans le compartiment où on m'installa, il y avait un civil russe, avec sa femme et son petit enfant. C'était un bon signe, il n'y avait pas de sévérité. Cela faisait près de deux ans que je n'avais pas vu de petit enfant, je me consolais en voyant l'enfant, mais je ne leur parlais pas. Eux aussi avaient compris que j'étais un détenu, ne parlaient pas, mais parfois me jetaient un regard bienveillant. J'avais une barbe, c'était aussi un signe que j'étais un détenu, amaigri par la grève de la faim.
À la prison de la Tchéka de Tiflis, on me fit à nouveau entrer dans l'une des cellules sombres avec des couloirs étroits et tortueux. Il y avait deux Géorgiens, un Arménien, nommé Abovian.
- Êtes-vous de Kanaker ? demandai-je.
- Oui, répondit-il, je suis de la lignée de Khatchatour Abovian.
C'était un homme d'environ soixante ans, aux cheveux blancs, à moitié chauve, de constitution robuste. Je fus rempli de respect.
Je n'avais pas de tabac, lui en avait, j'avais du savon de toilette, il dit : « Si vous me donnez du savon, je vous donnerai du tabac », je lui donnai mon savon, Abovian me donna cinq cigarettes.
* * *
On m'emmena chez un enquêteur. C'était un Arménien, nommé Poghosian.
- On va vous photographier, puis je vais vous envoyer en Perse, dit-il avec autorité, mais en me faisant sentir sa bienveillance.
Je fus photographié, la photo de moi avec la barbe fut ensuite collée sur mon laissez-passer (à Tabriz, le mari de ma sœur, Alex Saginian, ne me laissa pas déchirer cette photo, je l'ai encore jusqu'à présent).
Lorsque je retournai en cellule, les deux Géorgiens demandèrent ce qui s'était passé ; je dis qu'on m'avait photographié et annoncé qu'on allait m'envoyer en Perse :
- Aujourd'hui c'est le premier avril, ils t'ont trompé, dirent-ils....
Dans la prison provinciale d'Ortachala, on me mit dans une cellule où quatre-vingt-dix pour cent des détenus étaient des kinto de Tiflis ; ceux-ci virent que j'étais un type d'homme différent d'eux, on m'installa à la place d'honneur de la cellule, sur le lit de planches. L'un d'eux demanda : « Mon frère, tu n'es pas des nôtres, pourquoi t'ont-ils amené parmi nous ? ».
- Mon cher, moi non plus je ne sais pas pourquoi, dis-je.
Mon mot « mon cher » leur plut beaucoup, et ils commencèrent dès lors à me faire des honneurs, surtout un kinto nommé Moukuch, qui était un bon jeune homme. Lorsqu'on distribuait le déjeuner, les kinto apportaient d'abord mon assiette pour me la donner, puis prenaient la leur.
- De quoi as-tu besoin ? demanda Moukuch.
- De tabac, dis-je.
Immédiatement, ils me donnèrent du tabac appelé « makhortka ». Ce makhortka est le plus ordinaire, mais peu nocif ; ce sont des débris de branches de tabac, il faut les rouler dans du papier et fumer.
- Pourquoi vous ont-ils emprisonnés ? demandai-je.
- Pour le nalog (impôt), ils nous ont imposé tellement de nalog que nous n'avons pas pu payer, alors ils nous ont emprisonnés. Certains d'entre nous sont des vendeurs d'œufs, de légumes, de fruits, de poisson. (En ces années, il y avait encore des traces de la NEP - Nouvelle Politique Économique ; à partir de 1930 commença la politique des kolkhozes de Staline, et toute initiative privée fut mise fin).
Le jour, on emmenait les kinto travailler. Je demandai à Moukuch ce qu'ils faisaient. « Nous travaillons sur de la terre noire... ». Donc, ils creusaient la terre.
La cellule était spacieuse ; le soir, les kinto dansaient et chantaient. Il y en avait un qui n'était pas un kinto, on ne lui faisait pas confiance, et en effet, son comportement était suspect, lorsqu'il chantait, il prononçait des mots indécents.
Ma mère vint en visite, je lui demandai d'acheter beaucoup de tabac à la boutique de la prison, je le distribuai aux kinto en guise de remboursement de ma dette. Ils furent très impressionnés et me considéraient déjà comme l'un des leurs, surtout lorsque je dis qu'en 1917-1919, lorsque j'étais à Tiflis, j'avais eu des connaissances kinto. J'avais aussi souvent vu la pièce « Pépo » de Gabriel Sundukian au Théâtre Artistique.
« C'est un homme instruit », se disaient les kinto entre eux.
Pendant mon emprisonnement, les moments agréables furent avec les kinto.
Puis on me mit dans une cellule spacieuse, seul. On ne me faisait même pas sortir pour la promenade. Il n'y avait pas non plus de lit de planches, je m'allongeais par terre ; cette fois aussi, les souris ne me laissaient pas en paix, je vis une sorte de souris qui était étonnante : les doigts de ses pattes avaient des boules.
Les détenus libres des cellules ouvraient souvent le loquet de ma porte, regardaient, parfois faisaient des expressions, il était évident qu'il y avait des espions parmi eux.
Sur le mur en face de ma porte, était écrit : « Mara, mon amour.... ». J'avais une amie serbe nommée Mara à Paris, c'était son nom. Donc, on avait espionné ma vie à Paris.
Une autre fois aussi, lorsque ma mère avait apporté de la nourriture, elle l'avait enveloppée dans des journaux imprimés en russe ; je lus : « Kniaz Yégor Melik Vardanian... » Kniaz signifie prince, noble... Ma mère ne connaissait pas le russe, heureusement les Géorgiens qui examinaient la nourriture ne l'avaient pas lu non plus. Je le déchirai. Yégor Melik Vardanian était le fils du frère de mon grand-père maternel à Tiflis, dans le passé il avait été riche ; il avait une maison et un jardin à Tiflis, les bolchéviks les avaient confisqués, lui avaient donné une seule pièce. Je mis en garde ma mère de ne plus utiliser ces papiers.
Un autre jour, ma mère vint, vêtue de noir, je fus terrifié, il s'avéra que Yégor était mort. Pendant que j'étais à Iaroslavl, Yégor avait envoyé un paquet de nourriture en cadeau, mais je ne l'avais pas reçu. Il m'aimait et m'appelait « frère André », moi je l'appelais « frère Yégor ».
Un autre jour aussi, le paquet apporté par ma mère se perdit dans la prison ; je signalai, un gardien géorgien l'apporta, me le montra pièce par pièce, je confirmai que c'étaient les miennes, il les emporta, et je ne reçus plus mes affaires qui avaient été trouvées....
Se trouvait dans la prison d'Ortachala Alexan Movsissian de Mouch ; de derrière ma porte, il dit qu'à son retour de Pologne, on l'avait arrêté en tant que spéculateur (profiteur), on allait l'expulser en Perse. Je dis que moi aussi on m'avait dit qu'on allait m'exiler en Perse ; il dit : « Que Dieu fasse qu'on nous exile ensemble, il n'y a personne ici avec qui parler ».
Moi aussi, je m'occupais des souris ; je les nourrissais et observais leurs mouvements rapides et craintifs.
* * *
En train, on nous emmena, nous cinq personnes - trois jeunes Turcs, Alexan Movsissian et moi - à la prison de Nakhitchevan, sol en terre, sur quelques minces poteaux en bois une plate-forme en planches, sur laquelle nous nous installâmes. Le lendemain, on nous emmena, nous cinq, dans une prison militaire près de la frontière, qui s'appelait « pogranitchny otdel Guépéou » (section frontalière du Guépéou).
La cellule était si étroite que nous cinq ne pouvions pas nous allonger côte à côte - nous nous allongions en largeur, les pieds appuyés contre le mur... Alexan jurait. Je le mis en garde, car j'avais entendu en prison que parfois il était arrivé qu'on dise à quelqu'un qu'on l'exilait, en chemin il avait lâché des paroles, la Tchéka l'avait ramené de la frontière et... fusillé.
Lorsqu'on nous fit sortir pour nous emmener, je regardai à ma droite et restai figé. L'Ararat apparaissait entièrement, à son sommet un grand anneau de nuage, à travers lequel un rayon de soleil tombait sur la montagne... J'avais vu many times le Massis, mais cette fois, c'était tout à fait différent ; il avait l'air d'un endeuillé, peut-être parce que c'était la dernière fois que je voyais le Massis, l'esprit de l'Arménie. Je m'éloignai comme un endeuillé triste.
La « prison » de Djoulfa était un vrai nid de poule ; les murs en boue, dessus une épaisse couche de terre et de poussière ; une couche haute en terre pour s'allonger, lorsque nous touchions le mur, une épaisse poussière tombait.
Un jour aussi, on nous emmena pour des travaux physiques ; nous transportions des rondins ; Alexan jurait : « Allons-nous nous libérer de cet enfer, oui ou non ? ».
Près du pont de l'Araxe, on nous remit nos affaires. Pour notre argent gardé chez eux, on nous donna un grand papier, sur lequel était écrit : « Vous pouvez venir le récupérer dans six mois.... ». Qui était devenu fou pour venir six mois plus tard récupérer ses quelques roubles et retomber dans un piège...
On ne nous remit pas nos passeports en main, un tchékiste marcha avec nous jusqu'au milieu du pont de l'Araxe, remit les passeports à un fonctionnaire persan.
Du pont de l'Araxe jusqu'à la Djoulfa persane, c'est environ un kilomètre et demi. Il n'y avait pas de moyen, nous mîmes notre paquet sur le dos et nous nous mîmes en route à pied. Nous n'avions pas un kopeck, nous ne savions pas ce qui nous attendait à la Djoulfa persane. En chemin, nous voyons un commerçant arménien avec son fils venir, pour passer à la Djoulfa russe ; Alexan dit : - « Eh, c'est Tigran Guloyan, je le connais, je vais lui emprunter de l'argent » et s'approcha.
Monsieur Tigran, je suis Alexan Movsissian, tu me connais ; on nous a exilés sur cette rive, nous n'avons pas d'argent, prête-nous un peu d'argent, à Tabriz nous te le rendrons en dollars.
- À quel taux, à quel taux ? demanda Tigran.
- Au taux du jour, dit Alexan.
- Non, non, il ne nous tend pas la main, il ne nous tend pas la main, dit Tigran et marcha...
Lorsque Alexan revint près de moi, je dis : « Est-ce que ça valait la peine de demander un prêt à un tel individu ? ». « J'ai cru que c'était un homme, qu'il comprendrait notre situation d'exilé », se plaignit Alexan.
À la Djoulfa persane, nous nous présentâmes au service des passeports. Le fonctionnaire regarda nos laissez-passer et nos visages, dit : - « L'un est commerçant, l'autre étudiant, les autres fonctionnaires. Chacun de vous doit payer quatre ghrans... ». Nous fûmes décontenancés. - « Nous n'avons pas d'argent », dîmes-nous. « Commerçant, étudiant, avec moustache et barbe, vous n'avez pas d'argent ? Alors, que chacun de vous paie au moins dix shahis », dit le fonctionnaire. « Nous n'en avons pas », dîmes-nous, voyant que le fonctionnaire jouait avec nos sentiments. « Wah, vous n'avez même pas dix shahis ? Pour vous cinq, ça fera deux ghrans, dix shahis », dit-il. À ce moment, l'un de nos exilés turcs dit au fonctionnaire : « Agha, à Tabriz, tu connais untel ? ». Le fonctionnaire dit : « Oui, c'est mon bon ami ».
« Alors, dans ce cas, prête-moi deux ghrans, dix shahis, je vous les rendrai certainement de Tabriz », dit le Turc.
Le fonctionnaire n'objecta rien. Il porta la main à la poche de son gilet, donna deux ghrans, dix shahis au Turc, le Turc les lui paya, nous reçûmes nos passeports et sortîmes en sueur.
15. SUR LE SOL PERSAN - LIBRE, MAIS EXILÉ
DROCHAK, 8e année, N° 12, 30 Septembre, 1987, pp. 9-11 (445-447).
Dehors, nous fut rencontré par l'un de nos camarades exilés, Ara, qui utilisait des camions ; il me reconnut, savait que j'avais été emprisonné, et se proposa de m'emmener à Tabriz avec son camion. C'était le salut ; seulement, je devais passer par le bureau de télégraphe de Djoulfa, télégraphier à notre beau-frère Alex Saginian, qui était le chef de la section latine du télégraphe, lui annoncer que j'étais arrivé à Djoulfa, que j'étais libre désormais. C'est ce que je fis, le fonctionnaire persan du télégraphe connaissait très bien Alex, télégraphia immédiatement gratuitement.
J'allai et m'assis à côté du chauffeur du camion d'Ara, le camion devait partir trois heures plus tard. Il faisait déjà nuit, claire de lune, je dormis dans le camion.
La voix de mes proches me réveilla : « André est ici », disait le cher Alex. C'était ma sœur Siranouch et Monsieur Vagharchak Zakarian, qui étaient venus avec son automobile.
Là, mes nerfs tendus pendant le chemin se détendirent et je ne pus me contenir, je me mis à sangloter. Les jeux psychologiques de la prison, surtout la calomnie sordide d'Andréïeva, que j'étais soi-disant un agent français, avaient blessé mon amour-propre. Mais d'un autre côté, j'étais fier que ni nos camarades de Moscou, ni moi, n'avions rien révélé, nous avions tous gardé les secrets sacrés du parti.
Ce n'est qu'en 1937, c'est-à-dire neuf ans après ma rencontre, lorsque les cruelles purges staliniennes commencèrent en Union Soviétique, que nous apprîmes que nos camarades de Moscou, Smbat Khatchatrian, Arsen Shahmazian, Bagrat Topchian et sa femme, Mlle Hélène Medzboyian, avaient été envoyés en Sibérie ; le camarade Arsen Shahmazian était devenu fou, et les autres disparurent dans les conditions cruelles de la Sibérie, victimes du Moloch cannibale du bolchévisme. Les camarades Korioun Ghazazian, Tigran Avétisian, Sahag Stépanossian disparurent aussi dans les gelées de Sibérie... Eux tous n'étaient pas des victimes ordinaires, mais des martyrs, parce qu'ils se sacrifièrent pour une idée ; pour les droits et la liberté du peuple arménien.
J'étais si jaloux du secret du parti qu'un doute me traversait l'esprit : « Ne serait-ce pas que l'Adrbadagan a été soviétisé et qu'on m'a envoyé ici pour apprendre mes secrets... je dois tester les camarades ». - je pensais et j'étais prudent et réservé lorsque les camarades me rendaient visite.
Un jour, le camarade Gaspar Tsakobian me dit :
- Notre camarade Haykak Kosoyan est devenu fou. Il dit : soit André nous fait un rapport sur sa mission, soit il sera soumis à un attentat...
Je répondis avec colère :
- Gaspar, tu es un vieux membre du parti, tu as une idée du secret de la Fédération Révolutionnaire Arménienne. Tu sais que le riz ne trempe pas dans la bouche de nos camarades exilés. Je ne peux révéler aucun secret ici, celui qui m'a envoyé était le Bureau, c'est à lui que je dois aussi rendre compte. Si pour cela on doit me soumettre à un attentat, qu'ils le fassent. Je ne peux pas donner le nom de nos camarades du pays.
Gaspar fut tout à fait d'accord avec moi. J'ajoutai que je ne dirais certaines choses qu'à lui seul, Gaspar, en privé, mais que je ne donnerais le nom d'aucun camarade.
Plus tard, Gaspar m'apprit que le Comité central avait trouvé tout à fait juste ce que j'avais dit.
Nous prîmes rendez-vous avec le camarade Gaspar dans son appartement, dans le quartier de Lilava, dans la maison des Melik-Abrahamian. Je racontai les prisons, les méthodes de la Tchéka, mon secret et l'opinion des camarades du pays : 1) dissoudre notre organisation secrète, clandestine et 2) les bolchéviks arméniens ont commencé à faire ce que nous aurions voulu. Je dis aussi que je ne devais pas donner le nom des camarades, même à lui, Gaspar, mais seulement au Bureau. Je dis aussi que les bolchéviks avaient une grande investigation, un espionnage ; alors que la Fédération Révolutionnaire Arménienne n'en avait pas, alors que pour l'autodéfense et la sécurité, elle devait en avoir. Je racontai comment le tchékiste qui m'avait arrêté, Micha Aghamalov, avait dit qu'il avait vécu dans la cour du camarade Mikayel Stépanianents et avait lu les procès-verbaux du Comité central. Gaspar fut troublé. « Lève-toi, dit-il, regardons nos caves, au cas où quelqu'un ne serait pas caché ». Nous regardâmes, il n'y avait personne.
(Plus tard, la Fédération Révolutionnaire Arménienne eut son service de renseignement à Tabriz, c'est moi qui le dirigeai, et nous obtînmes de grands et intéressants résultats. J'écrirai à ce sujet en son lieu).
Mon emprisonnement avait duré deux ans (du 14 juillet 1928 au 21 juin 1930). Mon beau-frère Alex avait dépensé six cents tomans pour ma libération, pour donner des télégrammes et des demandes. Nous avions une maison paternelle dans le quartier de Gali Badan à Tabriz ; nous la vendîmes pour exactement six cents tomans et payâmes nos dettes ; Alex et son frère Dora Saginian (député arménien au Medjliss) avaient beaucoup travaillé dans ce sens. À Moscou aussi, l'ambassadeur de Perse était Ali Goli Khan Ansari, qui avait fait un grand travail pour me libérer en tant que sujet persan. Si je n'avais pas eu cette nationalité, je pourrissais maintenant dans les prisons soviétiques.
Les frères Shahgueldian, Vahram, Levon et Mihran ; ils avaient une usine de tabac et de savon appelée « Mir », ils me prirent comme gérant de la boutique.
* * *
Les Kurdes de l'Ararat étaient en insurrection ; un instructeur y avait été envoyé par la Fédération Révolutionnaire Arménienne, Artaches Melkonian, avec qui le contact était maintenu depuis Salmast, par l'intermédiaire du camarade Samuel Mesrobian. Chaque fois que Samuel venait à Tabriz, il disait : « Je suis venu vider mon sac » et racontait les allées et venues de l'Ararat ; l'État turc dépensait des milliers de pièces d'or par jour pour son armée et faisait des victimes, mais ne parvenait pas à assiéger le grand Ararat, les Kurdes se battaient bien. La Fédération Révolutionnaire Arménienne aidait par de l'argent, de la littérature et des conseils, ne faisait pas de victimes, comme nous l'avions décidé à la dixième Assemblée générale. Notre représentant au Hentchak en Syrie était le camarade Comte (Vahan Papazian).
En ces jours, le premier ministre persan Teymour Tach avait exigé que se présentent de Tabriz à Téhéran : le Primat du diocèse arménien de l'Adrbadagan, l'Archevêque Nersès Melik-Tanguian, Samson Tadéossian, Gaspar Tsakobian, Varos Babayan (représentant du Bureau), Khatchik Melkoumian. Ils partirent pour Téhéran. Avant cela, Rouben (Ter-Minassian), membre du Bureau, était venu à Téhéran et avait appelé Haykak Kosoyan et Samuel Mesrobian à Téhéran pour l'affaire kurde, et l'avait arrêtée. De là, Haykak Kosoyan s'était tendu contre Rouben....
L'interprète, près de Teymour Tach, avait été Dora Saginian en français ; Teymour Tach avait exigé de nos gens qu'ils cessent de collaborer avec les Kurdes et avait dit que l'Iran devrait céder le petit Massis à la Turquie... Nos gens avaient objecté que le petit Massis avait une importance militaire et pourquoi l'Iran devrait le céder à la Turquie. Le premier ministre Teymour Tach avait objecté que dans la vie militaire moderne, lorsque les avions opèrent, quelle importance avait un petit Massis...
Nos gens retournèrent à Tabriz tête basse et l'affaire de l'insurrection kurde fut close.
Au cours de ces événements, Rouben avait quitté précipitamment l'Iran, il y avait un soupçon qu'il pourrait être arrêté par Teymour Tach. À peine deux ans plus tard, Teymour Tach fut emprisonné par Reza Chah dans la nouvelle prison de police de Téhéran.
Léon Karakhan fut envoyé de Moscou pour intervenir afin qu'on le libère de prison, mais il n'y parvint pas. Teymour Tach, en tant qu'agent soviétique, fut étranglé dans la prison qu'il avait construite, en tant que premier détenu....
J'écrivis une lettre à Rouben, exprimant mon étonnement qu'il soit venu à Téhéran et ne m'ait pas envoyé de message pour que j'aille à Téhéran et lui fasse un rapport sur mes activités en Union Soviétique, n'était-ce pas lui qui m'avait mis en route ? Je reçus une lettre de lui, il écrivait : « Mon cher André, tu es entré dans la tombe et tu en es sorti vivant. Pardonne-moi de ne pas t'avoir appelé à Téhéran, mon sort était aussi menacé, les camarades t'auront raconté, j'ai été obligé de partir précipitamment. J'ai de bons sentiments envers toi, continue ton travail de parti ».
J'avais envoyé une série d'articles à notre journal « Housaper » en Égypte, dont le rédacteur en chef était le camarade Vahan Navasardian ; le titre de mon article était « Sous les talons de fer », j'y décrivais la prison de la Tchéka soviétique, en Arménie. Mon article était lu avec grand intérêt dans toutes les colonies ; même à Tabriz, « Housaper » gagna cent abonnés. Vahan écrivait : « André, mon cher, je lis ton article non pas en tant que rédacteur, mais en tant que lecteur enthousiaste ». Je reçus aussi une lettre d'Avédis Aharonian, qui exprimait sa joie pour ma libération et son admiration pour le beau style de ma description. (Moi aussi, à mon tour, j'ai été influencé par l'arménien d'Aharonian, qui est très beau).
À la rentrée scolaire de 1931, je fus invité à un poste d'enseignant à l'« École centrale diocésaine des Arméniens de l'Adrbadagan » ; j'enseignais la langue et la littérature arméniennes, l'histoire arménienne, l'histoire générale et l'économie politique ; j'aimais mes élèves, je me comportais poliment, eux aussi étaient très attachés, intimes avec moi.
En cas de désordre dans une classe, c'est à moi qu'on envoyait les enseignants, et je calmais la classe. Le directeur était Gaspar Tsakobian, les enseignants étaient Hayrapet Panirian, Levon Grigorian et d'autres.
L'« École centrale », secondaire, était mixte ; elle avait un haut niveau moral, a donné de nombreux enseignants et directeurs aux écoles arméniennes de Perse. Elle fut fondée en 1909, fermée en 1936, à la suite des persécutions scolaires.
Les relations entre l'enseignant et l'élève sont très douces, surtout dans la vie, lorsque tu rencontres ton ancien élève, c'est comme si tu rencontrais ton proche.
* * *
En 1932-33, je fus élu membre du Comité central de la Fédération Révolutionnaire Arménienne pour la région de Vrèj (Adrbadagan) : les camarades Varos Babayan, Haykak Kosoyan et moi. Ce même Haykak Kosoyan qui, deux ans auparavant, avait demandé à me soumettre à un attentat, était maintenant venu s'asseoir avec moi. Au Comité central... J'étais secrétaire. Le ministre de l'Éducation appelé Hekmat (musulman d'origine hébraïque) exerçait une pression sévère et brutale sur les écoles et la langue arméniennes.
De 1932 à 35, je fus élu président de l'« Union culturelle » de Tabriz. Nous avions des conférences régulières tous les mardis soirs ; nous célébrions les fêtes nationales-culturelles dans la salle de théâtre, qui avait une capacité d'environ trois cents personnes. Nous formâmes une troupe de théâtre avec les bonnes forces disponibles.
L'union avait une bibliothèque, assez riche en livres arméniens, russes, français. Le bibliothécaire était le camarade Hayk Yéganian.
L'activité du « Culturel » avait irrité les bolchéviks ; les Soviétiques avaient exigé des autorités persanes de fermer le « Culturel »...
L'activité du « Culturel » avait irrité les bolchéviks ; les Soviétiques avaient exigé des autorités persanes de fermer le « Culturel »...
Lorsque le colonel Seïf m'appela et me parla de cela, j'objectai que nous n'avions pas d'activité politique, mais culturelle.
- Je sais, dit Seïf, mais eux exigent même de nous que nous expulsions vingt-six Dachnaks de l'Adrbadagan.... Mais nous nous y opposons, parce que vous jouez le rôle de rempart contre le bolchévisme. Si nous vous expulsons, nous sommes aussi perdus.
La fois suivante qu'il m'appela, je consultai le Révérend Melik-Tanguian et décidai de démissionner moi-même de la « présidence du Culturel » et non de fermer l'union. C'est ce que j'annonçai à Seïf, que j'avais déjà démissionné. Ma place fut prise par le camarade Khatchatur Grigorian, sous qui seul la danse et le jeu de loto étaient permis...
Mes articles « Sous les talons de fer » puis aussi mes « Souvenirs de l'expédition Koukounian » recueillis à Tabriz de Yovsèp Movsissian, qui étaient parus dans le mensuel bostonnais « Hayrenik » en 1933-34, ma signature A. Amourian m'avait rendu célèbre dans la diaspora, surtout près du Bureau. Aussi en tant que membre - secrétaire du Comité central de Vrèj.
Notre organisation de la région de Téhéran était divisée. Yovsèp (Barbe) Yovhannissian luttait contre le Comité central, dont les membres étaient : le docteur Haroutioun Stépanian, le docteur Vartan Yovhannissian (aussi propriétaire du « Alik »), Stépan Khanbabian, Yéghiché Hovhannian et Hampartsoum Grigorian. Le Bureau avait dissous le Comité central, et avait aussi suspendu Yovsèp Yovhannissian. Le rédacteur en chef du bihebdomadaire « Alik » était Yovsèp Tadéossian, qui avait aussi été dissous.
Le Bureau avait convoqué en tant que Comité central désigné pour le Mrgastan (Téhéran et l'Iran central) les camarades Grigor Mkhitarian, Mkrtitch Hovhannjian, A. Amourian à la fois comme membre du Comité central et comme rédacteur en chef du journal « Alik ». Mais parce que jusqu'à la fin mai 1936 j'avais des cours à l'« École centrale », je ne pouvais me rendre à Téhéran qu'au début juin, c'est pourquoi jusqu'à mon départ le journal avait été confié à Yervand Hayrapetian. L'éditeur de « Alik » était Mkrtoum Mkrtchian, le propriétaire de l'imprimerie était Ferdinand Simonian ; la section comptabilité-correspondance était dirigée par le camarade Tachat Poghosian, aussi la correction du journal.
En 1936, l'École centrale ferma définitivement, je partis pour Téhéran, début juin. (FIN)
PAGES ANCIENNES - Étudiant et député à la 10ème Assemblée Générale du H. Ch. D.
DROCHAK, 70e année, N° 6-7, 9-23 Juillet, 1986, pp. 13-15 (225-227).
Nous sommes arrivés à Prague au « Studencheski Dom » (Maison de l'Étudiant), on nous a envoyés dans un dortoir modeste et plein d'étudiants. C'étaient pour la plupart des Russes et des Ukrainiens exilés, ayant fui à l'étranger à cause de la révolution.
L'armée tchécoslovaque, à la fin de la Première Guerre mondiale, après être passée par les épreuves des guerres civiles russes, était passée par la Sibérie pour rejoindre la Tchéquie, obtenant son indépendance grâce au célèbre leader intellectuel Masaryk. Les organisations d'exilés russes entretenaient des relations étroites avec Masaryk, ainsi que les dirigeants de la Fédération Révolutionnaire Arménienne (Dashnaktsoutioun), c'est pourquoi le gouvernement tchèque accepta environ quarante-cinq étudiants arméniens, à ses frais.
On nous informa que chaque étudiant recevrait douze dollars par mois pour le logement et la nourriture. Nous devions louer un logement, et nous devions déjeuner à la cantine du « Studencheski Dom », qui était très abordable.
Au début, avec Hakhnazarian, nous avons loué une chambre chez une vieille dame tchèque. Ce logement était loin de l'université, donc avec Gaspar Jakobean, Hambardzum Grigorean et Baghdik Minasean, j'ai loué une chambre près de l'université.
À la cantine, nous faisions la queue et montrions du doigt la nourriture que nous voulions, puis, quand nous nous sommes habitués à la langue tchèque, nous donnions le nom du plat.
L'étage supérieur de la Maison de l'Étudiant avait des salles de jeux, c'était surtout le ping-pong qui nous attirait. L'ambiance était agréable ; nous nous étions liés d'amitié avec des étudiants tchèques et russes, surtout avec un Tchèque de grande taille, au caractère simple, nommé Hojik.
L'université de Prague avait aussi une section russe de droit et d'économie, où enseignaient des professeurs célèbres exilés de Russie, parmi lesquels aussi le professeur d'origine arménienne V. Totomiants, spécialiste des coopératives. Les autres professeurs russes étaient Kizevetter - historien, Katkov - spécialiste du droit romain, Struve et Kasiński - économistes, Alexeïev - spécialiste du droit russe. Il y avait aussi les assistants de ces professeurs.
J'ai choisi la section russe, particulièrement l'orientation économique. Mais l'examen de langue tchèque était obligatoire. Je me suis préparé et au sixième mois, j'ai passé l'examen. Le tchèque, en tant que langue slave, est similaire au russe, bien que ce soit une langue distincte. Celui qui connaît déjà le russe n'aura pas de difficulté à comprendre le tchèque, le bulgare, le serbe, le polonais.
Les étudiants arméniens étaient : Arshalous Astvatsatrian, Yeprem Sargsian, Yervand Hayrapetian, Gaspar Jakobean, Aharon Taturian, Vahan Mirakhorian (c'étaient les plus âgés), Mushegh Tamrazian, Hambardzum Grigorian, Stepa Navasardian, Nikol Nikoghosian, Serojha Torosian (d'âge moyen), et les plus jeunes étaient : Shavarsh Makarian, Levon et David Melik-Dadayian frères, Babgen Rashmajian, Ashot Sahakian, Grigor Mkhitarian (Mkho), Nikol Badalian, Hayk Asatrian, Baghdik Minasean, Hayk Yeganian, Hovhannes Hakhnazarian, Gharibian, André Ter Ohanian, Martiros (de Mouch, parmi les orphelins), Mkrtich Yeretsian, Onnik Devetjian.
Nous avions des soirées de conférences et de discussions sur des questions politiques ; parfois des débats, mais généralement nos relations étaient amicales.
Hayk Asatrian, avec qui j'avais lié amitié à Etchmiadzine–Erevan, puis à Tabriz, était une personnalité très originale ; il avait beaucoup d'amour pour la philosophie. Quand j'étais près de lui, il lisait en allemand de manière sonore, comme quelqu'un qui lit le Coran, ce qui m'amusait beaucoup. Il avait certaines extrémismes envers les défauts des autres ; je l'adoucissais.
À notre disposition, il y avait aussi une riche bibliothèque, et les conférences des professeurs nous étaient données dactylographiées.
Notre cursus se déroulait sans heurts. Je ne manquais aucune conférence. Je plaignais beaucoup le prof. V. Totomiants, parce qu'il était presque aveugle, on l'amenait en salle en le tenant par la main ; il ne regardait pas ses notes, il donnait sa conférence.
J'ai passé les examens de la première année « très bien » ; j'avais beaucoup étudié et pris des notes. Je me sentais faible, le médecin conseilla que j'aille à la campagne pour l'été. Je dois aussi dire que l'air de Prague était très pollué. De la suie, une suie incessante. Les Tchèques disaient que c'était la politique de l'Empire austro-hongrois de construire des usines à Prague, d'empoisonner l'air, pour que le peuple tchèque soit physiquement anéanti ; et en effet, Londres et Prague étaient connues en Europe pour leur haut pourcentage de tuberculeux. Pour sauver le peuple tchèque d'un grand fléau, les dirigeants tchèques fondèrent une association sportive nommée « Sokol », qui prit une grande ampleur et renommée.
Quelques-uns de nos étudiants développèrent une faiblesse des poumons et quittèrent Prague, sur conseil médical. Le camarade Hambardzum Grigorian était l'un d'eux ; il partit pour Paris pour y continuer ses études.
Je partis pour la campagne. La chambre que j'avais louée avait l'inconvénient qu'un train passait près d'elle avec un grand bruit ; je sursautais dans mon sommeil. Les paysans tchèques étaient des gens doux et aimables, mais dans notre cour, des rendez-vous amoureux avaient lieu la nuit ; pour ces deux raisons, je changeai de chambre.
* * *
La deuxième année de mes études, le 20 décembre 1924, nous reçûmes, le camarade Gaspar et moi, à notre adresse, un télégramme disant que la 10ème Assemblée Générale du H. Ch. D. s'ouvrait à Paris et que nous étions tous deux élus par l'organisation d'Adrbadagan pour participer à l'assemblée.
Gaspar et moi sommes partis pour Paris. Le bureau de la Délégation de la République d'Arménie se trouvait au 71, Avenue Kléber. Nous avions quatre-cinq jours de retard sur l'assemblée. Au début, les séances avaient lieu dans des pièces misérables et modestes ; ensuite, elles furent transférées dans la salle de la Délégation, qui était présentable.
Les députés étaient Avétis Aharonian et Alexandre Khatissian pour la Délégation de la République d'Arménie, le Dr Hovsep Ter-Davtian pour le Tribunal Suprême du H. Ch. D., Aharon Sashekhlian, Shahan Natali et Manouk Hambardzumian pour l'Amérique, le Dr Armenag Melik-Barseghian, Hovhannes Amatuni (je ne me souviens plus pour qui), Vahan Navasardian pour l'Égypte, Armen Sassouni pour le Liban, Mikayel Varandian, Ishkhan Arghoutian, Karo Sassouni, Diran Baghdasarian, Samuel Mesropian (invités avec voix consultative), puis Vahagn Krmoyean arriva de Constantinople ; un camarade arriva de Bulgarie, qui participa à peine à deux séances, puis partit pour ses affaires personnelles. Hagop Kocharian en tant que secrétaire, avec voix consultative, Gaspar et moi pour la région « Vrech » d'Adrbadagan avec voix délibérative, puis les membres du Bureau : Rouben Ter Minassian, Simon Vratsian, Achak Jamalian. Trois personnes étaient venues de l'organisation illégale d'Arménie : Guérasim Atadjian (il avait été un important compagnon d'armes de Nzhdeh au Zanguéour), Artsrouni Toulian et Mamikon, qu'on baptisa du nom de « Vartan » (nous disions en plaisantant « Vartan Mamikonian »). Les députés plus jeunes, les jeunes, n'étions que trois : Achot, Mamikon et moi, âgés de 23-24 ans.
Lors de la première séance, Gaspar et moi étions en retard, quand nous entrâmes, Achot parlait – faisait un rapport en langue du Caucase ; il décrivait la situation des camarades du Pays, les persécutions de la Tchéka, la situation économique et politique difficile.
Après l'échange d'idées, Achot, agité, déclara :
- Le Pays veut des choses concrètes de votre part... Pas des paroles.
Ensuite, Achot, à presque chaque séance où la question du Pays était soulevée, martelait ce point.
Envers les Soviets, la Fédération Révolutionnaire Arménienne avait adopté le rôle d'opposition loyale, une lutte seulement sur le terrain idéologique ; l'armée rouge assurait dans une certaine mesure l'existence physique des Arméniens d'Arménie. La Fédération Révolutionnaire Arménienne était contre l'insurrection (l'insurrection géorgienne de 1924 fut noyée dans le sang, de même que l'insurrection des Azerbaïdjanais du Moughan en 1926).
L'organisation illégale du Pays était maintenue pour garder vivace l'esprit national dans le peuple arménien.
La 10ème Assemblée Générale du H. Ch. D. eut une signification historique en cela que dans les demandes politiques du programme de la Fédération Révolutionnaire Arménienne fut incluse la revendication d'une Arménie Libre et Indépendante.
Une autre décision importante était que la Fédération Révolutionnaire Arménienne devait de toutes les manières soutenir et s'engager dans les travaux d'organisation des colonies arméniennes, car après le Génocide d'Avril et la chute de la République, les colonies arméniennes se trouvaient dans un état désorganisé.
La troisième décision importante fut la proposition d'organiser le « Jour de la Fédération Révolutionnaire Arménienne », faite par le camarade Chavarch Missakian : « Chaque année, le 2 octobre, célébrer publiquement le "Jour de la Fédération Révolutionnaire Arménienne", comme jour de rapport de l'année écoulée. »
Il y eut des conflits d'opinions autour de la question de l'indépendance de l'Arménie, qui devait entrer dans le Programme. Les camarades Mikayel Varandian, Ishkhan Arghoutian et Manouk Hambardzumian étaient partisans d'une fédération ; cela prit assez longtemps jusqu'à ce qu'on les convainque de voter en faveur de l'indépendance, qu'ils considéraient comme un but lointain mais ultime.
Les séances de l'Assemblée Générale étaient presque terminées quand un télégramme arriva de Berlin, disant que le camarade Dron était arrivé de Moscou à Berlin avec Aramais Yerznkian. La question fut posée : devait-on appeler Dron ou non ? Vahan et un ou deux camarades avaient des doutes. On objecta que l'Assemblée Générale avait terminé ses travaux, nous ne pouvions que l'écouter. Dron vint et fit un rapport sur les points de vue des camarades du Pays, concernant les problèmes politiques et organisationnels. Là, je vis avec étonnement comment les camarades du Pays avaient exprimé les mêmes points de vue que notre 10ème Assemblée Générale. Les membres de la F.R.A., même séparés par des milliers de miles, pensent exactement de la même manière, parce que leur point de départ est le peuple arménien et la patrie arménienne.
Avec Dron se trouvait le camarade Hrach Papazian, qui était l'un des complices des actes de terreur contre les hommes d'État turcs, et Dron était, oh, un vieux terroriste renommé.
Le départ de Dron de Moscou pour l'étranger avait été facilité par le célèbre activiste communiste Ordjonikidzé, qui avait des relations personnelles étroites avec Dron.
Après le rapport de Dron, nous n'eûmes plus de doute sur lui.
Avant l'arrivée de Dron, l'élection avait déjà eu lieu. Furent élus au vote : Simon Vratsian, Achak Jamalian, Chavarch Missakian, Shahan Natali (c'était une condition de l'organisation d'Amérique qu'un membre du Bureau soit l'un de leurs députés ; il y avait aussi le fait que Natali était membre du comité secret). Puis Rouben fut élu.
Après l'élection, Simon Vratsian se leva et fit la déclaration suivante : –
- Camarades, un malentendu s'est produit dans le passé entre moi et le camarade Vahan, pour lequel je demande pardon. Le camarade Vahan est quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas aimer...
À ces mots, Vahan se recroquevilla d'abord, puis bondit de sa place et embrassa Vratsian. Nous applaudîmes.
À ce moment, Alexandre Khatissian se leva aussi de sa chaise, disant : « Moi aussi... », mais la phrase resta en suspens ; Vahan bondit de sa place en disant : « Je ne peux plus faire l'impossible » et se précipita hors de la pièce....
Khatissian continua :
- Le camarade Navasardian est un camarade franc, quand ma candidature fut posée pour la mairie d'Alexandropol, Vahan vint me voir et déclara : « Je ne te donnerai pas ma voix ! ». Une telle attitude est appréciable, alors qu'il y en a d'autres qui agissent en secret.
Nous applaudîmes aussi Khatissian.
La Fédération Révolutionnaire Arménienne est une famille, dont les membres peuvent parfois se disputer, mais quand il s'agit de l'œuvre et de l'idéal, ils sont des collaborateurs unanimes.
* * *
Après la clôture de l'Assemblée Générale, les camarades dirigeants avaient invité le leader-théoricien du parti socialiste-révolutionnaire russe, Viktor Tchernov, à parler des allées et venues en Union Soviétique.
V. Tchernov était un homme de taille moyenne, avec une tête de lion, des cheveux ondulés coiffés en arrière, une courte moustache et barbe, de petits yeux (en amande), impressionnant tant par son apparence extérieure que par son talent d'orateur.
Il parla du mouvement trotskiste. Après Lénine, il considérait Trotski comme supérieur à tous les autres dirigeants. Il prévoyait une grande lutte après Lénine (et ce fut effectivement le cas, surtout Staline qui persécuta et Trotski, et ensuite les autres dirigeants).
Abordant les partis en exil, il utilisa l'expression anglaise « very dangerous » (très dangereux), expliquant le danger de colonisation dû à la coupure d'avec le pays mère et conclut que ces partis en exil devraient un jour se dissoudre, tôt ou tard.
Le résumé de cette conférence de V. Tchernov parut dans « Housaper » (Le Porteur de Bonne Nouvelle, au Caire), avec le titre anglais « very dangerous ».
Dans les décennies suivantes, effectivement, les partis russes en exil se dissolurent, disparurent. Dans la Russie tsariste, il existait cinquante-six factions et partis politiques, qui tous se dissolurent sauf deux : le parti bolchevique et la F.R.A. Les bolcheviks aussi se seraient dissous s'ils n'avaient pas pris le pouvoir. Resta la F.R.A.
Dans le cas de la F.R.A., V. Tchernov se trompait : premièrement, outre l'Arménie, le peuple arménien avait des colonies arméniennes. La F.R.A. avait un terrain d'action ; étant un parti d'idéal national, la F.R.A. était acceptée partout parmi les masses arméniennes. Après l'exil, la F.R.A. se renforça et se développa davantage dans les colonies, englobant de larges masses et organisant la vie nationale des colonies.
Plus d'un demi-siècle s'est maintenant écoulé depuis la déclaration de V. Tchernov. La F.R.A. est debout dans plus de quarante colonies arméniennes et aspire à conquérir la liberté, l'indépendance du peuple arménien – avec des terres unies, car la Diaspora n'a pas d'avenir, le peuple arménien doit vivre sur ses terres ancestrales.
ANDRÉ TER-OHANIAN
(A. AMOURIAN) SOUVENIR D'HIER
TÉHÉRAN JANVIER 1982
Peuple arménien et Arménie, si je vous oublie, que ma langue se scelle à mon palais.
Je suis déjà riche de ma richesse : mon idéal, ma plume.
Traits biographiques
André Ter-Ohanian est né le 14 novembre 1899 à Tabriz.
Il a reçu son éducation primaire à l'école « Aramian » de son lieu de naissance, puis a étudié au séminaire « Guévorgian » de Saint-Etchmiadzine.
Il termine le cursus du séminaire en 1917, à une période cruciale pour la vie nationale et politique du peuple arménien, alors que le front du Caucase se trouvait dans une situation alarmante. En 1918, lorsque des régiments de défense arméniens étaient organisés pour protéger les régions menacées de l'Arménie Occidentale, A. Ter-Ohanian s'enrôle dans une compagnie de volontaires étudiants et part pour Karine. Cependant, en raison de la retraite survenue en mars de la même année, A. Ter-Ohanian passe par Sarikamish, Kars, Gharakilise, puis Tiflis, où il reste jusqu'en 1919.
Au printemps 1919, il revient à Tabriz et, dès septembre de la même année, se consacre au domaine de l'éducation, comme professeur de langue maternelle. De 1919 à 1923, il fait partie des comités de rédaction des journaux « Aïg » et « Arshalouys » et apporte sa participation active aux travaux du parti de la F.R.A. dans la région d'Adrbadagan.
En 1923, il part pour la Tchécoslovaquie et suit les cours de la faculté de droit de la section russe de l'Université de Prague. Deux ans plus tard, en 1925, il part pour Paris, où il suit les cours d'économie politique de l'Université de la Sorbonne. De 1925 à 1928, il collabore à l'organe de la F.R.A. « Drôchak » et au quotidien « Haratch ». Durant la même période, il devient le secrétaire personnel du célèbre écrivain Avétis Aharonian et établit des liens étroits avec de nombreuses personnalités intellectuelles et des figures nationales et révolutionnaires éminentes se trouvant alors à Paris, notamment avec A. Aharonian et S. Vratsian, prenant en charge la correction de l'œuvre « Mon Livre » du premier et du volume volumineux « La République d'Arménie » du second. Durant ces mêmes années, il participe activement aux travaux nationaux, culturels et du parti commencés dans la colonie franco-arménienne, assumant des responsabilités importantes.
En juin 1928, il part pour Erevan via Moscou, pour se rendre à Tabriz. Cependant, arrêté durant son voyage, il est emprisonné. Deux ans plus tard, le 21 juin 1930, libéré de prison, il arrive à Tabriz.
En 1931, il est invité à un poste d'enseignant à l'École Centrale du Diocèse d'Adrbadagan, et en même temps, il apporte sa précieuse contribution à la vie nationale, culturelle et du parti de Tabriz. De 1932 à 1935, il assume la présidence de l'Union Culturelle de Tabriz, qui jouait un rôle important dans divers domaines de la vie culturelle locale.
À la veille de la fermeture des écoles arméniennes, ordonnée par Reza Chah, André Ter-Ohanian fut arrêté à plusieurs reprises et resta emprisonné pendant plusieurs mois. Après la fermeture des écoles, André, qui ne pouvait rester indifférent, entreprit l'enseignement secret de l'arménien et, dans le même temps, composa un nouvel « Abécédaire » d'arménien, le fit imprimer secrètement et le distribua dans les provinces.
En 1936, André Ter-Ohanian est invité à collaborer à la rédaction d'« Alik » et un an plus tard, en 1937, il assume les fonctions de rédacteur en chef du même journal. En septembre 1942, durant la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il démissionne de la rédaction et se consacre à des activités littéraires et éditoriales. Il compile et publie des manuels de langue maternelle, et publie également la série de livres de lecture pour enfants et adolescents « Nor-Aghbiur » avec la collaboration du poète Ostanik.
À la veille de la conférence de Téhéran à l'automne 1943 - qui devait se tenir en novembre de la même année avec la participation de Churchill, Staline et Roosevelt - André Ter-Ohanian fut arrêté sur demande de l'ambassade soviétique par la police de Téhéran, suite à une accusation infondée selon laquelle il aurait organisé un attentat contre Staline. Lorsque Saed devint Premier ministre d'Iran, l'ambassade de l'Union Soviétique demanda par lettre la remise d'André aux autorités soviétiques. Cette demande était fondée sur le fait qu'André Ter-Ohanian aurait prétendument payé une personne nommée Ajdar pour accomplir la mission d'assassiner Staline. Les enquêtes ont par la suite révélé que cet individu nommé Ajdar se trouvait en prison en Égypte à la date indiquée. André est libéré après près de 20 mois d'emprisonnement.
Après sa libération de prison, André Ter-Ohanian se remet au travail éditorial et publie des manuels de langue arménienne faisant suite à l'« Abécédaire ».
En 1949, il édite et publie le magazine « Armenouhi », et en même temps participe à la vie nationale, publique, éducative et culturelle de Téhéran. De 1950 à 1952, il est président de l'Union Culturelle « Ararat » et officie pendant un an à l'école « Davtian Koushesh » comme professeur de langue maternelle.
En 1953, il est invité aux États-Unis comme responsable du parti pour la région de Californie de la F.R.A. et rédacteur en chef du journal « Asbarèz ». Jusqu'en 1969 (avec une interruption d'un an), il occupe ce poste, faisant preuve d'une activité digne de tous les éloges. Au cours de ces 16 années, il participe activement à la vie nationale, culturelle et du parti de la région de Californie, donnant notamment une impulsion à la prospérité d'« Asbarèz » et soutenant la fondation du nouveau centre du même journal. Il apporte également son soutien moral à d'autres entreprises : la Maison de Retraite Arménienne de Fresno, l'école « Ferahian » de Los Angeles et la construction de clubs et d'églises dans d'autres villes, à toutes les initiatives de l'U.G.A.B. et aux travaux de construction et d'entretien des institutions fondées à Fresno, Athènes et Beyrouth grâce aux donations de la bienfaitrice Mme Sophie Hagopian, ainsi qu'aux collectes de fonds effectuées en Californie pour les Congrégations Mékhitaristes de Venise et de Vienne à Antélias.
En 1965-66, il enseigne à la chaire d'arménologie de l'Université de Berkeley (Californie) et compile un manuel spécial en arménien oriental pour les étudiants étrangers.
En 1969, il étudie les vastes archives de l'« Okhrana » tsariste, conservées à la « Hoover Institution » de Californie, et résume et traduit les documents relatifs aux organisations arméniennes (environ 1100 pages), qui sont des sources précieuses pour l'histoire de notre période la plus récente.
En 1970, de retour en Iran, il se consacre à des activités éducatives et culturelles.
En 1973, il se rend à Boston et, après avoir étudié les archives de la F.R.A., il extrait et classe des documents historiques relatifs au mouvement constitutionnel iranien et à la vie et à l'activité du héros national Yeprem, qu'il rassemble en trois volumes.
En 1972, il est élu président de l'Union des Écrivains Irano-Arméniens, et en juin 1974, il assume les fonctions de rédacteur en chef d'« Alik », tout en enseignant à la chaire d'arménologie de l'Université de Téhéran.
Il continue d'assumer ces trois responsabilités avec un dévouement et un esprit de sacrifice total, au nom de la réalisation des idéaux nationaux du peuple arménien et de la prospérité de la littérature et des lettres arméniennes.
André Ter-Ohanian réussit à se rendre en Arménie en tant que touriste à l'automne 1978 et à voir sa patrie bien-aimée.
Le 23 mai 1976, à l'initiative de l'Union des Écrivains Irano-Arméniens, fut célébré le 55e anniversaire de son activité, sous le patronage du Primat du Diocèse, Mgr Artak Sr. Arch. Manoukian, et avec la participation des unions opérant à Téhéran, ainsi que des représentants d'institutions.
André Ter-Ohanian était l'une des figures exceptionnelles des Irano-Arméniens. Il a entièrement consacré sa vie à ses idéaux et au peuple arménien. On peut dire qu'il n'a presque pas eu de vie personnelle et a laissé un grand héritage aux générations futures.
Respect à sa mémoire.
![A. AMOURIAN]()
![AVÉTIS AHARONIAN 1866-1948]()
![AVÉTIS AHARONIAN 1866-1948]()
![ACHOT ARTSROUNI 1902-1979]()
![«DROCHAK» EN CONSTRUCTION - 1898]()
![«DROCHAK» EN CONSTRUCTION - 1898]()
![HOVSEP MOVSESIAN (ARGAM PETROSEANTS)]()
![LES EXILÉS DE SIBÉRIE DU GROUPE DE GOUGOUNIAN]()
![STRUCTURE DE COMMANDEMENT DE KHANASORI ARCHAVANK]()
![YEPREM KHAN (YEPREKEM DAVTEAN)]()
![LE GROUPE DE YEPREM]()
![KÉRI YEPREM KHÉTCHO]()
![YEPREM KHAN (YEPREKEM DAVTEAN)]()
![A. AMOURIAN]()
![MONT ARARAT]()
![DROCHAK - JOURNAL OFFICIEL DE LA FRA]()